lundi, 11 janvier 2021
Cimes cinéphiliques 2020
Qui succède à Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino au titre de meilleur film de l'année ? La réponse dans notre habituel top 10, suivi de son flop 10 tout aussi subjectif.
Au sommet cette année
1) Michel-Ange d’Andrey Konchalovsky : Gravé dans la roche.

2) Uncut Gems de Benny Safdie et Josh Safdie : Money Time.

3) Hotel by the River de Hong Sang-soo : Poétique de l'effacement.

4) Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret : Le principe de délicatesse.

5) Tommaso d’Abel Ferrara : La décomposition fantasmatique du couple.

12:18 Publié dans Cinéma | Tags : cimes cinéphiliques 2020, sylvain métafiot, top 10, flop 10, lucky strike, yong-hoon kim, la nuit venue, frédéric farrucci, peninsula, sang-ho yeon, radioactive, marjane satrapi, enragé, derrick borte, spenser confidential, peter berg, sortilège, ala eddine slim, the wretched, brett pierce et drew t. pierce, the gentlemen, guy ritchie, jojo rabbit, taika waititi, des hommes, jean-robert viallet et alice odiot, soul, pete docter, lux Æterna, gaspar noé, the king of staten island, judd apatow, swallow, carlo mirabella-davis, je veux juste en finir, charlie kaufman, malmkrog, cristi puiu, tommaso, abel ferrara, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, emmanuel mouret, hotel by the river, hong sang-soo, uncut gems, benny safdie et josh safdie, michel-ange, andrey konchalovsky | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 02 janvier 2021
Gravé dans la roche : Michel-Ange d’Andreï Konchalovsky

Sculpter des corps parfaits pour expier les démons de son âme. Tel semble être la ligne de crête qu’arpente le Michel-Ange de Konchalovsky, évitant ainsi de tomber dans l’écueil du biopic hagiographique et convenu, et concentrant plutôt son propos sur quelques années déterminantes de la vie de l’artiste florentin. Cette période tumultueuse de l’Italie de la Haute Renaissance où, entre crises politiques et succession pontificale, Michel-Ange se débat dans les rets du pouvoir afin de s’assurer une sécurité financière et une certaine autonomie artistique. Bénéficiant de la protection de la famille Della Rovere, sa position sociale devient incertaine lors de la mort du pape Jules II et du retour des Médicis qui installent Léon X au Vatican, chassant de force les Della Rovere de Rome. Afin d’honorer la commande de l’imposant tombeau de Jules II, il fait route vers Carrare afin d’y trouver le plus beau marbre d’Italie.
Arrivé à la carrière on touche au cœur du film. Jetant son dévolu sur un « monstre » (un bloc de marbre immaculé si massif que même les ouvriers en appréhendent le transport), Michel-Ange dévoile la démesure de ses obsessions artistiques en même temps que sa folie égoïste. Pour réaliser son chef d’œuvre, il n’hésite pas à mettre en danger la vie des carriers, à trahir ses amis et à s’attirer les foudres de ses mécènes. Car, au-delà du problème d’indépendance artistique vis-à-vis du pouvoir politique et d’une misère financière qui le suit comme un chien galeux, Michel-Ange est dépeint comme un exalté colérique, menteur et cynique. La prestation hallucinée Alberto Testone y est pour beaucoup. Sans doute que Konchalovsky a mis un peu de son propre orgueil dans ce portrait peu flatteur. Reste que, dans un même élan titanesque et insensé, le tour de force de la descente – réelle – du monstre de la carrière, rappelle celle – tout aussi réelle et éprouvante – de l’ascension du bateau dans le Fitzcarraldo de Werner Herzog (1982) en pleine forêt amazonienne.
Et ils sont rares et précieux ces rapports bruts à la matière, cette façon de scruter toute l’exigence technique que demande la pratique et le savoir-faire artisanal, loin du simple « élan créateur » vaporeux et impalpable qui sert de cliché aux portraits paresseux. Ces rouages de la création on les retrouvent, par exemple, dans Amadeus de Milos Forman (1984) lorsque, au seuil de la mort, Mozart dicte la partition du Requiem à Salieri ; ou dans Andreï Roublev d’Andreï Tarkovski (1969) lors de la fonte de la cloche géante de Souzdal. Konchalovsky, qui a participé au scénario de Roublev, saura se souvenir des larmes du jeune Boriska en entendant le son pur de la cloche lorsqu’il confronte Michel-Ange aux affres d’une dévotion religieuse contaminée par des visions cauchemardesques et qu’il tente de faire éclater dans ses œuvres. Seul Dante Alighieri, le divin Dante, demeure un phare pour le sculpteur tourmenté qui, en comparaison du génie du poète, s’enfoui de honte la tête sous le fumier. C’est une constante : bien que d’une arrogance volcanique, Michel-Ange n’a de cesse de déprécier son travail, ce n’est jamais fini, jamais parfait, il faut refaire les couleurs, le pape attendra, je vais tout détruire et tout refaire, si t’es pas content va bosser pour Raphaël, etc. Cette quête infinie de la perfection reflète son combat mystique intérieur : rendre gloire à Dieu c’est vaincre les tentations du Diable. Malgré la corruption qui le ronge, son être tout entier tend vers la beauté, à l’image de la main d’une jeune fille, frêle et nacrée, langoureusement pendante après un ébat amoureux.
Trop longtemps habitués à des biopics médiocres et ronflants – et par là enlaidissant les sujets auxquels ils croient rendre les honneurs – on en aurait presque oublié que le cinéma peut représenter la vie d’hommes illustres avec grâce et ferveur. Michel-Ange est de ceux-là.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
15:31 Publié dans Cinéma | Tags : biopic, dante alighieri, alberto testone, della rovere, le comptoir, sylvain métafiot, gravé dans la roche, michel-ange, andreï konchalovsky | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 26 décembre 2020
Money Time : Uncut Gems de Benny Safdie et Josh Safdie

La dernière fois que nous étions allé rendre visite aux frères Safdie, Robert Patinson ne s’était pas remis de sa cuite post Twilight, errant avec son frère handicapé dans les artères crades d’un New-York qui n’aurait pas subit la politique hygiéniste de Rudolph Giuliani, à la recherche de billets faciles et d’un rêve américain imaginaire (Good Time, 2017). Entamée avec The Pleasure of Being Robbed (2009) et prolongée avec Mad love in New-York (2014), les frères terribles du cinéma indépendant américain poursuivent ainsi l’exploration nerveuse de la « grosse pomme » comme un ver gourmand se repaît d’un fruit pourri avec ce survolté Uncut Gems.
Soit Howard Ratner, joaillier juif du Midtown Manhattan, magouilleur, infidèle, hypocondriaque et accro aux paris sur les matchs NBA. Lorsqu’une opale non taillée arrive d’Ethiopie, Howard voit l’occasion idéale de rembourser toutes ses dettes en tentant une arnaque aux enchères. Mais ses créanciers sont du genre dubitatif et seraient plutôt partisans de lui casser les rotules à la barre à mine. Le nombre de ses ennemis s’accumulant au fil de ses dépenses… La première bonne idée de Bennie et Josh Safdie fut de ressusciter Adam Sandler – acteur plus habitués aux Razzie Awards qu’au tapis rouge des Oscars – en lui offrant ce qui restera peut-être comme le rôle le plus marquant de sa carrière. Howard est propulsé d’une dette de jeu à une embrouille avec un client, à un nouveau crédit, à un pari risqué, à une dette supplémentaire, etc. Exaspérant, il n’en demeure pas moins attachant, notamment dans cette croyance un peu folle que la chance va enfin lui sourire. Le verbe scorsesien vole haut et fort chez les frères. Pas étonnant que l’ancien gamin de Little Italy ait produit le film quand on voit les ressemblances avec l’univers trépidant des Affranchis (1990), Mean Streets (1973) ou Le Loup de Wall Street (2013). Mais cette explosion de logorrhée verbale, loin de résonner dans le vide, constitue le moteur d’Howard, son carburant auto-généré. Si le silence est d’or le phrasé mitraillette d’Howard a l’éclat des diamants tape à l’œil qui viennent orner les grillz et autres médaillons des rappeurs bling-bling et autres stars du showbiz en manque de lustre.
Cette énergie démente qui parcourt tout le film intensifie les obsessions ludiques et dramatiques des frères Safdie. Suivre Howard à la trace s’enliser et essayer de se dépêtrer de toutes ses combines pendant plus de deux heures est épuisant. Mais terriblement drôle et excitant. Porté par la bande-originale électro stratosphérique de Daniel Lopatin et la photographie iridescente de Darius Khondji, le polar fiévreux des Safdie – à la manière des films de genre d’Abel Ferrara – ne tient pas en place, conférant aux rares moments d’accalmie l’élan nécessaire pour repartir à pleine vitesse. De là cette impression que l’hystérie contamine tous les protagonistes du Diamond District, même les plus éloignés de l’œil du cyclone : la frénésie chaotique d’Howard entraînant une véritable tempête d’emmerdements dans son sillon. Loser pathétique qui se voudrait le roi du monde, Howard est comme un gosse irresponsable qui refuserait les règles du monde réel pour s’inventer un rôle à la hauteur de ses ambitions matérialistes. Son excentricité masque pourtant un profond besoin d’amour et une quête spirituelle. Et c’est une inconscience toute enfantine qui déterminera son pari le plus décisif. Pour lui, le jeu est à l’image de sa vie : un mouvement perpétuel hors de la réalité mais qui (en apparence) le maintien en vie. Jouer c’est défier le destin en lui faisant son plus beau sourire.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
13:14 Publié dans Cinéma | Tags : darius khondji, nba, daniel lopatin, adam sandler, le comptoir, sylvain métafiot, new-york, money time, uncut gems, benny safdie et josh safdie | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 01 décembre 2020
Les artisans conteurs : Un monde parfait selon Ghibli d'Alexandre Mathis

Fondé en 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, le studio Ghibli est depuis une bonne trentaine d’années LA référence mondiale en matière d’animation japonaise. Au point de contester sur leur terrain des géants comme Disney ou Pixar. La création du studio marqua la volonté d’indépendance des deux amis, après de longues années à travailler comme assistants-réalisateurs sur des productions dont ils n’avaient que peu de contrôle. Pourtant, si Ghibli a pu atteindre de telles cimes cela provient – avant même l’indéniable qualité graphique de l’animation – de l’incroyable puissance narrative des histoires contenues dans ses œuvres. L’ouvrage d’Alexandre Mathis analyse ainsi, en une dizaine de chapitres finement construits, les différentes thématiques qui insufflent cette énergie si particulière aux films du studio japonais.
On trouve notamment la mise en avant récurrente d’héroïnes déterminées, plus ou moins puissantes, mais jamais dans l’ombre des hommes. Les princesses sont avant tout définies par leurs actes (ceux de combattantes, telles Nausicaä ou Mononoké) et certaines, comme Kaguya (Le Conte de la princesse Kaguya, 2013), se révoltent contre leur condition imposée qui les empêchent de vivre selon leurs désirs. Kaguya est victime d’une pression masculine la forçant à se marier, tout comme la jeune Haru dans Le Royaume des chats (2002) ; mais contrairement à Taeko qui, dans Souvenirs goutte à goutte (1991), choisira la vie familiale à la campagne plutôt qu’une carrière en ville. Dans Porco Rosso (1992), c’est grâce à ses talents d’ingénieur que Fiona, avec l’aide des femmes de sa famille, reconstruit l’avion du héros. C’est toujours la libre volonté qui prime.
Mais les films Ghibli regorgent également d’enfants se lançant, sans crainte, à corps perdus à l’aventure (Satsuki et Mei, Sôsuké et Ponyo), émerveillés de côtoyer des créatures magiques – Kamis, Yõkai et autres tanukis farceurs sont légions dans Le Voyage de Chihiro (2001), Princesse Mononoké (1997) ou Pompoko (1994). Une acception candide du monde fantastique qui devient contagieuse : « Parce que les personnages deviennent un peu plus comme nous, nous avons un peu plus envie de devenir comme eux. » Cette sensation de « vivre dans le film » – que l’on ressent par exemple devant Mes voisins les Yamada (1999) – porte un nom : le Rinjõkan, le « sentiment d’être sur place ». Chez Takahata, on trouve également le Jitsuzaikan, la « sensation du réel ». Voilà d’ailleurs un des points qui différencie les films de Miyazaki de ceux de Takahata : le premier ancre ses aventures dans des univers résolument imaginaires tout en montrant le quotidien des personnages et en s’inspirant de lieux existants (la vieille ville de Stockholm, la mer adriatique, le village taïwanais de Juifen, Colmar…) ; alors que Takahata raconte des histoires se déroulant principalement dans le Japon contemporain, agrémentées de nuances de magies. Ces deux visions opposées du réel n’en demeure pas moins complémentaires quant à l’identité du studio que l’on pourrait définir comme un « merveilleux réaliste ». À noter que Miyazaki possède un allié de poids en la personne de Joe Hisaishi, conférant un lyrisme flamboyant à toutes ses œuvres depuis Nausicaä (1984).
Bien qu’admirateurs des techniques artisanales, les deux animateurs phares du studio partagent néanmoins le même dégoût de la guerre sous toutes ses formes et des méfaits industriels qui ravagent la planète. L’horreur des combats est explicite dans Le Château ambulant (2004), et celui d’un pouvoir militaire devenu fou dans Le Château dans le ciel (1986). Passionné d’aéronautique « Miyazaki rêve d’avions avec un idéal de pacifiste convaincu », comme en témoigne l’aviateur Porco qui « préfère être cochon que fasciste », Nausicaä qui survole les batailles avec son élégant planeur, ou l’aveuglement créatif de Jiro dans Le vent se lève (2013), bientôt rattrapé par la réalité du conflit international. Mais c’est peut-être Le Tombeau des lucioles (1988) qui montre de manière la plus frontale et cruelle l’abomination de la guerre à travers la destruction des villes, des familles et des innocents. Lutter contre la destruction du monde va également de pair avec la préservation de la nature. Si cette dernière semble hostile au premier contact elle ne fait que réagir aux agressions premières des hommes : les ômus de Nausicaä, les tanukis de Pompoko ou les Tatari-gami de Mononoké se révoltent contre la destruction de leur écosystème. Pourtant, malgré la violence et la complexité des relations entre l’homme et la nature (comme l’illustre le fameux personnage de Dame Eboshi, contrainte de déforester pour protéger les siens), il y a toujours une lueur d’espoir chez Ghibli, permettant à chacun de trouver sa place : « Si les humains et la nature ne peuvent pas spontanément vivre pleinement en harmonie, c’est en pariant sur l’intelligence de quelques-uns qu’un fragile équilibre peut exister. »
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
09:15 Publié dans Cinéma | Tags : hayao miyazaki, isao takahata, sylvain métafiot, le comptoir, les artisans conteurs, un monde parfait selon ghibli, alexandre mathis | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 26 octobre 2020
Prodiges, blasphèmes et sorcellerie : Cinémiracles, l’émerveillement religieux à l’écran de Timothée Gérardin

Principalement cantonné aux représentations de la vie de Jésus, le miracle religieux a essaimé dans nombre de films au cours du siècle dernier au point d’en constituer un genre à part entière. Comme le note Timothée Gérardin (que nous avons interviewé à propos du cinéma de Christopher Nolan) dans l’introduction de ce passionnant essai : « Dès l’invention du cinématographe, les sujets religieux ont fasciné les réalisateurs, la plupart d’entre eux ayant une prédilection pour la Passion du Christ. » Et de citer George Méliès qui s’était fait une spécialité de rejouer certains miracles comme La Tentation de saint Antoine en 1898, Le Christ marchant sur les flots en 1899 ou Jeanne d’Arc l’année suivante. Cette dernière fut d’ailleurs une figure récurrente du miracle médiéval au cinéma, que ce soit chez Carl Theodor Dreyer, Robert Bresson, Bruno Dumont, Jacques Rivette ou Roberto Rossellini. Une représentation paradoxale dans le sens où « la légende, qui en fait un destin humain, politique ou tragique, n’illustre qu’indirectement l’inspiration divine dont elle se revendique ».
Davantage liée à la notion d’émerveillement que de celle de merveilleux, le miracle se caractérise par la surprise d’un évènement extraordinaire, notamment dans la perception que les spectateurs en ont, mais également par une « expérience intime du sublime » couplée à une « dimension de crise et de vertige ». Des traits allègrement détournés dans le cadre des comédies qui parodient cet émerveillement mystique en usant de la farce et du blasphème. Une entreprise de démystification qui s’incarne dans les films de Jean-Pierre Mocky (Le Miraculé, 1987), Yves Robert (Clérambard, 1969), Tom Shadyac (Bruce tout-puissant, 2003) Franck Capra (La femme aux miracles, 1931), Kevin Smith (Dogma, 1999) ou encore dans la série satirique South Park. En décalage, on peut ajouter à cette liste le geste surréaliste et onirique contenu dans le Théorème de Pier Paolo Pasolini (1968) et La Voie lactée de Luis Buñuel (1969) qui subvertissent la représentation traditionnelle du miracle.
Mais tout dogme religieux à sa part d’ombre et le miracle peut également sombrer du côté obscur. Il prend ainsi les atours de la malédiction, de la possession, des apparitions et autres rituels de sorcellerie. Ce n’est plus Dieu qui intercède à travers l’homme mais le Diable. Le surnaturel en devient terrifiant. En témoigne la possession de Regan MacNeil dans L’Exorciste de William Friedkin (1973), les présences démoniaques dans la série de film Conjuring (2013), la folie paranoïaque des personnages de Possession d’Andrzej Zulawski (1981), l’avènement de l’anti-Christ dans Prince des ténèbres de John Carpenter (1987) ou les visions ambiguë chez Scorsese : notamment la séduction du Diable dans La dernière tentation du Christ (1988), l’espérance contrariée dans Silence (2016) ou la hantise des âmes perdues dans À tombeau ouvert (1999). Finalement, au-delà des multiples représentations, le cinéma ne serait-il lui-même pas la « machine miraculeuse » par excellence ? L’acte de foi c’est aussi – et peut-être surtout – la croyance du spectateur devant un film. À ce titre, André Bazin compare la restitution du monde sur pellicule au visage du Christ imprimé sur le suaire de Turin. Pour le théoricien il s’agit d’un véritable acte de foi issu d’un « pouvoir irrationnel […] qui emporte notre croyance. » L’émerveillement ressenti à chaque projection devant un écran géant ne semble pas démentir cette conviction.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
13:24 Publié dans Cinéma | Tags : andré bazin, south park, martin scorsese, john carpenter, william friedkin, andrzej zulawski, carl theodor dreyer, robert bresson, bruno dumont, jacques rivette, roberto rossellini, prodiges, blasphèmes et sorcellerie, le comptoir, sylvain métafiot, cinémiracles, l’émerveillement religieux à l’écran, timothée gérardin | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 18 septembre 2020
Timothée Gérardin : « Nolan fond ses concepts dans de pures expériences sensorielles »
Timothée Gérardin est critique de cinéma pour la revue Independencia, fondateur du blog Fenêtre sur cour et auteur de l’essai « Cinémiracles, l’émerveillement religieux à l’écran » (Playlist Society, 2020). Dans son précédent ouvrage « Christopher Nolan, la possibilité d’un monde » (Playlist Society, 2018), il explore le parcours du cinéaste britannique qui, du film noir indépendant à l’épopée spatiale, en usant d’innovations formelles, de paradoxes temporels et d’architectures labyrinthiques, questionne notre conception de la réalité.
Le Comptoir : « Cinéaste du montage, Nolan est plus globalement un cinéaste de la construction trompeuse, du piège faussant la perception », écrivez-vous. La pierre angulaire de ce dérèglement de la perception n’est-il pas le jeu avec la temporalité ? Narration à rebours dans Memento, temps relatif dans Interstellar, chronologie superposée dans Dunkerque, temps ralenti dans Inception, temps inversé dans Tenet…
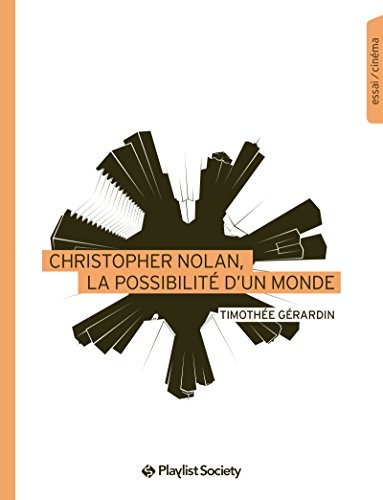 Timothée Gérardin : Oui, c’est du moins ce à quoi il est le plus souvent revenu, même si c’est un peu moins évident dans ses premiers film, si on met Memento de côté : Following, Insomnia, Le Prestige… Je pense que sa grande affaire est avant tout de pousser l’art du récit à ses extrémités, par son utilisation du montage qui fragment les points de vue, les confronte, les emboite, etc. Tantôt pour brouiller les pistes, créer une atmosphère, tantôt pour expliquer quelque chose au spectateur ou le tenir en haleine. À force de faire du récit son matériau, manipulable par lui en tant que cinéaste, mais aussi par ses personnages, il arrive à ce qui en constitue la substantifique moelle : le temps. Et sa manière d’aborder le sujet a elle-même évolué. Le récit de Dunkerque, par exemple, se différencie de celui d’Interstellar et d’Inception en ce que la relativité n’y est pas justifiée par le scénario : elle est un mode de narration à part entière, auquel le cinéaste demande d’adhérer.
Timothée Gérardin : Oui, c’est du moins ce à quoi il est le plus souvent revenu, même si c’est un peu moins évident dans ses premiers film, si on met Memento de côté : Following, Insomnia, Le Prestige… Je pense que sa grande affaire est avant tout de pousser l’art du récit à ses extrémités, par son utilisation du montage qui fragment les points de vue, les confronte, les emboite, etc. Tantôt pour brouiller les pistes, créer une atmosphère, tantôt pour expliquer quelque chose au spectateur ou le tenir en haleine. À force de faire du récit son matériau, manipulable par lui en tant que cinéaste, mais aussi par ses personnages, il arrive à ce qui en constitue la substantifique moelle : le temps. Et sa manière d’aborder le sujet a elle-même évolué. Le récit de Dunkerque, par exemple, se différencie de celui d’Interstellar et d’Inception en ce que la relativité n’y est pas justifiée par le scénario : elle est un mode de narration à part entière, auquel le cinéaste demande d’adhérer.
Très théorique dans Inception, cette obsession pour le temps est devenue une histoire d’émotion dans Interstellar, de sensation dans Dunkerque et d’intuition dans Tenet. Une autre différence de Tenet, c’est que le phénomène temporel qu’il décrit ne peut pas être simplement figuré par le montage parallèle, il lui faut cette fois-ci représenter deux dynamiques opposées dans le même plan. Je crois que Nolan cherche à fondre ses concepts dans de pures expériences sensorielles, c’est en tout cas vers cela que semble aller sa filmographie.
12:09 Publié dans Cinéma | Tags : timothée gérardin, interstellar, dunkerque, la possibilité d’un monde, insomnia, batman, inception, tenet, le prestige, memento, nolan fond ses concepts dans de pures expériences sensorielles | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 03 août 2020
Guy Marignane : « Il y a une extraordinaire matière poétique chez Sade »

Producteur et scénariste, Guy Marignane a réalisé son premier long-métrage « Les Mélancolies de Sade » dans lequel l’écrivain est livré à la solitude de la détention et dont l’imagination révoltée sera sa seule échappatoire. Un théâtre d’ombre de lumière hanté par les lettres de Renée Pélagie et Mlle de Launay, le fantôme de son ancêtre Laure de Sade, l’apparition de son héroïne Juliette ou la conversation imaginaire avec Jean-Jacques Rousseau, dévoilant un Sade amoureux et insoumis, épris de doutes mais toujours de liberté.
Le Comptoir : Comment est survenue l’envie d’adapter une partie de la vie du marquis de Sade ? Et pourquoi cette période d’emprisonnement particulièrement ?
Guy Marignane : Le marquis de Sade est resté 27 ans enfermé, je me suis intéressé à la fragilité qui découlait d’une si longue peine ; le désir de mettre fin à ses jours, l’abandon des proches, qu’est ce qui fait que l’on tient, à quoi se raccroche-t-on pour tenir toutes ces années ?
Cet emprisonnement dans le film est la représentation métaphorique des cellules occupées toute sa vie Il ne s’agissait surtout pas de faire un biopic, en reprenant une période précise de l’histoire de Sade.
Une fidélité aux textes oui, mais pas de fidélité à sa biographie.
« Je voulais faire un film, court, dense avec une seule couleur. »
Les nombreuses correspondances de Sade constituent la matière première de votre œuvre. Avez-vous également consulté des biographies et des essais littéraires pour le travail préparatoire ?
Bien entendu, j’ai consulté les biographies de Maurice Lever et celle de Gilbert Lely, pour laquelle j’ai une vraie faiblesse, Lely était poète, et j’ai toujours associé Sade à la poésie, il y a une extraordinaire matière poétique chez Sade.
J’ai lu quelques essais, mais surtout de nombreux ouvrages de Sade, les plus connus mais aussi d’autres moins connus, comme ses Voyages d’Italie (1775), Aline et Valcour (1793), les Contes étranges (1800) qui se partagent entre réalité et imaginaire.
Puis j’ai laissé passé beaucoup de temps avant de commencer la rédaction d’une continuité.
13:00 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, le comptoir, les mélancolies de sade, renée pélagie, mlle de launay, laure de sade, guy marignane, il y a une extraordinaire matière poétique chez sade | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 09 janvier 2020
Cimes cinéphiliques 2019
Qui succède aux Garçons sauvages de Bertrand Mandico au titre de meilleur film de l'année ? La réponse dans notre habituel top 10, suivi de son flop 10 tout aussi subjectif.
Au sommet cette année
1) Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino : preuve, une nouvelle fois, que l’art seul peut nous consoler et nous venger du réel.

2) Bacurau de Kleber Mendonça Filho : les furtifs prennent les armes.

3) An Elephant Sitting Still de Hu Bo : dépression en basse altitude dans la Chine moderne.

4) Sunset de László Nemes : la quête de la vérité est un labyrinthe vers la folie.

5) Parasite de Bong Joon Ho : la théorie du ruissellement jusqu’au débordement.

18:09 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, top 10, flop 10, cimes cinéphiliques 2019, j'ai perdu mon corps, liberté, ne croyez surtout pas que je hurle, une vie cachée, jeanne, traîné sur le bitume, parasite, sunset, an elephant sitting still, bacurau, once upon a time… in hollywood | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 29 décembre 2019
Les Furtifs : Bacurau de Kleber Mendonça Filho

Tout commence dans l’espace. La caméra en orbite autour de la terre se rapproche progressivement du sol, traverse les nuages vers la région du Nordeste du Brésil, suivant enfin la route d’un camion citerne slalomant entre des cercueils éparpillés sur le bitume (signe précurseur que la mort planera tout au long du film, prenant notamment les traits d’un drone aux allures SF des années 50). Perdu dans le Sertaõ, la commune de Bacurau manque d’eau, cette dernière étant retenue par un préfet corrompu et bedonnant qui a engagé des mercenaires américains (menés par le génial Udo Kier) pour soumettre les habitants du village.
D’une grande beauté plastique le troisième film de Kleber Mendonça Filho arrive à mêler génialement les différents genres (post-apocalyptique, chronique sociale, horreur furtive) pour finalement établir une ambiance fiévreuse de western en pleine pampa mélangeant l’archaïque et le futuriste dans une escalade de violence revancharde et implacable. La musique Night qui retentit au mi-temps du film lors d’une scène d’enterrement sous psychotropes ne doit rien au hasard : l’ombre tutélaire de John Carpenter plane sur tout le film (l’école est par ailleurs baptisée « João Carpinteiro »). Menacés de disparition, les habitants du village feront de leur invisibilité une stratégie de défense et de leur propre histoire une faculté d’attaque (le musée faisant office d’armurerie), organisant une fusillade mémorable face à une équipe d’américains puérils et arrogants considérant la guerre comme un jeu. À ce titre, le personnage de Lunga, gangster transgenre et ultraviolent organisant la résistance, fulmine de charisme et aurait mérité davantage de présence à l’écran.
À ce climat poisseux et explosif s’ajoute l’intransigeance du message politique (que l’on devine résonner avec la récente élection du président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro) : face à l’envahissante surveillance technologique et la logique libérale de privatisation de toutes les parcelles de vie sur terre menée par les politicards et les affairistes, Kleber Mendonça Filho montre que la communauté (village, famille, groupe) est une force, qu’elle peut se dissimuler aux yeux des puissants ou bien, si nécessaire, résister avec violence pour préserver ses traditions, sa culture et ses biens communs.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
14:59 Publié dans Cinéma | Tags : le comptoir, sf, john carpenter, sylvain métafiot, les furtifs, bacurau, kleber mendonça filho | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 25 décembre 2019
Dépression en basse altitude : An Elephant Sitting Still de Hu Bo

Dans une grande ville du nord de la Chine cerclée de fumées charbonneuses, quatre personnages désœuvrés, atteints d’un profond mal-être existentiel se croisent, se frôlent et se confrontent le temps d’une journée brumeuse, dessinant sur la carte de la modernité industrielle les ramifications d’une mélancolie urbaine en noir et bleu.
Radiographiant la détresse collective de tout un pays, Hu Bo déploie une narration étirée (le film dure presque 4h) permettant de symboliser intensément la douleur de ses différents protagonistes. Que ce soit pour fuir la vengeance d’un malfrat, la culpabilité d’un amour interdit, le mépris de sa propre famille ou les remords d’avoir provoqué le suicide d’un ami, c’est le même désir de s’échapper d’un monde privé d’empathie qui n’a plus rien à offrir que de sombres destins dans des paysages morts. Et la seule évasion possible se fera en direction d’un mythe au repos apaisant (le fameux éléphant du titre). S’attardant sur les gestes, les visages et les corps – au point de rendre leur environnement flou – la mise en scène s’enroule dans une succession de plans-séquences et d’analogies métaphoriques d’une beauté crépusculaire stupéfiantes. Collant au plus près des personnages, les effleurant de manière douce, la caméra colle parfois au ras-du-sol, glissant le long de l’asphalte d’une ville tentaculaire baignée d’une lumière spectrale et froide.
Cette grande tristesse, cette absence totale d’amour, qui imprègne le long-métrage de Hu Bo n’est, par ailleurs, sans doute pas étrangère à l’extrême souffrance intérieure de celui-ci (bien qu’il ne faille pas réduire les qualités esthétiques du premier à l’état dépressif du second). Le jeune réalisateur de 29 ans mis fin à ses jours quelques mois après la fin du tournage. Le réalisateur hongrois Béla Tarr disait de lui : « C’était un homme impatient, dans une urgence perpétuelle. Peut-être savait-il qu’il lui restait peu de temps… Il faisait tout pour obtenir sans attendre ce qu’il voulait. Il n’acceptait pas le monde, et le monde ne l’acceptait pas. »
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
17:09 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, le comptoir, dépression en basse altitude, an elephant sitting still, hu bo | Lien permanent | Commentaires (0)









