lundi, 15 mai 2023
Petit traité contre la servitude : Le Tyran

C’est en 1870, à Londres, que paraît ce petit volume sans nom d’auteur. De ce que nous apprend la préface, le manuscrit proviendrait de la collection d’un savant français, « grand amateur de curiosités littéraires et de vieux manuscrits » et acheté à Paris lors d’une vente publique à la suite de la révolution de 1848. Chaque page contient le texte original en latin surmonté de sa traduction française agrémentée d’interpolations de Machiavel ou La Boétie. Son origine exacte semble encore inconnue à ce jour, ce qui n’enlève rien à sa portée universelle et à ses mises en gardes tristement actuelles.
L’auteur décrit en sept courts chapitres la logique despotique, de ses fondements à sa disparition. Il charge bille en tête : « Quand un peuple, abandonnant ses droits, ses lois, veut être gouverné, il n’y a désormais plus qu’une seule forme qui est le despotisme. » Partant, le tyran ne peut fonder son empire que sur « l’impuissance ou la corruption d’un peuple ». Un peuple qui ne soucie guère des questions politiques, n’ayant plus goût à l’esprit public, délaissant la pensée critique, s’en remettant aveuglément à ses représentants, laissant ainsi le champ libre aux usurpateurs sans scrupules. Et « comme il est plus facile d’organiser le silence que la liberté, la tyrannie se fait, et on la supporte par la même raison qu’il faut vivre ». L’auteur brosse le portrait du tyran en homme de proie, une brute à l’instinct animal dont la société même est la cible principale, le reléguant hors des sphères de la patrie et de la famille. Le crime sous toutes ses formes est le principal moyen à sa disposition pour atteindre et se maintenir au pouvoir : « Quelle que soit la résistance, il faut qu’elle soit vaincue. – Quelles que soient les ressources, il faut s’en servir. » De sorte que, par un raisonnement pervers, « le bon droit, la justice, l’honneur, la vertu deviennent criminels, parce qu’ils résistent ; la trahison, le meurtre, le pillage, la guerre civile, avec tout son cortège d’horreurs, sont des moyens légitimes, parce qu’ils le servent et lui profitent ».
Le tyran est un homme dément, enserré dans les plis de ses ambitions de domination et de jouissance, écrasant le monde de sa souveraine folie et s’appuyant sur la force policière pour maintenir son régime en place : « Le ministre, le soldat, le législateur, le juge et les fonctionnaires à tous les degrés sont les agents directs de la police du despote. La délation et la peur font le reste. » Le despote s’entoure ainsi de courtisans vils et de ministres sans valeur, constituant « la plus effroyable bande de brigands qui se puisse imaginer », reléguant le sens moral dans la sphère privée et familiale, dernier refuge des hommes de bien. En définitive, une vigilance permanente, soutenue par une éthique du bien commun, envers toute forme de corruption des institutions est nécessaire pour éviter la bascule funeste dans la tyrannie : « Dans un pays où l’on respire la servitude avec la vie, la vie s’amoindrit chaque jour et les facultés s’éteignent peu à peu dans un équilibre funeste, qui empêche de voir l’amoindrissement et ne laisse plus imaginer une autre sorte de vie. »
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
13:43 Publié dans Politique | Tags : le tyran le comptoir, sylvain métafiot, editions allia, servitude, machiavel, la boétie | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 03 février 2023
De la théatrocratie du pouvoir à la société de communication

Le pouvoir est une forme de théâtre mouvante. Un objet dramaturgique qui, malgré des invariants, évolue en fonction des contextes historiques. Ce qui se joue sur scène c’est la relation entre la communication politique et la représentativité politique, à travers l’usage des protocoles, l’art oratoire parlementaire, l’émergence d’espaces publics critiques dans la société civile et l’influence des médias de masse.
Dans Le pouvoir sur scènes (1980) le sociologue Georges Balandier revient sur cette dimension dramaturgique du pouvoir politique : « Derrière toutes les formes d’aménagement de la société et d’organisation des pouvoirs se trouve toujours présente, gouvernantes de l’arrière-scène, la théatrocratie. Elle règle la vie quotidienne des hommes en collectivité. Elle est le régime politique permanent qui s’impose aux régimes politique divers, révocables, successifs. Il existe une relation intime apparentant l’art du gouvernement à l’art de la scène. »
Cette scénographie du pouvoir semble ainsi nécessaire pour éviter deux types de gouvernements : celui basé sur la force ou la violence car se sentant menacé en permanence ; celui fondé sur la raison pure et froide ayant trop peu d’intensité pour susciter la ferveur collective. La scénographie politique se place entre ces deux extrêmes. Le pouvoir ne pouvant se maintenir par la seule domination brutale ni par la seule justification rationnelle.
vendredi, 02 décembre 2022
Les prospérités de la pensée fasciste : L’Atomisation de l’homme par la terreur de Leo Löwenthal

Universitaire allemand spécialiste de la critique sociologique littéraire, Leo Löwenthal (1900-1993) a fui l’Allemagne lors de l’accession au pouvoir des nazis. Trouvant refuge aux États-Unis à l’instar de ses compatriotes de l’École de Francfort, il enseigne un temps à l’université Colombia de New-York avant de rejoindre le département de sociologie de l’université de Berkeley en 1956. Il est notamment l’auteur de Literatur und Massenkultur (Littérature et Culture de masse) et Das bürgerliche Bewußtsein in der Literatur (La Conscience bourgeoise dans la littérature).
L’Atomisation de l’homme par la terreur est, quant à lui, paru pour la première fois dans la revue américaine Commentary en janvier 1946. Löwenthal y développe la thèse selon laquelle loin d’être un phénomène révolu, la terreur fasciste demeure « profondément ancrée dans les tendances de la civilisation moderne, et en particulier dans la structure de notre économie ». Il pointe ainsi un paradoxe : l’individu est exposé à un énorme dispositif de communication sans pouvoir communiquer avec son prochain. Il vit en collectivité mais demeure esseulé, paralysé par la peur de développer une pensée originale ou des émotions spontanées. Cet « état de coma moral » qui semble infuser tous les pans de la société, le sociologue le définit comme le processus d’atomisation de l’individu.
Ce processus terroriste agit par le biais de six leviers d’action : 1) L’irrationalité des actions d’un gouvernement envers sa population, notamment à travers les arrestations arbitraires qui a pour conséquence « l’élimination des différences et des droits individuels face à l’appareil du pouvoir ». 2) Le bouleversement du rythme normal de l’existence qui rompt « la continuité de l’expérience et de la mémoire » à l’œuvre dans les camps de concentration mais aussi, malgré un degré inférieur, au sein de la société terroriste dans laquelle « le projet pour l’individu est… de n’avoir aucun projet ». 3) La dissolution de la personnalité et du sens moral autant chez les victimes que chez les bourreaux. Ces derniers n’éprouvant plus une once de culpabilité ou de remords après avoir exécutés des actes barbares de manière automatique. Löwenthal cite un prisonnier évadé du camp polonais d’Oświęcim qui témoigne de la destruction de « tout lien social chez la victime [en réduisant] sa vie spirituelle au seul désir craintif de prolonger son existence ne serait-ce que d’un jour ou d’une heure. » 4) La lutte perpétuelle pour la survie imposée par un système répressif qui réduit les individus à une somme d’instincts primaires. 5) La sortie de l’humanité de l’Histoire universelle, redevenant selon les mots d’Hitler un « pur et noble matériau naturel », exploitable et jetable par une « jeunesse violente, autoritaire, intrépide, cruelle » ne connaissant « ni faiblesse, ni tendresse ». Jankiel Wiernik, charpentier dans le centre d’extermination de Treblinka, témoigne de cette manutention macabre des prisonniers en considérant « chaque personne vivante comme un futur cadavre, à très bref délai. » 6) L’identification aux bourreaux, décrite par Bruno Bettelheim en ces termes : « Un prisonnier avait atteint le stade final de l’adaptation au camp lorsqu’il avait modifié sa personnalité de manière à accepter siennes les valeurs de la Gestapo ».
Or, de nombreuses causes à l’œuvre dans les sociétés démocratiques peuvent favoriser l’émergence d’un nouveau système de terreur, à savoir : le vide social et économique qui tiraille des masses de travailleurs ne trouvant plus aucun sens dans le processus de création et de production standardisé ; la croyance aveugle en des idéologies politiques proposant une vision du monde binaire et intellectuellement confortable ; l’effondrement des principes moraux et individualistes hérités de la société libéral face aux crimes de masse, provoquant un lourd sentiment d’impuissance et de frustration chez des citoyens démunis. Lors d’une conversation avec le président du sénat de la Ville libre de Dantzig, Hermann Rauschning, Hitler avouera : « Ce qui est plus important encore que la terreur, c’est la transformation systématique des idées et des représentations sensorielles des populations. Nous devons parvenir à assujettir les pensées et les sentiments des hommes. »
En 1949, Leo Löwenthal, en collaboration avec le philosophe Norbert Guterman, prolongera son analyse de la pensée terroriste avec une étude sur « l’agitation fasciste aux États-Unis » dans les années 1940 : Les prophètes du mensonge.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
jeudi, 27 octobre 2022
Sa Majesté des rats : La Peste à Naples de Gustaw Herling-Grudziński

Écrivain, journaliste et critique littéraire polonais Gustaw Herling-Grudziński fut l’un des premiers à décrire de l’intérieur l’univers concentrationnaire du goulag dans Un monde à part paru en 1951 (et dont il faudra attendre 1985 pour le découvrir en France grâce à Jorge Semprun). Interdit de séjour en Pologne, exilé à Rome, Londres, Munich et Naples où il finit sa vie, il rédigea des nouvelles, des essais et des articles dans divers hebdomadaires italiens et dans la revue Kultura qu’il cofonda en 1947. La Peste à Naples est tirée du recueil L’Île et autres récits paru en 1992 chez Gallimard. Il relate l’instrumentalisation de l’épidémie survenue en 1656 à des fins politiques antirévolutionnaires.
Sous-titré Relation d’un état d’exception, ce court texte se veut la suite du Miracle (1983) récit de l’insurrection populaire napolitaine contre la Couronne espagnole en 1647 avec sa tête le pécheur Tomaso Aniello d’Amalfi dit « Masaniello ». Sous l’autorité du duc d’Arcos, Masaniello fut arrêté et assassiné. Sa rébellion stoppée dans son élan. En contrepartie, sa légende naquit et enfla non seulement chez le peuple napolitain mais dans toute l’Europe : « Qu’on en eût conscience ou non, Masaniello annonçait la révolution, il fut la flamme approchée des trônes et éteinte de justesse avant un embrasement général. »
C’est pour éteindre les dernières braises de la révolte que le comte Castrillo, représentant disgracieux mais bon diplomate de Philippe IV, fut nommé vice-roi de Naples, succédant au duc d’Arcos et au comte d’Ognatte. Son objectif était de calmer les ardeurs de la populace par une étrange « douceur paternelle » qui n’oubliait pas le recours à la force armée. Lorsque la peste venant de Sardaigne menaça la cité, il décida de séparer le Palais et la garnison du reste de la population. La maladie fut d’abord minimisée par les autorités politiques, interdisant de la nommer telle quelle, et répandant le bruit que le responsable serait « l’Antéchrist Masaniello, qui dans l’au-delà tramait de nouveau contre le bonheur de la ville ». De son côté, l’Église trouva là un moyen de faire fructifier son entreprise de purification des âmes afin d’échapper au « fléau de Dieu » qui s’abattait sur la ville.
Il ne semble pourtant faire aucun doute que la maladie fut apportée par des soldats espagnols venus de Cagliari sur un navire marchand. Le vice-roi les ayant envoyés en ville, la peste pris naissance dans un bordel du quartier de Lavinaio et se répandit dans les venelles alentour. D’où l’affirmation de Herling que Castrillo a fait sciemment venir la peste à Naples pour exterminer une partie du peuple et mettre les survivants à genoux, tuant « le sentiment de solidarité que Masaniello avait, selon lui, inoculé à la plèbe napolitaine ». Résultat, plus de la moitié des habitants périrent durant les huit mois de l’épidémie, tous les liens sociaux et familiaux furent anéantis. Le vice-roi, barricadé dans sa forteresse, était satisfait. « La peste avait détruit, pour les rescapés, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, le goût, la valeur et la dignité de la vie collective avec toutes ses splendeurs et ses misères. »
De nos jours, c’est une autre peste, brune, qui ressurgit en Italie. Celle qui porte les nostalgiques du fascisme au plus hauts sommets du pouvoir.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
11:33 Publié dans Littérature, Politique | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, sa majesté des rats, la peste à naples, gustaw herling-grudziński, tomaso aniello d’amalfi | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 23 mai 2022
La caste des crypto-puritains : Le monopole de la vertu de Catherine Liu
Professeure au département des études cinématographiques et visuelles de l’université de Californie à Irvine, Catherine Liu dirige également le Centre pour les Sciences humaines et est souvent invitée dans les colonnes de la revue socialiste Jacobin. Dans Le Monopole de la vertu (Virtue Hoarders. The Case against the Professional Managerial Class) elle montre (comme Orwell en son temps) de quelle façon les élites progressistes américaines (les cadres et professions intellectuelles supérieures en France) mènent une guerre culturelle contre les classes populaires. Une guerre ouverte depuis les années 1970 à travers une série de comportements individuels parés des plus beaux atours moraux : « Lire des livres, élever des enfants, se nourrir, rester en bonne santé ou faire l’amour ont constitués autant d’occasion de démontrer qu’on faisait partie des individus les plus évolués de l’histoire humaine. »
Il fut pourtant un temps, dans la première moitié du Xxe siècle, où la classe managériale soutenait la classe ouvrière et les luttes populaires, marchait aux côtés du parti socialiste d’Eugène Debs, militait pour un État fort garant de politiques publiques en faveur des plus pauvres. Un temps où elle valorisait la recherche publique et l’intégrité des universitaires au sein d’institutions indépendantes des marchés et des capitalistes de tout poil. Ce temps semble révolu. La loyauté à changé de camp : « En reprenant à leur compte l’héritage de la contre-culture et sa prédilection pour les innovations technologiques et spirituelles […] les élites managériales ont en grande partie réussit à démolir toute l’infrastructure physique et désormais cybernétique de nos quotidiens pour la reconstruire à leur propre image. »
Partant, Catherine Liu explore plusieurs aspects de l’arrogance de la pensée de la classe managériale. L’obsession de nouvelles normes à transgresser conjuguée à l’hostilité envers la culture mainstream permet ainsi d’asseoir leur prétendue supériorité intellectuelle. Une obsession qui trouva son paroxysme dans le célèbre article parodique d’Alan Sokal, « Transgresser les frontières : vers une herméneutique transformatrice de la gravitation quantique », publié en 1996 dans la très sérieuse revue Social Text. Pour ce canular, Sokal fut mis au pilori par ses confrères des cultural studies, de même que la professeure Angela Nagle qui critiquait les apôtres de la transgression dans son essai Kill All Normies : Guerres culturelles en ligne, de 4chan et Tumblr à Trump et l’Alt-Right (2017).
La féministe Laura Kipnis, professeure à la Northwestern University, fut également couverte d’opprobre par ses pairs progressistes en dénonçant, dans son ouvrage Le Sexe polémique : quand la paranoïa s’empare des campus américains (2019), le climat de panique morale et de délation dans les universités qui fait fi de toute présomption d’innocence et transforme des commissions d’enquête en tribunaux populaires. Le domaine de la santé et l’éducation des enfants n’échappent pas non plus à l’arrogance de la classe managériale : le néolibéralisme ayant contaminé les politiques sociales de puériculture au profit d’un marché de la parentalité ultra concurrentiel et angoissé où l’enfant est paramétré pour « réussir ».
D’une manière générale, « Les élites managériales, de façon consciente ou non, cherchent à humilier leurs adversaires en leur attribuant un incorrigible manque d’intelligence, d’empathie et de vertu ». Il n’est guère étonnant que ce mépris global des gens ordinaire ait poussé ses derniers dans les bras des leaders réactionnaires qui, à la force d’un discours démagogique et d’une propagande conservatrice, ont su instrumentaliser la détestation (bien réelle) du peuple envers les classes supérieures. Sous peine d’un véritable sursaut socialiste politique et économique ce schéma est malheureusement voué à se reproduire.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
11:08 Publié dans Politique | Tags : laura kipnis, alan sokal, angela nagle, le comptoir, sylvain métafiot, la caste des crypto-puritains, le monopole de la vertu, catherine liu, classe managériale, progressistes américains | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 23 novembre 2021
Le Marché contre la société : La mentalité de marché est obsolète ! de Karl Polanyi

Dans ce bref essai publié pour la première fois en 1947, l’économiste austro-hongrois Karl Polanyi (1886-1964) décortique en à peine dix chapitres les idées simplistes et les valeurs utilitaristes du capitalisme libéral solidement incorporées dans l’économie humaine depuis l’avènement de la Révolution industrielle. L’enjeu civilisationnel étant cependant, à l’Ère de la Machine, de « chercher une solution au problème de l’industrie elle-même » et pas uniquement aux « problèmes du capitalisme ».
L’apparition de la doctrine du laisser-faire, remplaçant les marchés isolés d’antan par un système de marché autorégulateur, donna naissance à un nouveau type de société dans laquelle une « sphère économique » fonctionne de manière autonome en déterminant la vie du corps social : « Un processus qui s’autorenforce fut enclenché, au terme duquel le modèle autrefois inoffensif du marché a été transformé en une monstruosité sociale. » Une des conséquences brutales – et inédite – de ce bouleversement fut de faire de l’homme et de la nature des marchandises : « En achetant et en vendant librement le travail et la terre, on leur imposa le mécanisme de marché. » La nouveauté du capitalisme libéral est ainsi d’immerger la société dans la sphère économique, notamment, via l’organisation de la production, en transformant deux motivations humaines essentielles – la faim (chez le travailleur) et le gain (chez l’employeur) – en des motivations d’ordre purement économique. Partant, il créa l’illusion que le déterminisme économique était une loi générale pour toute les sociétés humaines.
Or, cette idée est mensongère car c’est oublier que l’homme possède bien d’autres motivations majeures (traditions, devoirs publics, engagement personnel, pratiques religieuses, obligations juridiques, sens de l’honneur, respect de soi, etc.) et qu’en général « l’économie de l’homme est immergée dans ses relations sociales ». Dans le système mercantiliste, par exemple, le travail et la terre étaient réglementés par des institutions publiques, des coutumes, des décrets, des guildes, etc. s’inscrivant dans le système organique de la société.
Remontant plus avant, Polanyi cite plusieurs travaux en économie des sociétés primitives (Bronislaw Malinowski, Richard Thurnwald, Herskovits…) détruisant le mythe du sauvage individualiste, de sorte que « l’idée qu’on puisse rendre universelle la motivation du profit ne traverse à aucun moment l’esprit de nos ancêtres ». L’étude de l’anthropologie sociale contredit, par ailleurs, l’assertion d’une seule détermination économique qui supplanterais toutes les autres : « La créativité institutionnelle de l’homme n’a été suspendue que lorsqu’on a permis au marché de broyer le tissu social pour lui donner l’apparence uniforme et monotone de l’érosion lunaire ».
De fait, les déterminations des hommes étant multiples il serait possible de garantir de manière institutionnelle les libertés individuelles issues de l’économie de marché (liberté de conscience, liberté de parole, liberté de réunion et d’association…) tout en se débarrassant des libertés néfastes (liberté d’exploiter son prochain, liberté de réaliser des profits personnels sans retombées pour la société, liberté de s’accaparer les innovations techniques, liberté de spéculer sur les désastres sociaux ou les catastrophes écologiques…). Polanyi plaide, en somme, pour « la diversité retrouvée des motivations qui devraient inspirer l’homme concernant son activité quotidienne de producteur, pour la réabsorption du système économique dans la société et pour l’adaptation créatrice de nos modes de vie à un environnement industriel ».
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
19:21 Publié dans Economie, Politique | Tags : révolution industrielle, capitalisme libéral, ère de la machine, doctrine du laisser-faire, détermination économique, le comptoir, sylvain métafiot, le marché contre la société, la mentalité de marché est obsolète !, karl polanyi | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 25 octobre 2021
Le philosophe dans l’arène : Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ? de Gunter Anders

Philosophe allemand (puis autrichien) ayant traversé les pires décennies du Xxe siècle, Günther Anders (1902-1992) fut l’un des intellectuels engagés contre tous les systèmes d’oppression – en premier lieu le nazisme – les plus importants de son temps. Ses thèses sur les méfaits des nouvelles technologies, les manipulations de masse et la bombe atomique firent florès dans les sphères de gauche contestataires et technocritiques au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
Ce texte paru aux éditions Allia est extrait d’un livre d’entretiens réalisé par le journaliste Mathias Greffrath en 1977 avec diverses personnalités ayant fuit l’Allemagne en 1933 lorsque l’air y était devenu proprement irrespirable. Anders y retrace son parcours intellectuel, les cours suivis auprès de Husserl et Heidegger (dont il lui reprocha ses préjugés racistes ainsi que sa conception « végétale » de l’individu), sa vie en compagnie d’Hannah Arendt, son amitié avec Brecht qui lui trouva un emploi dans un journal viennois, ses relations avec Stefan Zweig et Alfred Döblin lors de sa fuite à Paris, etc.
Se remémorant la période sombre de l’Allemagne, il commence par expliquer que « L’un des principes de la politique du Führer national-socialiste était de faire disparaître toute trace de conscience de classe ». Pour cela, le régime offrait aux prolétaires et autres victimes du système, outre le statut d’aryens, des boucs-émissaires sur lesquels reporter leurs frustrations et leurs haines : les Juifs. Cette instrumentalisation laissait croire aux esclaves qu’ils étaient des seigneurs au lieu de se liguer contre le véritable oppresseur. Cet antisémitisme d’État ayant cumulé dans l’extermination de masse des Juifs d’Europe.
Exilé aux États-Unis avec ses compatriotes de l’École de Francfort (Adorno, Marcuse, Horkheimer) il donne des cours à la New School for Social Research, analysant des lieder de Schubert ou des peintures de Rembrandt devant des étudiants principalement obsédés par les concepts psychanalytiques. Il déplore cependant le vide de culture générale chez les universitaires du pays : « Là-bas, on n’était reconnu comme quelqu’un de sérieux que si, en dehors d’une seule spécialité très pointue, on ne savait rien. Le manque de culture générale était un critère de sérieux. Nos idiots de spécialistes européens font vraiment figure d’esprits universels, à côté. »
Dans un passage éclairant, il relate notamment les quatre césures qui ont fractionnées sa vie et l’on contraint, moralement, à s’engager politiquement : la Première Guerre mondiale à l’âge de quinze ans ; l’arrivée d’Hitler au pouvoir ; l’annonce des camps de concentration ; la bombe larguée sur Hiroshima, enfin, dont la monstruosité lui fit perdre ses mots d’écrivain. Devant ce fait nouveau que « l’humanité était devenue capable, de manière irréversible, de s’exterminer elle-même », le philosophe considère que la faute majeure réside dans le manque d’imagination, dans ce décalage entre notre capacité de production (le Zyklon B, les armes nucléaires) et notre capacité d’imagination (le génocide des Juifs d’Europe, la destruction du monde) : « Même si l’imagination reste seule insuffisante, entraînée de façon consciente elle saisit infiniment plus de ‘vérité’ que la ‘perception’. »
Et devant la menace imminente de la bombe atomique, Anders (qui, dans cette optique précise, se revendiquait comme un « conservateur au sens authentique ») considère, à l’instar d’Albert Camus, que la tâche première n’est pas tant de transformer le monde que de le préserver. « Ensuite, nous pourrons le transformer, beaucoup, et même d’une façon révolutionnaire. »
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
12:50 Publié dans Politique | Tags : nazisme, bombe atomique, ecole de francfort, le comptoir, sylvain métafiot, le philosophe dans l’arène, et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ?, gunter anders | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 10 mai 2021
L’art et la manière : L’Empire du non-sens de Jacques Ellul

Publié une première fois en 1980, L’Empire du non-sens de Jacques Ellul reparaît dans la collection Versus, dirigée par Patrick Marcolini, et agrémenté d’une préface inédite de notre camarade Mikaël Faujour. À travers une critique sociale, culturelle et anthropologique il énonce une thèse simple : l’art du XXe siècle — qu’il s’en défende ou qu’il le revendique, qu’il en soit conscient ou ignorant — est tout entier soumis au règne de la Technique, évacuant toute notion de beau, d’histoire, de sujet, d’agrément, de vie et donc de sens. Et « éliminer le sens de l’art, c’est en réalité éliminer le « pourquoi jusqu’ici l’homme a vécu ». C’est effectivement éliminer l’homme. »
Pour Ellul, le monde technicien tel que nous le vivons aujourd’hui est sans commune mesure avec les siècles précédents, englobant quasiment tous les domaines de la vie en société. De fait, l’artiste et les conditions de la « création artistique » n’échappent pas à ce nouvel état des choses. Quel sens peut donc bien avoir l’art moderne dans cette situation ? Ellul précise qu’il ne cherche pas à « montrer ce qui détermine l’art moderne, mais [à] expliquer pourquoi il est ce qu’il est ». Entre autres bouleversements, la Technique moderne a réduit l’invention esthétique à un simple « jeu parfaitement gratuit, allusif et individualiste » sans se référer à un système symbolique commun, une expérience commune : « L’œuvre de l’Art moderne est de procéder à la rupture radicale entre ces informations indépendantes spécifiques du signe, et le message, qui à la limite doit être exclu. » On supprime donc tout message et toute signification à l’œuvre (considérations d’un autre temps) mais les artistes l’accompagne, paradoxalement, d’une kyrielle d’explications en tout genre « sur leurs intentions, leurs idées, leurs proclamations ». Ellul cite à ce propos le critique Leonid Andreev qui affirmait en 1967 dans la Literatournaya Gazeta, à propos du groupe Tel Quel : « L’art devient le privilège de techniciens experts. On s’acharne à compliquer… L’œuvre se transforme en produit de laboratoire. » Le rapport au spectateur est ainsi biaisé car en faisant reposer la définition du beau (tout du moins de la redéfinition de ce que les artistes contemporains nomment « le beau ») sur un plébiscite (le public doit adhérer massivement) on substitue le critère démocratique par le critère technicien : « est validé ce qui réussit, exclusivement. »
Pour Ellul, la revendication de la liberté absolue de l’artiste qu’implique le mot d’ordre « tout est possible, tout est permis » n’est qu’un mépris envers le spectateur car celui-ci n’a pas les codes pour comprendre la démarche du créateur et les logiques complexes qui structurent son œuvre. De même que l’hypocrisie des artistes révolutionnaires subventionnés, en réalité en parfait accord avec les structures capitalistes de la société : « Fêté par toutes les autorités, décoré de toutes les récompenses, admis par tous les régimes, il déclare paisiblement qu’il faut mettre la subversion partout. » Excluant le processus de symbolisation et de distanciation présent dans l’art classique, la Technique produirait ainsi « un tout idéologique à l’égard duquel l’homme ne peut plus prendre aucune distance ».
Néanmoins — et c’est, avec sa manie de rabâcher, le principal reproche que nous pouvons lui faire — « la Technique » que Jacques Ellul brandit à longueur de pages comme un mantra explicatif de la perte de sens généralisée ressemble davantage à un « gros concept » un peu balourd et systématique (pour reprendre les mots de Deleuze) qu’à la pièce majeure d’un engrenage dont les différentes strates du mécanisme auraient gagnées a être démontées avec un peu plus de nuance (tous les artistes modernes et contemporains sont, à titre d’exemple, mis dans le même sac sans discernement). Si la plupart de ses critiques font mouche, certains emportements contre l’ordinateur, la vidéo et le hi-fi font lever les yeux au ciel, de même que nombre de jugements de valeurs à l’emporte-pièce et, pire, des formules définitives qui sacrifient la rigueur analytique sur l’autel de la grandiloquence apocalyptique : « La peinture, la musique sont mortes (comme aussi la philosophie !) et nous faisons autre chose, qui n’a plus rien à voir avec la parole mais qui dérive exclusivement des moyens d’action. Le logos, la parole sont finis. […] Dans l’état actuel, il n’y a aucune issue ni pour l’art ni pour l’homme. »
Reste à savoir si cette analyse demeura pertinente dans les décennies à venir (notamment du fait de l’expansion de l’utilisation de la réalité virtuelle dans les installations muséales, de l’indévissable fait du prince du ministère de la Culture et de la bonne santé boursière des stars de l’art contemporains). Mais davantage que la soumission à la « Technique », c’est l’asservissement à une nouvelle forme de politiquement correct issu d’une certaine gauche moralisatrice qui menace aujourd’hui la liberté artistique (voire à ce sujet les travaux de Carole Talon-Hugon et d’Isabelle Barbéris). En ce sens, cette sentence de Michel Tournier, cité dans l’essai, n’a peut-être jamais semblée aussi juste : « Si par malheur l’avant-garde devait assumer une fonction politique, elle ferait régner la terreur la plus réactionnaire au nom de la révolution. Cela s’est vu. Cela se voit encore. »
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
12:40 Publié dans Littérature, Politique | Tags : mikaël faujour, leonid andreev, tout est permis, sylvain métafiot, le comptoir, l’art et la manière, l’empire du non-sens, jacques ellul | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 12 avril 2021
L’individu et le sacré : Destin de l’homme dans le monde actuel de Nicolas Berdiaeff

Poursuivant son travail d’analyse critique du monde moderne, le philosophe russe Nicolas Berdiaeff examine ici la place de l’homme sous l’autoritarisme montant des régimes politiques européens dans les années 1930 (l’ouvrage date de 1936). En scrutant particulièrement les coups de boutoir incessants de l’Allemagne nazie et de la Russie soviétique, il fait le constat amer un double mouvement, l’un entraînant l’autre dans sa chute : la déshumanisation des hommes et le déclin de la spiritualité. Ce n’est plus la liberté qui guide les hommes mais la contrainte policière, la servitude collective, la discipline matérialiste. Submergée par la propagande des concepts de race, de nationalité, de sens de l’histoire, de culture de masse ainsi que par un arsenal de techniques nouvelles, la dignité humaine se dissout dans le bain de sociétés impersonnelles et tyranniques. « C’est avec une grande facilité que la masse se prête à la suggestion et tombe à l’état de possession collective », analyse-t-il en constatant que l’Allemagne hitlérienne et la Russie communiste, à défaut de pain, gavent leurs citoyens de spectacles autant que de haine en agitant les spectres du Juif, du sous-homme, de l’ennemi de classe ou du saboteur.
Si la conscience morale personnelle est remplacée par une conscience collective, enrégimentée et militaire, il rappelle que « l’homme a toujours eu des instincts grégaires » et que seule une minorité a été capable de pensée originale personnelle et créative. D’où sa déploration du système démocratique formel qui reproduit les façons de penser routinières et moyennes des individus. Partant, opposer fascisme et démocratie lui semble superficiel si l’on considère le régime fasciste comme « la mise à jour de la dialectique démocratique », voire, en poussant le bouchon plus loin, « le résultat de la doctrine de la souveraineté du peuple de Jean-Jacques Rousseau ». Pour Berdiaeff, le caractère sacré et infaillible de la volonté du peuple souverain est un mythe analogue au mythe marxiste de la sainteté et de l’infaillibilité du prolétariat.
Défenseur d’une conception aristocratique de la culture Berdiaeff fustige par ailleurs le nationalisme en tant que « culte paien de la race, mais aussi une dévotion idolâtre envers le pouvoir », imposant un art officiel : « On ne peut pas créer consciemment et sur commande un art ou une philosophie nationale, il faut aimer la vérité, la connaissance, la beauté pour elles-mêmes. » Mais Berdiaeff s’en prend aussi aux chrétiens, responsable de la dé-spiritualisation du monde. La doctrine chrétienne de justice universelle ayant trop souvent été dénaturée par des institutions cléricales véreuses et des fanatiques intolérants ennemis de la science et du progrès, et professant davantage l’amour de Dieu que l’amour des hommes. En adoptant une attitude cruelle et inhumaine, le christianisme s’est aliéné les oppressés, les travailleurs et tous ceux cherchant à bâtir un ordre social plus juste et plus humain. En somme, « On est parvenu à rendre le christianisme ‘bourgeois’ ». Attaché à l’église orthodoxe russe, Berdiaeff estime pourtant que seule une renaissance religieuse peut permettre à l’homme de se régénérer sans sombrer dans la bestialité. La révolution qu’il appelle de ses vœux (un « socialisme personnaliste ») est donc spirituelle et morale et devra « placer la personne humaine au-dessus des idoles de la production et de la technique ». Néanmoins, et c’est essentiel, cette renaissance spirituelle sera conditionnée par l’abolition première de la misère sociale et l’esclavage économique de l’homme.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
13:41 Publié dans Littérature, Politique | Tags : fascisme, allemagne nazie, russie soviétique, déshumanisation des hommes, déclin de la spiritualité, le comptoir, sylvain métafiot, l’individu et le sacré, destin de l’homme dans le monde actuel, nicolas berdiaeff, philosophe russe | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 23 novembre 2020
La mystique appelle la mécanique : La petite peur du vingtième siècle d'Emmanuel Mounier

lundi, 09 novembre 2020
Le progrès incertain : l’idée de révolution selon Kant et Volney

Alors que le XVIIIe siècle finissant est parcouru des soubresauts de la Révolution française, le comte Volney, philosophe, député et orientaliste français, ainsi que le philosophe allemand Emmanuel Kant élaborent des théories sur le caractère nécessaire, mais parfois funeste, des révolutions, à la croisée des passions naturelles, de la morale et du droit rationnel.
Une première caractérisation de la révolution revient à la distinguer de la révolte et de la réforme. Ces trois termes entretiennent un rapport intime avec l’idée de progrès. On propose de se révolter, de réformer ou d’opérer une révolution dès lors que l’on considère l’insuffisance et l’injustice de la situation actuelle, et que l’on juge nécessaire de la modifier. (Ou plutôt ce sont les défauts de la situation actuelle qui déclenchent une envie de révolte, de révolution ou de réforme). Ceci vaut bien sûr dans le domaine politique, mais aussi, dans une certaine mesure, dans le domaine scientifique et même philosophique (certains proposant une réforme de l’entendement, d’autres plutôt une révolution dans la manière de penser).
À première vue, la révolution semble se rapprocher davantage de la réforme par son souci de transformation effective et (donc) collective du monde. La révolte, elle, se caractérise par une indignation morale et individuelle. En un sens, elle est simplement critique et demeure en quête de prolongement dans l’action. Se révolter, ce n’est pas encore agir. Il s’agit plutôt d’un sursaut existentiel circonscrit dans l’intimité de la conscience individuelle. Et lorsque la révolte devient visible, elle se fait insurrection, contestation, protestation, elle prend la forme de l’opposition opiniâtre mais sans déboucher sur une transformation pratique du monde. Elle fait figure d’opposition critique, mais son efficacité politique semble moindre que celle que permet la révolution.
La révolution ainsi semble se situer entre la révolte et la réforme, ou plutôt au-delà de ces deux formes d’action politique, puisqu’elle concilie l’intransigeance de la première et le souci d’efficacité de la seconde, se présentant ainsi comme la voie la plus tentante sur le chemin du progrès.
10:05 Publié dans Politique | Tags : le conflit des facultés, vers la paix perpétuelle, qu’est-ce que les lumières ?, les ruines ou méditation sur les révolutions des empires, le comptoir, sylvain métafiot, le progrès incertain, l’idée de révolution selon kant et volney, révolte, réforme, 1789 | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 09 octobre 2020
L’esprit de gramophone : L’Empêchement de la littérature de George Orwell

Sous-titré Sur la liberté d’expression et de pensée, ce petit texte de George Orwell, paru initialement en 1946, semble tomber à pic à une période où l’invective, la mauvaise foi et le complotisme remplacent le plus souvent la discussion cordiale et l’échange d’arguments raisonnés. On imagine non sans peine le romancier britannique horrifié s’il avait connu Twitter, Facebook ou les plateaux télés de CNews. Effrayé, il le fut en observant de quelle façon ses contemporains (journalistes, politiciens et romanciers) se pâmaient devant l’URSS, encore toute auréolée de sa victoire sur l’Allemagne nazie, n’hésitant pas à travestir (voire à nier) la réalité du totalitarisme soviétique au point de menacer « au long terme tous les domaines de la vérité ».
C’est lors d’un événement du PEN Club, organisé à l’occasion du tricentenaire de L’Areopagitica de Milton, qu’Orwell a pu constater le gouffre béant entre les grands principes proclamés sur la liberté d’expression et la réalité des interventions vantant les bienfaits de la censure en Union Soviétique : « Les ennemis déclarés de la liberté sont ceux pour qui la liberté devrait être la plus importante ». Car après avoir défendu la liberté de pensée contre les catholiques et les fascistes, c’est désormais contre les communistes qu’Orwell ferraille. Et quiconque tente de mettre en avant la réalité objective des faits (procès iniques, surveillance généralisée, déportation d’opposants politique, culte du chef, etc.) se voit accusé d’esprit « petit bourgeois », « d’individualisme libéral », de « romantique », de « sentimental » ou encore de « faire le jeu » des forces conservatrices. Le romancier britannique n’est pourtant pas un de ceux qui pratiquent la « fuite » : « La littérature authentiquement apolitique n’existe pas, et encore moins à une époque comme la nôtre, où les peurs, les haines, les fidélités d’une nature directement politique se trouvent aux abords de la conscience de tout un chacun. »
Mais à côté des « ennemis théoriques » de la liberté de penser (« ceux qui tressent des louanges au totalitarisme ») se trouvent les « ennemis concrets », c’est-à-dire ceux qui monopolisent les médias, journaux, radios et cinéma, ainsi que la bureaucratie. De fait, si un certain fanatisme militant – prompt à s’indigner, vitupérer et censurer au nom du Bien – a toujours trait dans les cercles intellectuels aujourd’hui (« L’attaque directe, délibérée contre la décence intellectuelle provient des intellectuels eux-mêmes » rappelle Orwell), une autre posture, tout aussi inepte, se développe en parallèle : celle qui affirme sans nuance que l’« on ne peut plus rien dire ! », paradoxalement répétée en boucle sur des ondes à tendance réactionnaire et dans des journaux « dissidents ». Une résistance cosmétique au politiquement correct qui se contente de singer la rhétorique de l’adversaire en inversant paresseusement les thèmes. Pas sûr que le socialiste Orwell – dont se réclament nombre de ces « résistants » – ait applaudi à cette rengaine moutonnière, lui qui affirmait que « le remplacement d’une orthodoxie par une autre n’est pas nécessairement un progrès. Le véritable ennemi, c’est l’esprit réduit à l’état de gramophone, et cela reste vrai que l’on soit d’accord ou non avec le disque qui passe à un certain moment. » (Essais, articles, lettres – Volume 3)
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
10:01 Publié dans Littérature, Politique | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, l’esprit de gramophone, r&n éditions, l’empêchement de la littérature de george orwell, liberté d'expression, liberté de pensée, urss, pen club, propagande, politiquement correct, censure | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 22 mai 2020
Adolf Eichmann, l’obéissance de cadavre

Article initialement publié sur Le Comptoir
Le 75e anniversaire de la libération du camp d’extermination d’Auschwitz nous donne l’occasion de revenir sur la notion, si célèbre et souvent galvaudée, de « banalité du mal » établie par la philosophe Hannah Arendt dans son ouvrage « Eichmann à Jérusalem ». Ce concept désigne une capacité à commettre des crimes (parfois monstrueux) qui n’est ni exceptionnelle ni pathologique, mais provient d’un effacement radical de la personnalité et d’une obéissance aveugle à l’autorité.
 En 1963, Hannah Arendt est engagée par The New Yorker pour suivre le procès du criminel nazi Adolf Eichmann à Jérusalem. Le livre qu’elle en tire, Eichmann à Jérusalem, est sous-titré Rapport sur la banalité du mal. Elle n’emploie pourtant cette notion que dans une seule occurrence, hautement évocatrice. Ayant rapporté, de façon presque sarcastique, les paroles creuses et toutes faites du condamné avant sa pendaison – jusqu’alors, il ne pouvait se défaire des stéréotypes d’un langage qui le coupait de la réalité – elle conclut par ces mots : « Comme si, en ces dernières minutes, il résumait la leçon que nous a apprise cette longue étude sur la méchanceté humaine – la leçon de la terrible, de l’indicible, de l’impensable banalité du mal. »
En 1963, Hannah Arendt est engagée par The New Yorker pour suivre le procès du criminel nazi Adolf Eichmann à Jérusalem. Le livre qu’elle en tire, Eichmann à Jérusalem, est sous-titré Rapport sur la banalité du mal. Elle n’emploie pourtant cette notion que dans une seule occurrence, hautement évocatrice. Ayant rapporté, de façon presque sarcastique, les paroles creuses et toutes faites du condamné avant sa pendaison – jusqu’alors, il ne pouvait se défaire des stéréotypes d’un langage qui le coupait de la réalité – elle conclut par ces mots : « Comme si, en ces dernières minutes, il résumait la leçon que nous a apprise cette longue étude sur la méchanceté humaine – la leçon de la terrible, de l’indicible, de l’impensable banalité du mal. »
D’aucuns ont reproché à Arendt son ton et son ironie à l’égard d’un homme que l’on aurait pu croire animé par les plus féroces appétits de la haine et de la cruauté, mais elle touchait juste : aux yeux de tous, Eichmann est apparu comme une personnalité ordinaire, fade et insignifiante, une espèce de marionnette tragi-comique dans son inconsistance et que rien n’aurait conduit à prendre au sérieux s’il n’avait été l’un des principaux organisateurs de la Solution finale (« Endlösung« ). C’est cet écart effrayant entre la médiocrité de l’homme et la monstruosité de ses crimes que désigne la « banalité du mal ».
mardi, 04 février 2020
Nietzsche contre la culture barbare
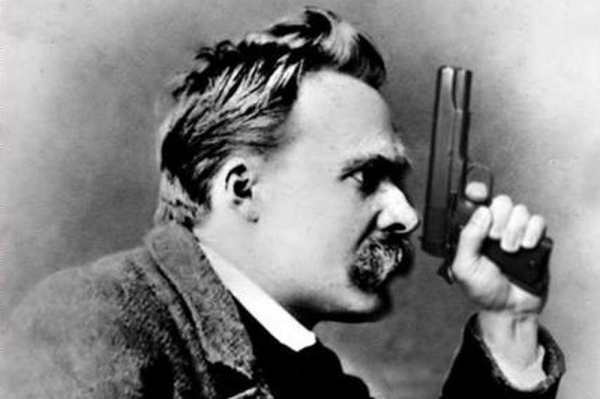
Article initialement paru sur Le Comptoir
Rédigée en 1873 à Bâle, et sous-titré « De l’utilité et de l’inconvénient des études historiques pour la vie », la « Seconde Considération Inactuelle » fait partie d’une série de quatre traités polémiques dans lesquels le philosophe Friedrich Nietzsche parcourt l’échelle de ses intimités. Il combat une conception purement contemplative du savoir historique conçue comme une fin en soi et découplée de la vie. Pour lui, la connaissance doit permettre de vivre et d’agir.
Ce que son époque considère comme une vertu Nietzsche le considère comme un vice : « nous souffrons tous d’une consomption historique ». Dénonciateur autant que guérisseur, il souhaite ainsi renverser le courant, « contre le temps, et par là même sur le temps en faveur d’un temps à venir ».
« Je déteste tout ce qui ne fait que m’instruire sans augmenter mon activité. » Goethe
Le poids du passé
Le premier paragraphe de la Seconde Considération Inactuelle porte sur l’ambivalence du passé. D’un coté, le passé pèse sur l’homme comme un fardeau invisible parce qu’il s’en souvient, c’est la mémoire qui signe sa prégnance à force de le ruminer. Cette charge nuit à l’homme et l’anéantit car le ressassement empêche l’action : plongés dans nos regrets nous délaissons l’avenir. D’un autre coté, l’oubli est une condition de l’action et du bonheur car agir suppose être dans le présent et orienté vers le futur. Dans ce cas, le passé peut peser comme un acquis.
21:37 Publié dans Littérature, Politique | Tags : nietzsche contre la culture barbare, le comptoir, sylvain métafiot, seconde considération inactuelle | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 17 novembre 2019
Carole Talon-Hugon : « Une œuvre peut être admirable en dépit d’un défaut éthique »

Article initialement publié sur Le Comptoir
Carole Talon-Hugon est philosophe, spécialiste d’esthétique, de philosophie de l’art et de théories des émotions. Directrice de publication de la Nouvelle revue d’esthétique et directrice de rédaction de la revue Noesis elle a notamment rédigé « Une histoire personnelle et philosophique des arts » en quatre volumes. Elle vient de publier « L’Art sous contrôle » (PUF), un essai court et documenté qui analyse la nouvelle injonction moralisatrice, se déployant de manière intégriste dans le monde de la culture, à l’aune du « nouvel agenda sociétal » et des « censures militantes ».
Le Comptoir : Ces dernières années, on voit surgir de plus en plus de demandes de boycott de tel film ou de tel réalisateur, de destruction de peintures ou de décrochage photos, de protestation contre des rétrospectives, de censure envers des installations, de pétition contre tel artiste, etc. au nom des combats sociétaux de l’époque (féminisme, combat LGBT, écologie, lutte postcoloniale…). Il semble pourtant qu’une grande partie des artistes d’aujourd’hui se revendiquent de ces engagements. Pourquoi une telle confrontation ?
 Carole Talon-Hugon : Il s’agit là de deux aspects du moralisme ambiant dans lequel se trouvent actuellement plongés les mondes de l’art : d’un côté des artistes affichant l’engagement de leurs œuvres dans des causes sociétales, de l’autre, des critiques militantes émanant des communautés réunies autour de ces mêmes causes, et visant des œuvres qu’elles jugent offensantes. Il y a moins là une contradiction que le recto et le verso d’une même pièce, les œuvres visées par la censure militante n’étant pas celles produites par l’art sociétal. Mais paradoxalement, il arrive que des œuvres affichant des intentions sociétales soient elles-mêmes contestées ; c’est par exemple le cas de la pièce Kanata de Robert Lepage, qui met en scène les Amérindiens du Québec et qui s’est vue accusée d’appropriation culturelle par les descendants de ceux-ci au motif que les rôles d’Amérindiens n’étaient pas jouées par des Amérindiens ; ou bien encore le cas de Scarlett Johansson qui a dû renoncer à jouer le rôle d’un transgenre après qu’on lui a reproché de n’en être pas un.
Carole Talon-Hugon : Il s’agit là de deux aspects du moralisme ambiant dans lequel se trouvent actuellement plongés les mondes de l’art : d’un côté des artistes affichant l’engagement de leurs œuvres dans des causes sociétales, de l’autre, des critiques militantes émanant des communautés réunies autour de ces mêmes causes, et visant des œuvres qu’elles jugent offensantes. Il y a moins là une contradiction que le recto et le verso d’une même pièce, les œuvres visées par la censure militante n’étant pas celles produites par l’art sociétal. Mais paradoxalement, il arrive que des œuvres affichant des intentions sociétales soient elles-mêmes contestées ; c’est par exemple le cas de la pièce Kanata de Robert Lepage, qui met en scène les Amérindiens du Québec et qui s’est vue accusée d’appropriation culturelle par les descendants de ceux-ci au motif que les rôles d’Amérindiens n’étaient pas jouées par des Amérindiens ; ou bien encore le cas de Scarlett Johansson qui a dû renoncer à jouer le rôle d’un transgenre après qu’on lui a reproché de n’en être pas un.
21:24 Publié dans Littérature, Politique | Tags : carole talon-hugon, le comptoir, sl'art sous contrôle, censure, féminisme, injonction moralisatrice, ylvain métafiot | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 03 juillet 2019
Extinction programmée : Un monde en voie de disparition, les paysans

Article initialement publié sur Le Comptoir
Après un 1er numéro s’attaquant à « La French Theory et ses avatars » (2009), un 2e analysant la domination de « La culture de masse » (2011) et un 3e numéro consacré à l’étrange fascination qu’exerce le philosophe Martin Heidegger (2012), l’excellente revue {L’Autre Côté} revient enfin dans les librairies avec une 4e publication se posant la question suivante : que reste-t-il du monde paysan français au XXIe siècle ? Et peut-on encore parler de paysans ? La campagne – pour reprendre le titre d’un des articles – existe-t-elle encore en France ou est-elle dévorée par l’extension des zones pavillonnaires ?
Sous l’égide de Bernard Charbonneau et d’Henri Mendras, Séverine Denieul rappelle, dans son éditorial, que « c’est l’abandon de ce qui avait constitué, pendant des millénaires, l’univers paysan qui lui a fait perdre son identité, à savoir, principalement, sa relation avec la terre et les animaux domestiques ». Le XXe siècle a été celui de la lente désintégration du monde agricole : en France, « en 1911, la population vivant de l’agriculture représentait 38 % de la population totale (soit 32 millions d’habitants) tandis que la population rurale était estimée à 22,1 millions (soit 56 % de la population) ; en 2015, les agriculteurs n’étaient déjà plus que 710 000, soit 1 % de la population. »
S’en suivent une réflexion de l’écrivain Marc Badal sur la signification de l’expression « mondes paysans » et de la perte de toutes les connaissances, coutumes et valeurs que la disparition de cette antique société entraîne ; une analyse de Jocelyne Porcher (auteur de Vivre avec les animaux, 2011) concernant l’élevage en France à rebours du mouvement vegan ; l’entretien avec deux éleveurs du Cantal, Pierre-Jean Mazel et Jérôme Planchot, ainsi que l’interview de Xavier Noulhianne, éleveur-fromager très au fait de l’évolution des normes sanitaires et de l’agriculture biologique. Emmanuel Ferrand aborde quant à lui le secteur de l’agriculture urbaine à travers son expérience au sein de l’association La Générale (Paris 11e). Enfin, Emmanuel Boussuge nous fait parcourir, photos à l’appui, la vallée de Brezons dans laquelle nombre de linteaux témoignent d’un art populaire et rural encore vivant.
Sylvain Métafiot
16:30 Publié dans Actualité, Politique | Tags : bernard charbonneau, henri mendras, séverine denieul, extinction programmée, un monde en voie de disparition, les paysans, le comptoir, sylvain métafiot, revue l’autre côté | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 21 mai 2019
L’humanisme italien et la genèse du capitalisme

Article initialement publié sur Le Comptoir
Dans le domaine de la recherche historiographique du XXe siècle, les notions d’humanisme, de républicanisme et de renaissance ont toutes trois été liées à la thèse suivante : l’élaboration d’une pensée politique centrée sur l’homme, la liberté politique comme participation au bien commun. À travers les travaux d’historiens tels que Jacob Burckhardt, Max Weber, Werner Sombart, Hans Baron ou John Pocock, se déploie ainsi la question de l’apparition de la modernité européenne et des origines du capitalisme.
Le terme d’humaniste était employé couramment dès le XVIe siècle, tandis que l’humanisme apparaît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en Allemagne, et en France grâce à Jules Michelet. Cette notion correspondait à une période d’émancipation de la pensée qui contestait l’hégémonie de la religion.
La Renaissance et les idéaux culturels du XIXe siècle
Dans l’historiographie germanophone, l’œuvre de l’historien et philosophe Jacob Burckhardt a eu une influence énorme sur la manière de se représenter l’Italie, notamment à travers trois ouvrages importants : L’Époque de Constantin le grand (1853) ; Guide de l’art antique et de l’art moderne en Italie (1855) ; La Civilisation de la Renaissance en Italie (1860). Dans ce dernier, celui qui nous intéresse, il cherchait à définir l’attitude des hommes, à une certaine époque, devant le monde, souhaitant isoler un moment particulier de l’esprit humain. Il passe ainsi en revue des thématiques telles que : l’État considéré comme œuvre d’art, le développement de l’individu, la résurrection de l’Antiquité, la sociabilité et les fêtes, les mœurs et la religion.
16:08 Publié dans Politique | Tags : historiographie, le comptoir, sylvain métafiot, l’humanisme italien et la genèse du capitalisme, jacob burckhardt, max weber, werner sombart, hans baron, john pocock | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 14 mai 2019
L’éternité retrouvée : Camus, l’éternité est ici de Youness Boussena

Article initialement publié sur Le Comptoir
Il n’est sans doute pas facile d’écrire sur un écrivain aussi célèbre et aimé qu’Albert Camus. Beaucoup de simplifications ont été faites sur sa pensée, beaucoup de bêtises ont été prononcées sur son œuvre. On cite souvent les mêmes extraits (parfois tronqués) de ses ouvrages, on mentionne les mêmes anecdotes à propos de sa vie personnelle, on le range vite fait dans la case floue des existentialistes et le tour est joué…
Youness Bousenna évite avec bonheur tous ces écueils et propose dans ce court essai de redécouvrir l’intensité d’une « pensée forgée sous le soleil de la mer Méditerranée, puisée dans la beauté de ses paysages comme dans la sagesse des vieux Grecs, [et qui] fut d’abord celle d’un jeune homme qui chercha comment vivre, aimer et mourir ». En à peine 120 pages est condensée la vie d’un homme paradoxal mais intègre et qui, à travers ses articles, ses romans, ses essais et ses pièces de théâtre, n’aura eu de cesse de dire “non” à la barbarie de son temps (la misère en Kabylie, la violence terroriste, la collaboration, le nihilisme érigé en dogme, l’horreur totalitaire, la bombe atomique, la mécanisation du monde, la perte de la beauté…), et de clamer “oui” à la joie simple et profonde d’être sur terre, de bénir le soleil et la nuit, de vivre chaque jour comme si c’était le premier et de l’éternel retour à l’amour.
Du quartier pauvre de Belcourt à Alger à la remise du prix Nobel de littérature en 1957, en passant par le maquis de la Résistance et des conférences aux États-Unis, des voyages en Grèce et au Brésil, c’est un homme étreint par le sens de la justice et la dignité de l’être humain qui bâtit une réflexion en trois temps autour des notions d’absurde, de révolte et d’amour (ce dernier cycle n’ayant pu voir le jour suite à sa mort accidentelle en 1960). Et, si la plupart de ses ouvrages furent des succès de librairies, il ne fut pas à l’abri de certaines critiques acerbes (Youness Bousenna rappelle la polémique l’opposant à Sartre lors de la parution de L’homme révolté et de la profonde perte de confiance qui en résultera). Camus put néanmoins compter sur le soutien et l’amitié d’êtres chers : son instituteur Louis Germain, son maître Jean Grenier, son ami René Char. Lui qui affirmait ne pas pouvoir « vivre longtemps avec les êtres », réclamant « un peu de solitude, la part d’éternité » en revenait toujours à l’amour comme Ulysse revenait à Ithaque, bouclant la boucle à travers la pensée de midi, celle des paysages brûlants de la mer et du ciel réunis, goûtant enfin à « la joie tragique de vivre ».
Sylvain Métafiot
13:12 Publié dans Littérature, Politique | Tags : le comptoir, youness bousenna, albert camus, sylvain métafiot, l’éternité retrouvée | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 20 avril 2019
La pureté et la mort

HOEDERER
Pourquoi es-tu venu chez nous ? Si on n'aime pas les hommes, on ne peut pas lutter pour eux.
HUGO
Je suis entré au Parti parce que sa cause est juste et j'en sortirai quand elle cessera de l'être. Quant aux hommes, ce n'est pas ce qu'ils sont qui m'intéresse mais ce qu'ils pourront devenir.
HOEDERER
Et moi je les aime pour ce qu'ils sont. Avec toutes leurs saloperies et tous leurs vices. J'aime leurs voix et leurs mains chaudes qui prennent et leur peau, la plus nue de toute les peaux, et leur regard inquiet et la lutte désespérée qu'ils mènent chacun à son tour contre la mort et contre l'angoisse. Pour moi, ça compte un homme de plus ou de moins dans le monde. C'est précieux. Toi, je te connais bien, mon petit, tu es un destructeur. Les hommes, tu les détestes parce que tu te détestes toi-même ; ta pureté ressemble à la mort et la Révolution dont tu rêves n'est pas la nôtre : tu ne veux pas changer le monde, tu veux le faire sauter.
HUGO, s'est levé
Hoederer !
HOEDERER
Ce n'est pas ta faute : vous êtes tous pareils. Un intellectuel, ça n'est pas un vrai révolutionnaire ; c'est tout juste bon à faire un assassin.
Jean-Paul Sarte, Les mains sales, Folio Gallimard, p. 200
14:44 Publié dans Littérature, Politique | Tags : la pureté et la mort, jean-paul sarte, les mains sales, révolution, assassin, intellectuel | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 04 février 2019
Le poète contre la terreur : Le Chaos de Pasolini
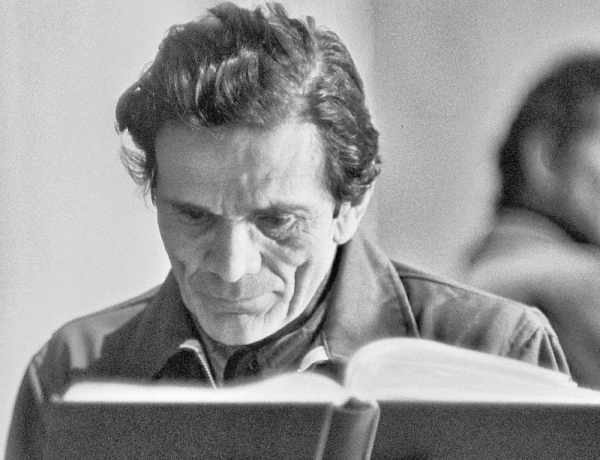
Article initialement publié sur Le Comptoir
On pensait avoir tout lu ou presque des essais politiques de Pasolini, porté au pinacle de la critique sociale des années 70 avec ses Écrits corsaires et ses Lettres luthériennes. Il faudra désormais compter avec Le Chaos, recueil inédit d’articles publié entre 1968 et 1970 dans l’hebdomadaire Tempo et judicieusement exhumé des limbes italiennes par la maison d’édition R&N, fidèle en cela à sa démarche salutaire de remettre au goût du jour les grandes œuvres oubliées du XXe siècle.
Politiquement inclassable – réactionnaire pour certains gauchistes bornés (voir la lettre qu’un « étudiant de gauche » lui envoie en 1969), communiste fanatique pour les droitards hargneux et geignards – Pasolini, indépendant et solitaire, indépendant parce que solitaire, s’en prend radicalement à cette nouvelle société de consommation encouragée par les tenants de l’ordre politique de droite comme de gauche, ce « cataclysme anthropologique » détruisant les cultures populaires, les anciens modes de vie, les dialectes locaux. Comme le remarque Olivier Rey dans la préface, « Pasolini a parfaitement saisi que si la droite, sous des oripeaux conservateurs, favorise le déracinement général en servant la dynamique capitaliste, la gauche, quand elle s’entête à combattre un conservatisme imaginaire, devient le meilleur allié de son ennemi. »
L’objectif qu’il se fixe à travers ces articles ? S’insurger « Contre la terreur », celle constitutive de l’autorité émanant aussi bien de la droite clérico-fasciste, des staliniens que de la nouvelle gauche (« le snobisme extrémiste de certains adeptes du Partis socialiste italien est la chose la pire qu’ait produit la bourgeoisie italienne au lendemain du fascisme ») et qui entraîne un vide spirituel autant qu’une fétichisation de la technique. Sa volonté ? Analyser sans complaisance, et avec violence, le mal bourgeois, cette « maladie très contagieuse » qui absorbe l’énergie vitale des citoyens italiens comme le vampire suce le sang de ses victimes. Mais chez Pasolini la tendresse est à un jet d’encre de la rage, et l’on trouvera également dans ce recueil foisonnant une lettre « pleine d’amertume » à Silvana Mangano, une autre à Anna Magnani à propos de la souffrance animale, un petit dialogue avec Alberto Moravia sur le rôle de la littérature et de l’engagement révolutionnaire, une lettre à Luchino Visconti à propos de son film Les Damnés, un portrait enjoué du cycliste Eddy Merckx, une analyse du film Partner de Bertolucci (« un nouveau type de cinéma »), un poème en faveur d’Aléxandros Panagoulis, une pensée, enfin, le jour de Noël, pour Régis Debray emprisonné en Bolivie.
Sylvain Métafiot
17:54 Publié dans Littérature, Politique | Tags : le poète contre la terreur, le chaos de pasolini, sylvain métafiot, le comptoir, r&n, fascisme, communisme | Lien permanent | Commentaires (0)










