« L’humanisme italien et la genèse du capitalisme | Page d'accueil | Extinction programmée : Un monde en voie de disparition, les paysans »
lundi, 24 juin 2019
À la recherche du paradis français d’Éric Rohmer

Article initialement publié sur Le Comptoir
Ancien rédacteur en chef des « Cahiers du cinéma », Éric Rohmer avait, comme nombre de ses camarades cinéphiles de l’époque (Rivette, Godard, Chabrol, Truffaut), franchi la barrière de la réalisation, fusionnant le stylo et la caméra en un style d’une singularité antique au sein de la Nouvelle Vague. Épris de culture classique, filmant – dans la lignée de Rossellini et Renoir – la vie sans artifices, il réalisa contes, proverbes et comédies d’une préciosité digne du Grand Siècle. « Un paradis français intellectuel, pour reprendre les mots d’Aurora Cornu, dans lequel les garçons et les filles discutent de livres ». Nous nous sommes entretenus avec deux éminents rohmériens, Ludovic Maubreuil et Pierre Cormary – contributeurs à l’ouvrage collectif « Le Paradis français d’Éric Rohmer »(éditions Pierre-Guillaume de Roux) – pour parcourir l’éden du plus moraliste des cinéastes français.
Le Comptoir : Quel a été votre premier contact avec le cinéma d’Éric Rohmer ?
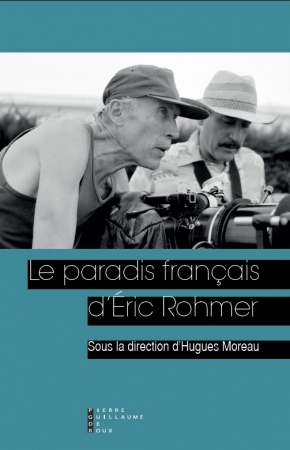 Ludovic Maubreuil : Je devais avoir quinze ans, à l’occasion de la sortie en salles de Pauline à la plage (1983). Ne connaissant ni les filles ni le bord de mer, les photos colorées, dans le hall du cinéma, m’avaient captivé. J’en étais ressorti à la fois ému et désappointé : j’aurais voulu vivre dans ce film, côtoyer ces corps-là, mais en même temps je comprenais que je n’avais pas les mots pour y parvenir.
Ludovic Maubreuil : Je devais avoir quinze ans, à l’occasion de la sortie en salles de Pauline à la plage (1983). Ne connaissant ni les filles ni le bord de mer, les photos colorées, dans le hall du cinéma, m’avaient captivé. J’en étais ressorti à la fois ému et désappointé : j’aurais voulu vivre dans ce film, côtoyer ces corps-là, mais en même temps je comprenais que je n’avais pas les mots pour y parvenir.
L’année suivante, des photos tout aussi aguicheuses me faisaient découvrir L’Année des méduses de Christopher Frank, à vrai dire bien plus simple à appréhender. C’étaient des corps aux postures sans équivoque, et des situations à ce point fabriquées que leur séduction ne pouvait qu’être à la fois violente et sans mystère. Il ne s’agissait que d’images filmées, qui ne m’incluaient en aucune manière dans leur récit. C’était finalement rassurant. Je me suis perdu pendant une dizaine d’années dans la sidération procurée par le cinéma formaliste, qui n’exigeait rien d’autre de moi que la reddition fascinée. Et puis j’ai vu un jour qu’Amanda Langlet, l’interprète de Pauline, était à l’affiche d’un autre film de jeunes filles et de bord de mer, et c’était Conte d’été (1996). J’y suis entré à tout hasard, mais cette fois je n’ai pas ressenti la frustration d’être mis à l’écart du film, car celui-ci peignait avec une évidence tranquille, l’aveuglant réalisme psychologique de ma propre existence ! La forme n’y cherchait pas à masquer quoi que soit, mais au contraire à porter avec le plus d’élégance possible, la vérité des sentiments, la justesse des interactions, l’authenticité du regard. C’est alors que je suis devenu rohmérien. J’ai tiré sur le fil de la vérité, comme dirait l’autre, et tout est venu ; je n’ai plus manqué un seul de ses films.
Pierre Cormary : Ce devrait être à l’époque de la sortie de Conte d’été en 1996, j’avais vingt-six ans. Je ne connaissais pas du tout Rohmer et en avais, par ouï-dire, une assez mauvaise opinion, celle d’un cinéma verbeux, artificiel, affreusement mal joué, avec des personnages imbuvables. Et puis, je suis tombé sur la bande-annonce de ce film et tout de suite j’ai été fasciné. Ces jeunes gens qui glosent sur la plage. Ces paroles qui semblent détachées de ceux qui les prononcent. Ce mélange de documentaire et de théâtre précieux. Quelque chose d’immanent, d’épiphanique, d’ultra-vrai se produisait sur l’écran. Je n’avais jamais vu ce genre d’image – ou mieux ce genre de paroles en images, car il s’agit bien de ça chez Rohmer : “voir la parole”. Je suis donc allé voir ce film et j’en suis ressorti comme un ado qui a vu un Spiderman et qui se dit que Spiderman, c’est lui. Gaspard (Melvil Poupaud), c’était moi, verbeux, artificiel, jouant mal mon propre rôle auprès des filles et peut-être imbuvable ! Dès lors, j’ai découvert ses autres films et me les suis tous appropriés. Il suffit que je revoie quelques images de l’un ou de l’autre pour me sentir immédiatement “chez moi”. Et pourtant, le sentiment d’étrangeté est resté jusqu’à aujourd’hui. Il y a quelque chose de très décalé, d’inconnu entre “lui” et “moi”. Comme si, même en le connaissant par cœur, on ne s’y habituait jamais. C’est le cinéma le plus proche et le plus lointain que je connaisse.

En 1945, Rohmer découvre les grands maîtres du cinéma muet : Griffith, Eiseinstein, Lang, Chaplin, Keaton, Murnau… Il consacrera même une thèse à ce dernier (L’Organisation de l’espace dans le Faust de Murnau). De quelle manière ces grands cinéastes, dont certains faisaient preuve d’emphase dans leurs réalisations, ont-ils eu une influence sur sa mise en scène sobre et pudique ?
Pierre Cormary : Oups ! Ça, c’est une question à laquelle j’espère Ludovic Maubreuil répondra mieux que moi. Car pour ma part, je ne vois pas vraiment d’influence entre ces gens-là et Rohmer. Buster Keaton, à la limite, car il y a chez les deux une sorte de “burlesque” amoureux et d’étrangeté au monde, avec un petit côté “soupirant qui ne rit jamais” (Melvil Poupaud dans Conte d’été donc, mais aussi Jean-Louis Trintignant dans Ma Nuit chez Maud ou le regretté Philippe Marlaud dans La Femme de l’aviateur – sauf exception, le héros rohmérien fait souvent la gueule). Mais il s’agit plus là d’une analogie de cinéphile que d’une influence d’un cinéaste à un autre. Non, Rohmer est dans la lignée des cinéastes de la parole : Sacha Guitry, Marcel Pagnol où c’est la parole qui fait, ou veut faire, la situation. L’image étant comme un produit visuel du langage, je ne sais pas si je suis très clair. Encore une fois, il y a chez Rohmer quelque chose d’ultra-évident sur le plan visuel, sensoriel et psychique et pour autant quelque chose de profondément mystérieux, d’invisible, d’inatteignable sur le plan de l’être. Il filme des “mystères” au sens chrétien et théâtral du terme, et pas seulement dans Perceval le Gallois (1978).
« Il n’y a pas eu pour nous de “belles années”, de “belle époque”, et en fin de compte si nous pouvions nous réclamer de quelque chose, ce serait de cette phrase de Nizan : “Je ne laisserai dire à personne que 20 ans fut le plus beau moment de notre vie.” Ces années ont été, non pas malheureuses, mais assez grises : nous ne vivions que d’espoir, nous ne vivions même pas. À qui nous demandait “Mais de quoi vivez-vous ?”, nous aimions répondre : “Nous ne vivons pas”. La vie c’était l’écran, c’était le cinéma. » Éric Rohmer
Ludovic Maubreuil : Il peut sembler en effet que le lyrisme de Murnau ou le pathos de Chaplin contredisent la retenue dont use Rohmer pour aborder les joies et les peines pourtant immenses qui étreignent ses personnages. Mais il y a un lien cependant entre leur cinéma et le sien, lien qui existe tout autant avec Rossellini sur lequel il a également beaucoup écrit, lien finalement plus profond que les atours de la mise en scène : le récit qui reflète un parcours, qui exprime une maturation, parfois même une révélation. Les films de Rohmer, comme ceux de Rossellini ou de Murnau, nous font assister à la seconde naissance d’un personnage, qui se perd avant de se reprendre, fait un détour avant de retrouver sa voie, celle-ci se nourrissant de cet écart. Il s’agit de films faussement circulaires qui semblent se terminer où ils ont commencé, aussi bien sur le plan formel que scénaristique, alors que les héroïnes et les héros qui ont fait le chemin, ont désormais acquis, le plus souvent à leur insu, parfois même à leur dépens, une nouvelle connaissance d’eux-mêmes. Ce sont des films au déroulement géométrique, comme la dialectique du plan final de L’Ami de mon amie (1987) le révèle, où les uns et les autres, au prix de renoncements ou de stratagèmes, finissent par devenir ce qu’ils sont.
Pour l’historien Hugues Moreau, « Rohmer évoque la capacité singulière du cinéma à capter une trace du monde et à en montrer les fluctuations dans lesquelles s’inscrit la vie ». En cela, qu’est-ce qui le distingue d’autres cinéastes réalistes comme Vittorio De Sica, Robert Bresson, Ken Loach, Roberto Rossellini ou les frères Dardenne ?
 Ludovic Maubreuil : Il y a différents réalismes dans les cinéastes que vous citez. Certains cherchent avant tout la véracité des situations, et considèrent comme mensongers ce qui n’est pas immédiatement plausible. D’autres jugent même que cette fidélité au réel ne peut s’exprimer qu’à travers le naturalisme le plus cru. D’autres encore se moquent du contexte du moment qu’une certaine vérité de l’instant est transmise. Chez Rohmer, il y a en effet cette capacité à “capter une trace du monde”, car ses films tiennent à montrer celui-ci tel qu’il est, sans trop le grimer, sans trop le réinventer, mais tout en l’enserrant dans un faisceau de correspondance et de sens. La structure ne vient jamais gâcher le réel ainsi capté. Elle l’honore mais ne s’y substitue pas.
Ludovic Maubreuil : Il y a différents réalismes dans les cinéastes que vous citez. Certains cherchent avant tout la véracité des situations, et considèrent comme mensongers ce qui n’est pas immédiatement plausible. D’autres jugent même que cette fidélité au réel ne peut s’exprimer qu’à travers le naturalisme le plus cru. D’autres encore se moquent du contexte du moment qu’une certaine vérité de l’instant est transmise. Chez Rohmer, il y a en effet cette capacité à “capter une trace du monde”, car ses films tiennent à montrer celui-ci tel qu’il est, sans trop le grimer, sans trop le réinventer, mais tout en l’enserrant dans un faisceau de correspondance et de sens. La structure ne vient jamais gâcher le réel ainsi capté. Elle l’honore mais ne s’y substitue pas.
Rohmer a bien souvent choisi des actrices sinon débutantes du moins suffisamment singulières, pour que ce soit elles que l’on voit et que l’on écoute, et non pas uniquement leur personnage. Les Nuits de la pleine lune (1984) est ainsi un documentaire sur Pascale Ogier, comme Pauline à la page l’est sur Amanda Langlet et Le Rayon vert (1986) sur Marie Rivière. La merveilleuse simplicité avec laquelle Rohmer nous place face à ces visages et ces gestes, mais également ces paysages et ces intérieurs, les offre à la contemplation, au-delà de l’histoire qu’ils servent, parce qu’elle les dévoile sans artifice puis les ressaisit sans complaisance ni hésitation dans une trame signifiante : le réalisme de Rohmer, c’est la rencontre heureuse entre la poésie et le sens, entre la mystique et la gnose. Et les raisons pour lesquelles Félicie dans Conte d’hiver (1992), tourne une manche de son pull entre ses mains, marche sur une plage ou rougit soudainement, deviennent indissociables de cette “splendeur du naturel” prélevée sur Charlotte Véry.
« Le réalisme de Rohmer, c’est la rencontre heureuse entre la poésie et le sens, entre la mystique et la gnose. »
Pierre Cormary : D’abord, je crois que le cinéma de Rohmer n’est pas un cinéma social. Il peut y avoir un arrière-fond social (comme dans La Femme de l’aviateur qui commence comme un documentaire sur La Poste ou comme dans Conte d’automne où le héros a des réflexions “industrielles” sur la vallée du Rhône), mais les situations sont généralement individuelles, sentimentales, certainement métaphysiques mais fort peu socio-économiques. Même dans Le Signe du lion (1962) où le héros traverse un véritable calvaire social mais sans doute plus pour des raisons plus personnelles (à cause de son irresponsabilité de fêtard prodigue) que “collectives”. Au fond, le monde extérieur, réel s’il en est, ne semble ne pas exister pour les personnages de Rohmer, d’où leurs déboires “proverbiaux” : « Qui a deux femmes perd son âme, qui a deux maisons perd sa raison » comme on lit au début des Nuits de la pleine lune et qui en l’occurrence s’applique à la malheureuse Louise voulant vivre deux histoires en même temps en deux endroits différents.
Rien à voir donc avec le cinéma social que vous évoquez et dans lequel l’enjeu est réellement de “survivre” et pas simplement de se “satisfaire”. De plus, les films de Rohmer sont souvent des films de “vacances” (La Collectionneuse, Le Genou de Claire, Pauline à la plage, Le Rayon vert), c’est-à-dire de ce temps particulier où l’être se laisse aller à sa paresse et à ses désirs – ce qui n’est pas le cas, me semble-t-il de ce qui se passe dans un film des frères Dardenne. Alors, certes, il y a les films “historiques” (L’Anglaise et le duc, Triple Agent) qui mettent en scène des forces collectives et des dangers objectifs mais là aussi nous avons plus affaire à des individus voulant surfer sur les événements presque “pour s’amuser” qu’à des groupes sociaux à la Ken Loach se battant pour une cause. S’il y a un point de vue de Rohmer sur l’Histoire, le Progrès et la Révolution, il est plutôt contre-révolutionnaire, anti-progressiste et très sceptique vis-à-vis du sens de l’Histoire. Y compris dans ce grand film politique qu’est L’Arbre, le maire et la médiathèque (1993) où l’idéologie socialiste proto-culturelle est légèrement mise à mal.
Par ailleurs, je ne sais pas si j’aurais mis Robert Bresson dans votre liste qui me semble être, comme Rohmer, un cinéaste plus religieux que social et plus intéressé par l’individu que par le groupe – la différence étant que le monde bressonnien est plus sombre que celui de Rohmer, le héros faisant tout pour y échapper – comme le condamné à mort ou Mouchette. Car le monde, c’est la mort. Mais c’est un autre débat. Ce qui est sûr, c’est que Rohmer n’est pas aussi tragique que ceux-là.

De par ses références littéraires et philosophiques disséminées ça et là dans ses films, peut-on dire de Rohmer qu’il est un cinéaste intellectuel ?
Ludovic Maubreuil : Oui, Rohmer est un cinéaste intellectuel. Il serait absurde de le nier. Mais c’est un intellectuel amoureux. Ce qui empêche son cinéma d’être désincarné ou démonstratif, c’est qu’il professe à tout instant son amour des jeunes filles en maillot de bain. Mais aussi des reflets du soleil dans les arbres et des avenues parisiennes encombrées, des herbes folles et des cafés en terrasse, des soirs d’été et des matins brumeux, des plages à marée basse et des lits défaits, des livres qu’on feuillette et des fruits qu’on cueille.
Pierre Cormary : Ce n’est pas parce qu’il y a des références culturelles qu’on fait un art intellectuel. Et on peut apprécier le cinéma de Rohmer sans connaître les références. Néanmoins, c’est vrai qu’il y a chez lui des “inserts” proprement littéraires et surtout philosophiques : la pièce de Shakespeare, Conte d’hiver, dans son film éponyme, les discussions sur le pari pascalien dans Ma Nuit chez Maud (1969) et Conte d’hiver et même celle sur l’a priori kantien dans Conte de printemps (1990) où Rohmer fait le tour de force de nous expliquer dans une conversation de table ce qu’est le jugement synthétique a priori. Mais ce qui l’intéresse dans cette scène, je crois, est encore une fois de filmer la parole, toute philosophique qu’elle soit, et de la rendre vivante et attrayante. Que l’on parle de la météo ou de Kant, tout doit être dicible et intéressant chez lui – et c’est ce dicible infini, cet “intéressant total” qui rendent son cinéma addictif ou répulsif.
Ceux qui n’aiment pas Rohmer arguent que “personne ne parle comme ça dans la vie”, mais ils ont raison. Les personnages de Rohmer semblent être des paroliers sans âme ni conscience assujettis à leurs dires. Mais parce qu’encore une fois tout passe chez lui par le dire immanent. Même si on ment aux autres ou si on se trompe sur soi-même, il n’y a pas de filtre entre ce que l’on dit et ce que l’on pense. L’ontologie rohmérienne est une ontologie de la transparence, mais là, c’est moi qui vire intello, pardon…
« Les dialogues, qui ne sont jamais redondants avec le déroulé de l’histoire, font bel et bien partie de la forme du film, au même titre que le cadre et le découpage, les vêtements des personnages, leurs expressions et leurs postures, les lieux de leurs confrontations. »
On a souvent reproché à Rohmer de réaliser des films aussi bavards que badins. Or, comme le montre l’essayiste Michel Serceau dans son ouvrage Éric Rohmer : Les jeux de l’amour, du hasard et du discours, « hommes et femmes de conversation, les personnages rohmériens auraient ceci de propre de ne pouvoir exister hors de la présence d’un autrui qui leur sert de miroir ».
 Pierre Cormary : Il est clair que dans le cinéma de Rohmer, la solitude tue (voir ce plan de vagues du Rayon vert où Delphine, esseulée et dépressive, semble songer à se suicider) et que chacun et chacune recherche sa moitié pour ne pas périr, quitte à vouloir se marier avec n’importe qui plutôt que rester seule (Le Beau mariage, 1982). Mais le besoin d’autrui ne rend pas forcément altruiste. On veut être avec quelqu’un mais pour des raisons égoïstes. On veut cultiver son narcissisme via l’autre. Le problème est que le narcissisme se retourne contre soi et à la fin, on se retrouve abandonné par tout le monde et on panique – comme Adrien incarné par Patrick Bauchau dans La Collectionneuse (1967) et qui à la fin est obligé de rappeler sa copine à Londres… qu’il n’a pas réussi à tromper à Saint-Tropez ! Ne pas réussir son adultère (Barbet Schroeder dans La Boulangère de Monceau, Bernard Verley dans L’Amour l’après-midi), voire ne pas réussir à coucher tout court (Jean-Louis Trintignant dans Ma Nuit chez Maud qui n’est pas, comme on l’a souvent dit, “ma nuit avec Maud”), une topique des personnages masculins de Rohmer. Et si, à la fin de Conte d’été, Gaspard, encore lui, semble avoir “gagné” en fuyant les trois filles, ne peut-on pas penser que cette fuite en avant devant les femmes ne va pas sceller son destin pour toujours ? Et là, il y a bien quelque chose de tragique dans ce cinéma – et pour dire le contraire de ce que je disais plus haut.
Pierre Cormary : Il est clair que dans le cinéma de Rohmer, la solitude tue (voir ce plan de vagues du Rayon vert où Delphine, esseulée et dépressive, semble songer à se suicider) et que chacun et chacune recherche sa moitié pour ne pas périr, quitte à vouloir se marier avec n’importe qui plutôt que rester seule (Le Beau mariage, 1982). Mais le besoin d’autrui ne rend pas forcément altruiste. On veut être avec quelqu’un mais pour des raisons égoïstes. On veut cultiver son narcissisme via l’autre. Le problème est que le narcissisme se retourne contre soi et à la fin, on se retrouve abandonné par tout le monde et on panique – comme Adrien incarné par Patrick Bauchau dans La Collectionneuse (1967) et qui à la fin est obligé de rappeler sa copine à Londres… qu’il n’a pas réussi à tromper à Saint-Tropez ! Ne pas réussir son adultère (Barbet Schroeder dans La Boulangère de Monceau, Bernard Verley dans L’Amour l’après-midi), voire ne pas réussir à coucher tout court (Jean-Louis Trintignant dans Ma Nuit chez Maud qui n’est pas, comme on l’a souvent dit, “ma nuit avec Maud”), une topique des personnages masculins de Rohmer. Et si, à la fin de Conte d’été, Gaspard, encore lui, semble avoir “gagné” en fuyant les trois filles, ne peut-on pas penser que cette fuite en avant devant les femmes ne va pas sceller son destin pour toujours ? Et là, il y a bien quelque chose de tragique dans ce cinéma – et pour dire le contraire de ce que je disais plus haut.
Donc, autrui, autrui… On le désire pour soi et rien de plus. Et parfois, il est même réduit à une partie du corps (Le Genou de Claire). Autrui est un objet de fétichiste.
Ludovic Maubreuil : Ceux qui pensent que Rohmer se contente de filmer des acteurs en train de réciter un texte, sont à plaindre. Et on ne peut que leur souhaiter le dessillement, car ces dialogues, qui ne sont jamais redondants avec le déroulé de l’histoire, font bel et bien partie de la forme du film, au même titre que le cadre et le découpage, les vêtements des personnages, leurs expressions et leurs postures, les lieux de leurs confrontations. Aucun bavardage en effet, mais la mise en place savante, à deux, trois ou quatre intervenants, de ce qui unit et ce qui diffère. La conversation comme instant privilégié de la dénomination des pôles, de la caractérisation de la place de chacun ; la conversation comme lieu où s’exerce la dialectique du même et de l’autre, qui conduit à l’alliance ou au désaccord irrémédiable. Et aucun badinage, tout cela est très sérieux. Quoi de plus sérieux qu’une rencontre ou une rupture ?
Dans un entretien avec l’écrivain et poète franco-roumain Jean Parvulesco, Rhomer affirme que « le cinéma, dans ses meilleurs moments prouve l’existence de l’âme (et même de Dieu) par la vérité du regard qu’il nous force à promener sur les choses. » Son cinéma est-il nécessairement chrétien ?
Ludovic Maubreuil : Oui, le regard affable que pose Rohmer sur le monde, et que le spectateur, s’il le souhaite, peut reprendre à son compte, sacralise par sa gratuité et son ingénuité même, le lien entre l’homme et le monde sensible. Je rapprocherais cette phrase des propos de Rohmer lui-même sur Ingrid Bergman dans Europe 51, quand il s’émerveille que le film se propose « par la seule force de ce qu’il offre aux yeux, les regards, l’attitude, l’être physique de cette femme et de ceux qui l’entourent, de prouver l’existence de l’âme ».
Bien entendu, Rohmer étant catholique, certains dilemmes ou parti-pris de ses personnages, ont une tonalité chrétienne, mais au-delà de cette imprégnation culturelle, il me semble que ses films, parce qu’ils communient sans faux semblants avec la beauté de l’incarnation (l’interdépendance du corps et des intentions), parce qu’ils relayent sans justification la beauté d’un environnement relevant autant du décor désiré que du monde pris tel quel, témoignent d’un cinéma spiritualiste. De la même manière, les résonances bouddhistes chez Ozu, ou l’orthodoxie de Tarkovski, ne résument pas le style transcendantal de leur cinéma (pour reprendre l’expression du riche essai de Paul Schrader), elles colorent mais n’épuisent pas la mystique de l’œuvre.
Pierre Cormary : Quand on est chrétien, on est toujours tenté de christianiser n’importe quelle œuvre, surtout quand celle-ci semble l’être ici et là : la messe qui ouvre Ma Nuit chez Maud, le “miracle” de Conte d’hiver, le Mystère de Perceval le Gallois, l’“ange” de La Marquise d’O, sans compter qu’Éric Rohmer lui-même était un catholique pratiquant (mais Alfred Hitchcock aussi, après tout – est-ce à dire que Sueurs froides pourrait s’appeler “Sueur de sang” ?). Non, s’il y a bien évidemment une dimension chrétienne dans ce cinéma, il y a tout autant une part païenne, voire occulte et astrologique. Rohmer croit sans doute en Dieu mais ses personnages, eux, croient aux signes qui ne sont pas tous divins à commencer par les signes du zodiaque (Le Signe du lion, premier long métrage de Rohmer) ou les cartes à jouer que la Delphine du Rayon vert ramasse régulièrement dans la rue et en attendant le fameux rayon vert qui, au tout dernier plan du film, devra confirmer son amour avec le jeune homme, sinon les marier tous les deux. Le soleil qui signe l’union des êtres, c’est beau mais c’est païen – tout comme Les Amours d’Astrée et de Céladon, dernier film de Rohmer, ode “gauloise” et “druidique” à la vie et à l’art. « Privé de mon vrai bien, ce bien faux me soulage », déclare Astrée, une parole pas vraiment chrétienne.
« Rohmer a su renouveler les invariants en explorant les exceptions tout en respectant l’unité – une définition du grand art, chrétien ou non. »
Et je ne parle même pas des coïncidences sans nombre qui parsèment ces films et que l’on pourrait interpréter comme autant de signes divins que “diaboliques” (un mot qu’emploie d’ailleurs le personnage de Pascal Greggory à propos de celui de Féodor Atkine dans Pauline à la plage, et au vu des manipulations retorses de ce dernier : « mais il est diabolique, ce mec ! », réplique qui me fait, à chaque fois, beaucoup rire – le comique de Rohmer, il faudrait aussi en parler, et le comique n’est pas proprement “chrétien”). En fait, je crois que comme tout grand créateur, Rohmer a su manier toutes les perspectives au sein de son œuvre. Renouveler les invariants en explorant les exceptions tout en respectant l’unité – une définition du grand art, chrétien ou non.

Pierre Cormary, vous écrivez que « Rohmer joue la foi contre la volonté, le pari contre l’intention ». Sa morale – si tant est qu’on peut la résumer ainsi – serait de laisser faire le hasard en vivant dans l’espérance ?
On pourrait en effet dire ça. « Vivre avec l’espoir, c’est une vie qui en vaut bien d’autres », déclare Félicie, l’héroïne “héroïque” de Conte d’hiver, le film le plus extrême de son auteur et l’un des plus beaux. Félicie explique encore à sa mère qu’« il n’y a pas de bon et de mauvais choix. Ce qu’il faut, c’est que la question du choix ne se pose pas ». C’est quand on hésite qu’on risque de se tromper. Gare à ceux et surtout à celles qui font trop confiance à leur “libre arbitre” et à leur capacité d’action. Dans le cinéma de Rohmer (comme du reste dans le François Mauriac de Galigaï), le volontarisme est toujours puni. Voyez la Sabine du Beau mariage et la Louise des Nuits de la pleine lune, deux femmes “de tête”, qui vont de l’avant, organisent des choses, forcent les rencontres, ne s’arrêtent jamais et finissent dans le mur. Chez Rohmer, “pascalien” en diable qui se croit totalement libre risque fort de se ramasser. Et a contrario, qui est conscient que sa liberté est infime sera beaucoup plus épargné. Et c’est pourquoi ce sont les héroïnes les plus passives, en fait les plus patientes, qui s’en sortent le mieux. À la lettre, on peut dire que celles qui “veulent” échouent, et que celles qui “croient” (comme Félicie dans Conte d’hiver ou Delphine dans Le Rayon vert), “réussissent”.
« Je vous souhaite, au seuil du grand tournant astrologique de votre vie, que vos rêves vous donnent le pouvoir, et que la mélancolie lumineuse de la nuit vous guérisse de tous les désirs du jour, ainsi, en intégrant à la fois l’eau et le feu, vous arriverez à la “grande clarté intérieure” dont parlent les hermétistes, et qui n’est jamais qu’une conscience de son propre destin. Mais cette conscience, c’est l’ensoleillement. » Jean Parvulesco, extrait d’une lettre à Éric Rohmer, le 29 décembre 1960
En 2016, vous vous êtes entretenus avec la poétesse roumaine Aurora Cornu, votre “Greta Garbo”. Pouvez-vous nous décrire sa relation avec Éric Rohmer, ainsi que le rôle très particulier qu’elle tient dans Le Genou de Claire ?
 Aurora Cornu fait partie des exceptions dont nous parlions plus haut. De toutes les héroïnes de Rohmer, elle est la seule en effet qui non seulement échappe au marivaudage des uns et des autres mais encore l’organise en vue d’écrire un livre sur les comportements humains, tout le film apparaissant alors comme une sorte de journal intime illustré. Dans plusieurs interviews, elle a expliqué que Rohmer avait conçu son personnage de romancière (ce qu’elle est dans la vraie vie) comme son alter ego à lui, soit metteur en scène des affects et des gestes des autres. L’histoire du Genou de Claire n’est rien d’autre qu’une tentative de fictionnalisation du réel ou comment faire de la vie de ses amis un roman live – idée que j’ai repris à mon compte puisque vous n’êtes pas sans ignorer que je tente à mon tour de fictionnaliser ma relation avec Aurora Cornu, une personne extraordinaire que j’ai réellement rencontrée il y a six ans, qui est devenue ma meilleure amie, et sur laquelle je tente d’écrire un roman. Mais on en reparlera – j’espère.
Aurora Cornu fait partie des exceptions dont nous parlions plus haut. De toutes les héroïnes de Rohmer, elle est la seule en effet qui non seulement échappe au marivaudage des uns et des autres mais encore l’organise en vue d’écrire un livre sur les comportements humains, tout le film apparaissant alors comme une sorte de journal intime illustré. Dans plusieurs interviews, elle a expliqué que Rohmer avait conçu son personnage de romancière (ce qu’elle est dans la vraie vie) comme son alter ego à lui, soit metteur en scène des affects et des gestes des autres. L’histoire du Genou de Claire n’est rien d’autre qu’une tentative de fictionnalisation du réel ou comment faire de la vie de ses amis un roman live – idée que j’ai repris à mon compte puisque vous n’êtes pas sans ignorer que je tente à mon tour de fictionnaliser ma relation avec Aurora Cornu, une personne extraordinaire que j’ai réellement rencontrée il y a six ans, qui est devenue ma meilleure amie, et sur laquelle je tente d’écrire un roman. Mais on en reparlera – j’espère.
« En fin de compte, tout grand cinéma est un cinéma de contemplation. Peut-être peut-on trouver là une ouverture vers le mysticisme. » Éric Rohmer
Ludovic Maubreuil, qu’est-ce qui caractérise la nudité – plutôt rare – dans les films de Rohmer ?
Plutôt rare en effet, une petite dizaine de nus, de L’Amour l’après-midi (1972) jusqu’aux Amours d’Astrée et de Céladon (2007), des fesses de Zouzou au sein de Stéphanie Crayencour. Ce qui d’emblée interroge, au vu de la thématique principale de cette filmographie, à savoir l’émoi amoureux et les tribulations du désir. La caractéristique principale est qu’il s’agit d’une nudité insolite, dont le mode d’apparition et le contexte de survenue tranchent avec l’esthétique habituelle de Rohmer. Soudaineté, brièveté, fragmentation, éloignement ou décentrage, voilà qui contredit presque point par point un cinéma qui d’ordinaire, sait prendre son temps, suivre l’ensemble d’une gestuelle ou d’une conversation, privilégier le premier plan et la centralité du sujet, s’attacher à la lumière naturelle et à la symétrie du cadre. Et ces nus, outre leur présentation, se démarquent également par leur contexte de survenue, en général lors de situations où le désarroi, le remord, le soupçon ou la peine prédominent. C’est cela qui me fait évoquer à leur endroit, le sublime théorisé par Burke, ce « plaisir qui ne peut exister que par une relation à la douleur », d’autant que les neurosciences ont également travaillé sur la perception des œuvres d’art, et notamment les différences d’appréciation entre le “beau” et le “sublime”, pour aboutir à la conclusion que ce dernier, pourvoyeur de “plaisir déplaisant”, se ressent plus volontiers lors de l’utilisation des mouvements obliques, de la pénombre, du décentrage du sujet, etc. Il y a là une subversion de la forme classique, lumineuse et ordonnée, avec laquelle Rohmer conduit habituellement ses récits.

En quoi les “nus sublimes” que vous décrivez peuvent faire naître un trouble érotique transgressif chez le spectateur ?
Le cinéma de Rohmer n’est pas bourgeois, c’est pourquoi il ne cherche jamais à transgresser mais bien à transmettre. Transmettre par exemple que la représentation du nu ne saurait être sans conséquence. Jamais Rohmer ne montre un nu avec la même franchise, la même innocence, qu’un visage ou un paysage. Cette faille esthétique bat en brèche la vulgate de l’époque, laquelle voudrait que les toutes les images soient égales, inoffensives, montrées avec la même neutralité, la même objectivité bienveillante. De toute évidence, il n’en est rien : certaines résistent !
Sylvain Métafiot
Nos Desserts :
- Rencontres avec Éric Rohmer à la Cinémathèque française
- Voir l’émission de Blow Up « Éric Rohmer face à l’histoire »
- Écouter les cinq entretiens donnés par Éric Rohmer dans l’émission À voix nue sur France culture
- « R comme Éric Rohmer, le sismographe » dans l’émission Plan Large sur France culture
- « Philosopher avec Éric Rohmer », une série de quatre émissions sur Les Chemins de la philosophie
- « Éric Rohmer et les femmes », un article de Cannelle Favier sur Cinépsis
- Le blog de Ludovic Maubreuil, Cinématique, et ses ouvrages en librairies
- Le blog de Pierre Cormary : Soleil et croix
12:44 Publié dans Cinéma | Tags : conte d'été, conte d'hiver, pauline à la plage, ludovic maubreuil, pierre cormaryle comptoir, sylvain métafiot, À la recherche du paradis français d’Éric rohmer, l’amour l’après-midi, le ramayon vert, le genou de claire, ma nuit chez maud | Lien permanent | Commentaires (0)










Écrire un commentaire