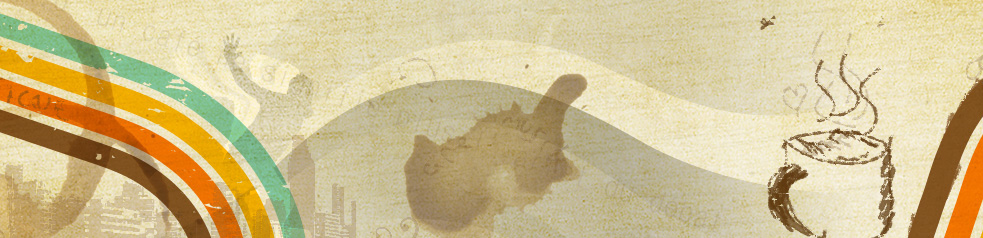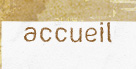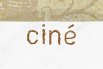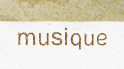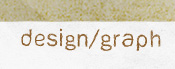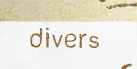mercredi, 19 mai 2010
De part et d'autre de l'Atlantique (IV)
Chapitre 4
J'y étais, ma vieille valise à la main, celle que ma grand-mère avait si gentiment ressortie du grenier avant de rejoindre les ancêtres dans le caveau familial. La ville et ses immeubles se dressaient là, devant moi. En quelques minutes, mes espoirs s'étaient envolés. Une lourdeur vint se loger dans ma poitrine au point de me paralyser. Londres me regardait. J'entendais son rire narquois qui s'amplifiait. Je ne voyais plus que des jambes, des longues, des fines, portant des jeans ou des collants. Elles passaient toutes plus vite les unes que les autres, pas une ne s'arrêtait. Puis le noir.
Je me réveillai dans un endroit sombre, éclairé par une simple lampe à huile dont la mèche s'éteindrait surement peu après la levée du jour. L'homme assis à mes côtés dégageait une odeur acre et m'observait comme une bête curieuse.
- Oh toi, ça ne va pas ! Tu veux une clope ?
J'attendis un instant que son halène fétide cesse de me tourner la tête pour lui prendre la dernière cigarette de son paquet de Marlboro.
Nous nous sommes quitté sans même avoir échangé plus de mots. Je ne l'ai pas revu. Je m'en moquais. J'aime ces gens qui ne te posent pas de question, qui ne te demandent pas d'où tu viens et surtout où tu vas.
Où j'allais ? Moi-même je n'en avais pas la moindre idée. Je ne savais plus ce que j'étais venu chercher dans cette capitale britannique. Autour de moi les gens marchaient vite, couraient presque pour sauter dans le métro. Je les retrouvais. Toujours ces mêmes hommes et femmes, si beaux, si actifs, si pressés d'accomplir leur devoir quotidien.
Après de longues pérégrinations dans le centre de Londres, je m'attablai dans un café à l'enseigne défraichie. Deux hommes seulement étaient entrain de jouer aux échecs. Ils avaient l'allure typique des joueurs de poker qui passent leurs nuits autour de la table à espérer empocher des liasses de billets qui leur permettraient d'offrir un beau collier à leur épouse qui les attendait patiemment à la maison. Je commandai un sandwich au jambon et une Guinness, puis pris le journal posé sur la chaise voisine.
Avec les quelques livres que j'avais en poche, je pu me payer une chambre d'hôtel le temps de trouver un endroit où m'installer. Finalement c'était peut-être simplement parce que je n'avais pas le courage de repartir. J'approchais maintenant de la trentaine. Mes parents avaient cessé de me parler tout pendant que je ne trouvais pas de femme avec qui me marier et fonder cette charmante petite famille qu'on attendait.
Mes amis eux étaient tous de beaux parents, attentionnés et occupés par la vie familiale et ne trouvaient plus intéressant de fréquenter un trentenaire célibataire, fumeur et buveur de bière. Je ne voulais pas de leur vie aseptisée, maîtrisée, programmée. Je n'hésitais pas à répondre par la négative lorsqu'on me demandait si j'avais une petite amie. Je n'étais pas bien fier, peut-être envieux parfois.
Allongé sur mon lit, le regard dirigé vers le plafond tel un adolescent rêveur voulant s'isoler de tout ce qui l'entoure. Je pensais à Rosie. Je pensais à ses petites fesses rondement serrées dans son jean. Je voyais sa poitrine s'avancer lentement vers moi. Mon sexe se dressait sous les draps. Ce n'était pas désagréable. C'était tout. Rosie ne viendrait pas, je ne toucherais pas son corps, je ne caresserais pas ses seins, je ne baiserais pas ses lèvres.
Elsa Massart
02:10 Publié dans Littérature | Tags : de part et d'autre de l'atlantique, chapitre 4, elsa massart | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 28 avril 2010
De part et d'autre de l'Atlantique (III)
Chapitre 3
Outrepassant ma volonté, j'ai ouvert les yeux. Faisant fi des rideaux d'une moitié amoncelés et de l'autre brutalement étendue, la lumière pénétrait le salon, bondissait des murs aux vases, des vases au plafond, puis vers la télévision ; du plafond vers les CD' retournés, de la télévision vers le pied de la lampe et ainsi de suite jusqu'à former, dans une toile instantanée de rayons parcourant le salon aussi vite que l'espace, un nuage d'intensité exogène s'incrustant entre les paupières, pour tirailler le nerf optique puis tous les autres jusqu'au réveil aussi difficile soit-il.
00:16 Publié dans Littérature | Tags : de part et d'autre de l'atlantique, chapitre3, londres, london, histoire, bertrand colin | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 05 avril 2010
De part et d'autre de l'Atlantique (II)
Chapitre 2
Je vis dans un appartement sur la Cooper Street. En ces lieux et depuis leur construction du début des années cinquante, la modernité ne transpire plus et tout contrôle de sécurité ménagère dument diligenté aurait contraint tout occupant de cet immeuble, eut égard à son statut dans le règne capitaliste immobilier, à fuir en catastrophe devant les décrets de rénovation inévitablement onéreux ou un fatal verdict de démolition irrévocable.
La fiche-suivi de cette résidence devait s'être égarée dans les réseaux de classification de l'agence de prévention des risques en logement collectif de l'État de Pennsylvanie. Depuis lors, chacune des stratégies d'amélioration esthétique des couches superficielles de chacun des appartements - et conséquemment du miens - participaient à s'isoler de l'univers des vermines électriques et autres infections tubulaires, laissant les lions propriétaires et autres hirondelles précaires dans une ignorance relative, source de quiétude imparfaite acceptable jusqu'au lendemain mais redoutable demain.
Rapide topographie. L'entrée de ce trois pièces ce fait par la principale, le salon. Ameublement standard, sofa de couleur beige au centre ; dernière le bureau et son enchevêtrement organisé ; devant, une table basse et brune ; autour, trois autres fauteuils, quelques plantes, des livres sur les étagères de bois naturel et quelques autres éparses, sur le ces mêmes sofa et table basse. Une télévision, discrète dans l'un de coins rendue incapable de se relier au câble et simplement résolue à aspirer des VHS ou autre DVD pour nous en incruster la rétine de scènes classiques ou cracher, sans grande responsabilité de sa part, quelques un des navets ignominieusement produits. C'est selon la sélection.
Sur les murs quelques reproductions, en deçà de l'une d'entre elles une chaine stéréo et sur celle-ci, quelques CDs dont l'écoute m'est conseillée par William, plus qu'un simple disquaire mais pas suffisamment un ami.
L'autre demie partie de l'appartement est occupée par la chambre - description inutile - de là, accessible sur la gauche et, au fond toujours sur la gauche, par la cuisine, éclairée comme le salon, blanche, petite table de bois en bordure de fenêtre, trois chaises dans la même veine, les deux mastodontes électroménagers installés une fois et comme inamovibles.
Les murs de briques peinturlurés de blanc, façon rapide, intemporelle, économique et passe-partout - surtout de locataire en locataire - étaient perforés de fenêtres à guillotines. Les deux du salon comme celle de la cuisine donnaient sur la Dead end Davis partagée avec l'ancien centre de dépôt de pneu de camion pour le marché nord-est américain et son mur de briques naturellement rouges à l'extérieur mais salies par les temps industriels et le désintérêt de ses contemporains. Au dessus, le ciel aujourd'hui supportable ; à gauche et de mieux en mieux avec l'extraction du buste par la fenêtre, la Cooper Street ; juste ici, à droite, l'escalier inusité de fer rouillé qui, de réputation, mène jusqu'au toit.
Bertrand Colin
09:22 Publié dans Littérature | Tags : de part et d'autre de l'atlantique, chapitre 2, cooper street, capitaliste immobilier, pennsylvanie, appartements, bertrand colin | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 29 mars 2010
De part et d'autre de l'Atlantique (I)
Chapitre 1
Huit heures. Notre assistante de direction du service commande et achat, déléguée à la stimulation de la compétitivité du personnel, nous avance, présentation informatique soignée à l'appui, les résultats des achats de la semaine précédente et les objectifs de celle qui commence.
Elle porte toujours le même tailleur noir et le même chemisier blanc de qualité supérieure. Celui du lundi matin repassée la veille au soir tout en récitant encore le contenu de sa présentation à son animal vautré dans le canapé et lâchant à l'occasion quelque hum ou simili.
Elle nous prodigue les conseils, chaque semaine novateurs dans leur formulation, pour - sensiblement - améliorer de quelques faibles parts de pourcentage le chiffre de nos commandes.
Je vois les treize premières minutes péniblement s'écouler sur le cadran du poigner.. Je tente encore une foi d'écouter son discours. Si ce n'est la volonté pugnace de légitimer son poste, rien que nous ne sachions déjà.
Huit heure quatorze. Réaction extraordinaire à la récurrence des quotidiens ordinaires. Je sors, me dirige vers l'ascenseur. J'appuie sur le bouton d'appel, il vient. Pas assez vite. Je veux sortir, maintenant. Je prends les escaliers, je les dévale deux par... quatre à quatre. Dans le hall, le gardien comme et pour toujours, végète devant son écran persuadé de l'importance de sa mission.
Je sors, vite. Sur le trottoir, je regarde : des voitures polluantes et des passants incommodés circulent vers leur ordinaire mission quotidienne. Je n'en ai plus. J'inspire profondément. Une voiture démarre, je tousse.
Il fait frais, je m'en rends maintenant compte. Je ferme ma veste et remonte le col. J'avance.
Bertrand Colin
11:44 Publié dans Littérature | Tags : de part et d'autre de l'atlantique, feuillton, assistante de direction du service, compétitivité, bertrand colin | Lien permanent | Commentaires (8)
samedi, 06 mars 2010
Le paradigme de Michigan
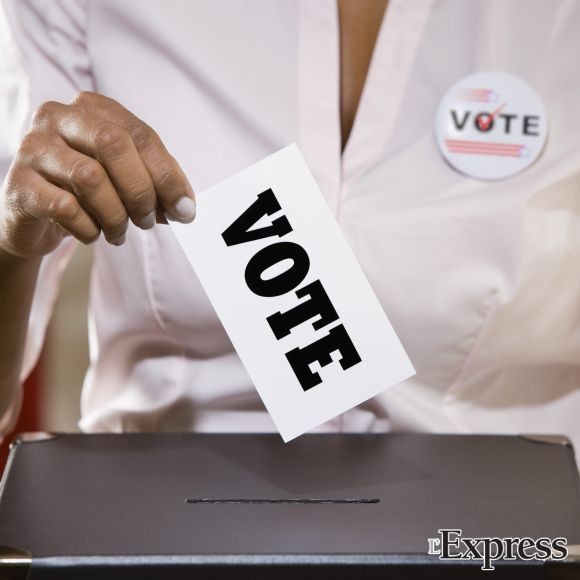
Alors que la campagne pour les élections régionales bat son plein (rires), voici une théorie, parmi d'autres, du comportement des électeurs.
A travers l'ouvrage The American Voter, les chercheurs de l'université de Michigan développent la théorie de l'électeur rationnel en s'appuyant sur des enquêtes nationales aux Etats-Unis, réalisées la veille et le lendemain de chaque élection présidentielle de 1948 à 1956, où l'on interroge environ 2000 individus représentatifs des électeurs. Ils mettent en avant la psychologie individuelle et les perceptions politiques de ces derniers pour expliquer la signification de leurs votes.
De fait, ce que l'on appellera le paradigme de Michigan se développe sur la base de deux facteurs : l'identification partisane et le contexte électoral.
18:03 Publié dans Littérature | Tags : le paradigme de michigan, the american voter, l'électeur rationnel, identification partisane, the people's choice, paul lazarsfeld, vladimer o. rey j.-r, the changing american voter, etats-unis, anthony downs, vote sur enjeux, himmelweit, sylvain métafiot, homo-oeconomicus | Lien permanent | Commentaires (9)
dimanche, 31 janvier 2010
Le paradoxe de l’autoréférence : c’est celui qui dit qui n’y est pas
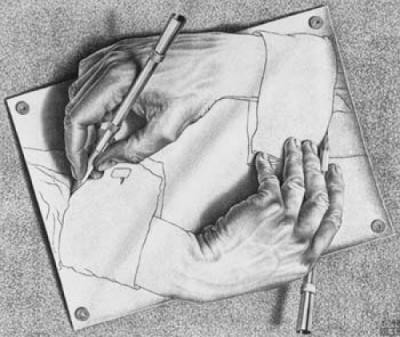
On se souvient de l'insupportable menteur qui ne ment pas dans la mesure où il ment et qui ment dans la mesure où il ne ment pas. Le paradoxe de Grelling est comme le menteur un paradoxe de l'autoréférence issu du fait qu'un énoncé, parce que situé sur deux plans, se contredit lui-même.
Grelling divise les adjectifs en autologiques et en hétérologiques. Les adjectifs autologiques possèdent eux-mêmes la propriété qu'ils décrivent. Ainsi, « bref » est bref, « pentasyllabique » a cinq syllabes. En revanche, « long » n'est pas long, « bisyllabique » n'a pas deux syllabes. Ils sont hétérologiques.
Maintenant, on se pose la question de savoir si « hétérologique » est autologique ou hétérologique. Si « hétérologique » est hétérologique, alors il est autologique puisqu'il possède la propriété qu'il décrit, mais si « hétérologique » est autologique, alors il est hétérologique puisqu'il ne possède pas la propriété qu'il décrit. « Hétérologique » est autologique dans la mesure où il est hétérologique et hétérologique dans la mesure où il est autologique.
J'ai la tête qui tourne...

Sylvain Métafiot
16:48 Publié dans Littérature | Tags : le paradoxe de l’autoréférence, menteur, grelling, adjectifs en autologiques, pentasyllabique, bisyllabique, syllabes, adjectifs en hétérologiques, sylvain métafiot | Lien permanent | Commentaires (6)
vendredi, 25 décembre 2009
L'humour

« L'intelligence sans humour est difficilement de la vraie intelligence. » Etienne Chatilliez
En effet, l'humour est une forme d'intelligence sinon comment faire un trait d'esprit humoristique sans réflexion ? Comment faire rire sans réfléchir à comment le faire ? Si on veut provoquer le rire chez quelqu'un, il faut prendre plusieurs paramètres en compte, notamment, les caractéristiques de la personne avec qui l'on blague. Afin d'être efficace, il faut plaisanter sur des sujets connus par la personne qui nous écoute et surtout sur des sujets qui ne sont pas sensibles pour la personne...car comme le dirait Pierre Desproges : « on peut rire de tout mais pas avec tout le monde ». Cependant, l'humour a le pouvoir de tout tourner en dérision, ainsi il nous laisse une grande liberté et n'est-ce pas ça la force de l'humour ? Finalement, l'humour est la chose qui demande le plus d'exigence en ce monde car pour rire de tout il faut être capable d'une grande intelligence, d'une grande culture, d'une grande ouverture d'esprit et d'un détachement absolu vis-à-vis de toute chose et de soi-même. De fait, la plus grande force de l'humour réside dans le fait qu'il peut s'employer sous diverses formes, dans diverses situations et dans des buts bien distincts...
15:07 Publié dans Littérature | Tags : humour, mel brooks, etienne chatilliez, trait humoristique, intelligence, autodérision, pierre desproges, hermann hesse, bertrand cèbe, andré santini, arme, rhétorique, jérémy engler | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 13 novembre 2009
La confiance

"La sincérité est une ouverture de cœur. On la trouve en fort peu de gens, et celle que l'on voit d'ordinaire n'est qu'une fine dissimulation pour attirer la confiance des autres..." La Rochefoucauld
En effet, la confiance n'est qu'une utopie pour les naïfs, dans le monde dans lequel on vit, il est impossible de faire confiance à qui que ce soit. Chaque secret confié est une arme que l'on peut retourner contre nous, au final, la seule chose dans laquelle on peut avoir confiance c'est l'amour propre comme le disait La Rochefoucauld : « Un seul amour fidèle, l'amour propre »
Malheureusement, plus on fait confiance et plus on est déçu. On accorde sa confiance car on se sent bien avec une personne pour finalement découvrir qu'elle se sert de nous et de nos secrets...Cette personne est à tout moment capable de le répéter, ce secret devient ainsi une arme contre laquelle on ne peut rien et qui nous laisse désarmer, sans défense, vulnérable et faible...
"Pauvre. Individu qui avait mis sa confiance dans le soutien de ses amis."
Ambroise Bierce
On dit toujours que la confiance se gagne, pourquoi devrait-elle se gagner ? Parce que justement elle est dure à donner. Si on la donne trop rapidement sans bien choisir la personne, on est bien vite déçu...et en même temps pourquoi devrait-on la gagner ? Ce n'est pas un duel ni une compétition...car si on gagne, quelqu'un perd or que perd-on à faire confiance ? Si ce n'est un secret... Au final on ne sait plus si on doit se confier et surtout à qui ? Plutôt que de dire que la confiance se gagne, je pense qu'il faudrait dire qu'elle se mérite mais comment mériter la confiance de quelqu'un ? En lui rendant service, en étant présent dans des moments difficiles, en l'aidant à surmonter ses peines...ce sont des possibilités mais au final, les gens peuvent aider dans l'espoir de recevoir une contrepartie...c'est un cercle sans fin...
"L'expérience prouve que celui qui n'a jamais confiance en personne ne sera jamais déçu."
Léonard De Vinci
Malheureusement, on pourra toujours trouver des arguments contre le fait de faire confiance à quelqu'un alors que les arguments pour faire confiance sont moins nombreux...
Au final, la confiance n'est qu'une chimère à laquelle on se raccroche car elle est nécessaire pour avancer dans la vie mais on se rend compte que plus on la donne et plus la chute est rude...
"Se tromper et devoir cependant accorder sa confiance à son être intérieur, c'est cela un homme" Gottfried Benn
Jérémy Engler
00:07 Publié dans Littérature | Tags : la confiance, la rochefoucauld, léonard de vinci, gottfried benn, ambroise bierce, jérémy engler | Lien permanent | Commentaires (2)
dimanche, 18 octobre 2009
L’expérience de Milgram
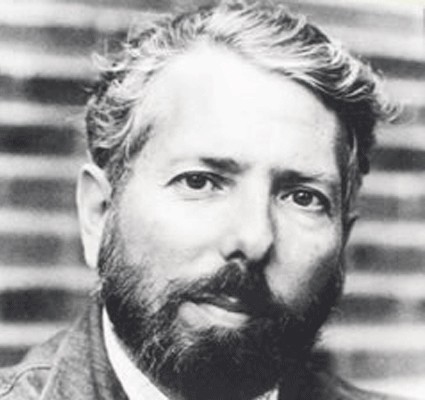
C'est aujourd'hui une belle journée : vous vous êtes porté volontaire pour participer à une expérience de psychologie bien rémunérée. Dans les locaux de l'université, un scientifique vous reçoit ainsi qu'un autre volontaire. Il vous explique qu'il étudie l'effet de la punition sur la mémorisation. L'un de vous deux jouera le rôle d'un « élève », qui devra mémoriser des séries de lettres. L'autre jouera le rôle de l' « enseignant » : il lira les mots que doit mémoriser l'élève et administrera grâce à une série de manettes des chocs électriques d'intensité croissante à l'élève s'il se trompe en les restituant. Vous tirez vos rôles à pile ou face ; le sort vous attribue le rôle de l'enseignant. L'élève est attaché à la chaise, et l'expérience commence. Il mémorise d'abord assez bien les mots que vous lui lisez. Mais il commet une première erreur : vous lui administrez un léger choc électrique. Visiblement la punition fonctionne et il se concentre à nouveau. Il se trompe cependant encore une fois : sur les ordres du professeur, vous lui administrez un choc un peu plus violent. Le cobaye semble soucieux. Stressé, il accumule les erreurs. A chaque fois, le scientifique vous enjoint d'administrer un choc plus important ; jusqu'au point où votre collègue, hurlant de douleur, vous supplie d'arrêter. Le professeur, inflexible, vous ordonne de continuer. Vous arrivez à la dose maximale - les mots « attention choc dangereux » sont inscrits près de la manette correspondante. Votre collègue, sanglotant et à moitié assommé par les chocs, refuse de répondre depuis quelques temps. Le scientifique vous ordonne d'administrer le choc maximal. Naturellement, vous refusez. « Vous n'avez pas le choix : vous devez continuer », vous répond-t-il. Que faites-vous ? Par pitié pour le cobaye, vous désobéissez au scientifique et arrêtez ? Ou bien vous suivez les ordres ?
samedi, 10 octobre 2009
L’emboîtement des différents ordres de réalité
Auguste Comte utilisait déjà le terme de sociologie en tant que science sociale. Elle désignait à la fois l'ethnologie, l'économie, l'anthropologie et la science politique. Cette sociologie était une physique sociale appliquée à l'analyse des phénomènes sociaux (elle devait avoir la même visée normative que la physique). C'était aussi une science philosophique car elle devait rendre compte dans sa totalité de l'esprit humain. Elle devait aboutir à systématiser l'ensemble des sciences et des institutions. Elle intègre et coiffe donc l'ensemble des connaissances. L'objet des sciences sociales est le plus complexe de tous car il renvoi aux faits et gestes d'une multitude d'agents et il concerne un nombre gigantesque de variables. La sociologie arrive en dernier car elle correspond à l'aboutissement de l'esprit humain.

Auguste Comte distingue trois âges :
- - L'âge théologique. On explique tout par la volonté divine.
- - L'âge métaphysique (XVIIe et XVIIIe siècle). C'est l'époque de la construction des grands systèmes (voire Hegel).
- - L'âge positif. La raison s'émancipe, l'homme se pose des questions. C'est le grand moment des philosophes des lumières.
La sociologie d'Auguste Comte est distincte des autres sciences mais aussi très solidaire. Il a une vision intégrée de la connaissance et des sciences. Les objets étudiés par les sciences sociales sont solidaires des phénomènes organiques et inorganiques. Les système sociologiques sont naturels si on considère l'origine des sociétés : les sociétés sont des données naturelles, il ne peut y avoir de sujet humain isolé car il doit vivre en communauté, s'assembler avec ses semblables, c'est la seule façon de survivre et de se construire comme être humain.
Les positivistes sont critiques vis-à-vis des théories contractualistes (selon Rousseau nous acceptons de perdre une partie de notre liberté en échange de la protection du groupe). Ils estiment que c'est naturel de vivre en société. Ils rejettent aussi la théorie utilitariste du coût-bénéfice.
Pour eux, l'individu est une abstraction. Seule la société est concrète et l'humanité est une réalité vivante. Ils accordent une place primordiale au groupe. L'humanité semble être l'objet d'un culte chez eux : elle est considéré comme un être vivant, organique, qui a sa propre constitution. C'est un collectif qui a des propriétés spécifiques. L'objet de la sociologie est de dégager ces propriétés structurelles.
Les positivistes ont une vision organiciste : la famille, la religion, la propriété, le langage, l'autorité sont des organes, car la société est un organisme vivant même si elle possède des variables historiques. Donc, étudier le milieu social suppose que l'on connaisse déjà le milieu physique et organique. La connaissance du social passe par la compréhension des lois biologiques.
Les faits sociaux se produisent dans une réalité biologique déterminé et on ne peut pas extraire les sciences sociales des autres sciences. Il faut donc découvrir les lois qui s'appliquent à un ordre de réalité (au sens biologique et matériel du terme). Les différents ordres de réalité ne sont l'expression que d'une même nature. Les sciences sociales sont tributaires des mutations épistémologiques des autres sciences.
La sociologie se transforme en même temps et grâce aux sciences de la nature. De fait, elle doit intégrer des paradigmes des autres sciences. Elle doit s'inscrire dans le verbalisme et la biologie. Elle doit prendre en compte le paradigme évolutionniste : les organismes sont soumis à l'évolution de leurs environnements. L'histoire de l'humanité est un processus continu d'évolution ou d'adaptation évolutive (exemple de l'idée de lutte des classes). La sociologie doit donc s'inspirer des méthodes des autres sciences.
A suivre...
Sylvain Métafiot
19:41 Publié dans Littérature | Tags : auguste comte, positivisme, sociologie, science sociale, métaphysique, âge positif, l’âge théologique, sylvain métafiot, l’emboîtement des différents ordres de réalité | Lien permanent | Commentaires (0)