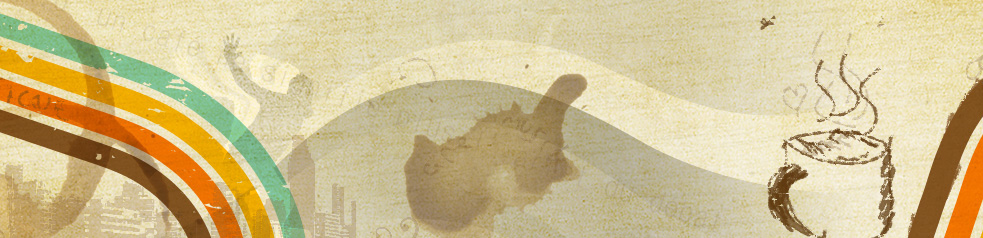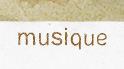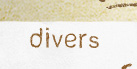vendredi, 03 juillet 2020
L’enquête infinie : From Hell d'Alan Moore
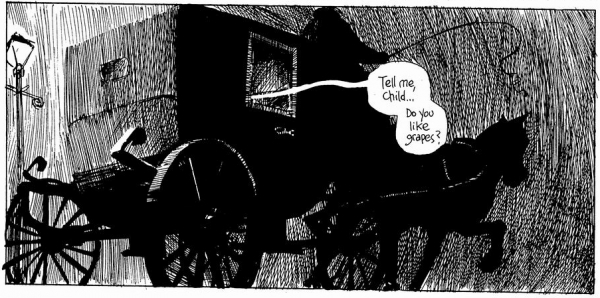
Tout le monde à son avis à propos de Jack L’éventreur, l’un des tueurs en série les plus célèbres de notre histoire moderne. Dès 1888, l’année des meurtres, les théories les plus folles circulaient déjà sur le criminel de Whitechapel : un boucher portant un tablier de cuir, un membre de la bande du Old Nichol, un juif fou, un membre de la famille royale, etc. Tout ce que le XXe siècle compte de journalistes, d’enquêteurs amateurs et de chroniqueurs plus ou moins scrupuleux s’est ensuite penché sur le cas du terrible assassin, élaborant moult théories saugrenues et autres machinations étonnantes, sans jamais pourtant fournir une seule preuve irréfutable de son identité.
C’est cette figure impalpable et insaisissable du Mal qui fascine le scénariste Alan Moore. Aidé du dessinateur Eddie Campbell, disséquant de son trait tranchant le cadavre d’une Londres pourrissante, il prend le parti de l’ouvrage de Stephen Knight Jack the Ripper : The Final Solution (1976) pour retracer la vie d’un Jack L’éventreur accomplissant son « œuvre » sous l’égide de dieux mythiques. Mais si son identité est dévoilée elle n’en demeure pas moins une hypothèse parmi d’autres. Alan Moore, qui a lu la quasi-totalité de la littérature existante sur l’affaire (cf. les 50 pages de notes et de références à la fin de l’ouvrage), n’est pas dupe : il sait que la théorie du complot de Stephen Knight a été contredite par nombres d’historiens. Cela ne l’empêche pas de réaliser une œuvre monumentale dans laquelle chaque page est d’une noirceur plus étouffante que la précédente, faisant se croiser dans un dédale retors de rues crasseuses l’inspecteur Frederic Abberline, le peintre William Sickert, William Blake, l’occultiste Aleister Crowley, Oscar Wilde ou Joseph « Elephant man » Merrick. Le chapitre 4, « Que te demande le Seigneur ? », où un Jack L’éventreur diablement érudit détaille tous les sites associés aux mythologies païennes, notamment les effrayantes églises de Nicholas Hawksmoor, qui, en se rejoignant, forme un pentacle satanique en plein cœur d’une capitale suintante de niveaux et de complexités structurelles, donne le vertige.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
11:46 Publié dans Littérature | Tags : sylvain métafiot, le comptoir, l’enquête infinie, from hell, alan moore, eddie campbell, jack l’éventreur, londres, stephen knight, jack the ripper : the final solution, nicholas hawksmoor | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 09 juin 2020
Les cauchemars de Lovecraft selon Gou Tanabe

Spécialisé dans l’adaptation d’œuvres littéraire (en 2002, il remporte la mention honorable du 4e prix Entame, des éditions Enterbrain, avec Nijurokunin no otoko to hitori no shojo, une adaptation d’une nouvelle de Maxime Gorki), le dessinateur japonais Gou Tanabe a entrepris de transposer certains des chefs d’œuvres d’Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) dans un style sombre et hyperréaliste faisant songer aux planches de Bernie Wrightson ou Shigeru Mizuki. Il fait ainsi resurgir, avec force détails, l’une des peurs les plus primales de l’homme : l’effroi devant l’inconnu. Ce qui n’est pas un mince exploit sachant que les innommables horreurs contenues dans les récits de l’écrivain de Providence reposent en bonne partie sur la suggestion.
Les Montagnes Hallucinées nous entraîne en Antarctique, en 1931, dans les pas de l’expédition du professeur Dyer partit au secours de l’équipe du biologiste Lake. Ce dernier s’étant aventuré aux confins du continent de glace découvrant de curieux spécimens mi-animal mi-végétal ressemblant à certains êtres des mythes primordiaux… et plus particulièrement les fabuleux Anciens. Arrivé au campement, Dyer découvre un charnier composé des squelettes des membres de l’équipe de Lake. Il décide de partir à la recherche du seul survivant, Gedney, en s’aventurant par-delà la gigantesque et ténébreuse chaîne de montagnes noires hérissée au pied du bivouac. Dans ces monticules inhospitaliers le professeur découvre de mystérieuses fresques narrant l’affrontement titanesque entre la race des grands Anciens et d’autres envahisseurs sidéraux…
Dans l’abîme du temps explore, quant à lui, les thématiques du voyage dans le temps et du transfert de personnalité. Seule la science-fiction peut expliquer le comportement de Nathaniel Peaslee qui, de simple professeur d’économie à l’université de Miskatonic, se change en érudit obsessionnel et dérangé à la suite d’une foudroyante perte de connaissance. À son réveil, ni sa femme, ni ses enfants, ni ses collègues ne reconnaissent cet homme au regard vague se passionnant pour les sciences occultes, les langues disparues et l’étude du livre maudit, le Necronomicon. Des recherches qui, en 1935, vont l’emmener au plus profond du désert australien, sur les traces d’une ancienne civilisation dont il a la désagréable certitude d’en connaître tous les secrets : la grand-race de Yith et ses archives pandémoniaques, renfermant tout le savoir de l’univers.
Quel est ce lieu que l’on nomme la Lande Foudroyée dans la région d’Arkham, et au centre duquel trône un puits abandonné et malfaisant ? C’est l’histoire d’un météore qui, dans La Couleur tombée du Ciel, en s’écrasant dans la propriété des Gardner au début du XXe siècle va bouleverser de manière dramatique leur quotidien. Émerveillés, dans un premier temps, par la couleur irréelle se dégageant de la mystérieuse pierre, la famille Gardner voit peu à peu l’environnement de leur ferme se transformer insidieusement. Les plantes, légumes et fruits prennent des proportions géantes mais deviennent infect au goût ; les animaux domestiques et les bêtes sauvages sont pris de paniques et deviennent agressifs. La famille de fermiers est elle-même touchée par ce mal étrange qui transforme un à un ses membres alors que la couleur luminescente les enserre toujours plus de sa présence maléfique…
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
vendredi, 22 mai 2020
Adolf Eichmann, l’obéissance de cadavre

Article initialement publié sur Le Comptoir
Le 75e anniversaire de la libération du camp d’extermination d’Auschwitz nous donne l’occasion de revenir sur la notion, si célèbre et souvent galvaudée, de « banalité du mal » établie par la philosophe Hannah Arendt dans son ouvrage « Eichmann à Jérusalem ». Ce concept désigne une capacité à commettre des crimes (parfois monstrueux) qui n’est ni exceptionnelle ni pathologique, mais provient d’un effacement radical de la personnalité et d’une obéissance aveugle à l’autorité.
 En 1963, Hannah Arendt est engagée par The New Yorker pour suivre le procès du criminel nazi Adolf Eichmann à Jérusalem. Le livre qu’elle en tire, Eichmann à Jérusalem, est sous-titré Rapport sur la banalité du mal. Elle n’emploie pourtant cette notion que dans une seule occurrence, hautement évocatrice. Ayant rapporté, de façon presque sarcastique, les paroles creuses et toutes faites du condamné avant sa pendaison – jusqu’alors, il ne pouvait se défaire des stéréotypes d’un langage qui le coupait de la réalité – elle conclut par ces mots : « Comme si, en ces dernières minutes, il résumait la leçon que nous a apprise cette longue étude sur la méchanceté humaine – la leçon de la terrible, de l’indicible, de l’impensable banalité du mal. »
En 1963, Hannah Arendt est engagée par The New Yorker pour suivre le procès du criminel nazi Adolf Eichmann à Jérusalem. Le livre qu’elle en tire, Eichmann à Jérusalem, est sous-titré Rapport sur la banalité du mal. Elle n’emploie pourtant cette notion que dans une seule occurrence, hautement évocatrice. Ayant rapporté, de façon presque sarcastique, les paroles creuses et toutes faites du condamné avant sa pendaison – jusqu’alors, il ne pouvait se défaire des stéréotypes d’un langage qui le coupait de la réalité – elle conclut par ces mots : « Comme si, en ces dernières minutes, il résumait la leçon que nous a apprise cette longue étude sur la méchanceté humaine – la leçon de la terrible, de l’indicible, de l’impensable banalité du mal. »
D’aucuns ont reproché à Arendt son ton et son ironie à l’égard d’un homme que l’on aurait pu croire animé par les plus féroces appétits de la haine et de la cruauté, mais elle touchait juste : aux yeux de tous, Eichmann est apparu comme une personnalité ordinaire, fade et insignifiante, une espèce de marionnette tragi-comique dans son inconsistance et que rien n’aurait conduit à prendre au sérieux s’il n’avait été l’un des principaux organisateurs de la Solution finale (« Endlösung« ). C’est cet écart effrayant entre la médiocrité de l’homme et la monstruosité de ses crimes que désigne la « banalité du mal ».
jeudi, 07 mai 2020
Mise au poing : Scènes de boxe d'Elie Robert-Nicoud

Nul besoin d’avoir enfilé des gants et monté sur un ring pour apprécier ce petit et dense ouvrage. Avec verve et simplicité, Elie Robert-Nicoud (dont le père était boxeur professionnel devenu par la suite peintre), ne se contente pas de décrire la boxe comme un sport parmi tant d’autres, non, mais de raconter, force anecdotes à l’appui, la boxe comme un monde. Et pas n’importe lequel.
Un monde souvent sale et puant comme Stillman’s Gym, la salle mythique de l’université de la 8e Avenue de New-York, jamais nettoyée, empestant la poussière, la sueur et la fumée des cigares. Un monde où les boxeurs sont d’anciens voyous ayant fait leurs armes dans les bagarres de rue, les gangs et les vols à l’arraché (comme Mike Tyson dans le ghetto de Brownsville où il a grandit), voire de véritable gangsters sous la protection des parrains locaux (Al Capone qui embrasse Mickey Cohen sur les deux joues). Un monde où les pères refusent catégoriquement que leurs fils les suivent sur le ring mais finissent par les entraîner, les pousser à bout, les haïr même et pleurer dans leurs bras comme chez les Mayweather père et fils ou comme Joe et Enzo Calzaghe. Un monde qui fascine autant les jazzmen (Miles Davis, Willie Smith) que les cinéastes (King Vidor, Ed Bland, Ralph Nelson, Robert Wise, Scorsese, Michael Mann). Un monde de déracinés et d’immigrés accentuant les tensions ethniques par racisme ou accroche commerciale (« En Amérique, il y a eu les Irlandais, puis les Juifs, puis les Italiens, puis les Noirs, puis les Latinos et aujourd’hui les Slaves. Et c’est la même chose en France, les Juifs, les Arabes, les Gitans, les Italiens et les pauvres des villes… »).
Un monde où nombre de combats sont truqués par la pègre (ceux de Mohamed Ali contre Sonny Liston, gangster notoire) et où les boxeurs sont volés par leur manager (Don King étant l’archétype de l’escroc bariolé ayant commencé sa carrière par tuer un homme dans un caniveau). Un monde principalement masculin mais qui a vu naître une puncheuse exceptionnelle : Ann Wolfe, orpheline à 18 ans, dealer, SDF et championne du monde dans cinq catégories à la fois. Un monde où l’on peut tuer son adversaire d’un crochet à la mâchoire ou d’un uppercut dans l’estomac et dont le fantôme revient hanter le ring des années durant comme Max Baer dévoré par les morts de Frankie Campbell et d’Ernie Schaaf. Un monde d’adversité animale dans lequel les vainqueurs et les perdants se mélangent au sein de la même légende : Jake La Motta et Sugar Ray Robinson, Schmeling et Joe Louis, Micky Ward et Arturo Gatti, Ali et Joe Frazier. Un monde peuplés de techniciens hors-pair, combinant grâce et force brute, mais aussi un monde plus vaste et souterrain peuplé de seconds couteaux, parfois alcooliques et drogués, aux visages ravagés et à l’esprit en miette. Un monde sans pitié, écœurant mais dont, par une fascination masochiste et enivrante, il est impossible de se libérer.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
22:28 Publié dans Littérature | Tags : max baer, jake la motta, sugar ray robinson, ann wolfe, noble art, mohamed ali, sonny liston, joe et enzo calzaghe, mike tyson, al capone, mise au poing, scènes de boxe, elie robert-nicoud, le comptoir, sylvain métafiot | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 08 avril 2020
Stéphane Duval : « Le Lézard Noir a œuvré pour une meilleure reconnaissance de la BD alternative japonaise »

Article initialement paru sur Le Comptoir
C’est en 2004 que Stéphane Duval fonde la maison d’édition Le Lézard Noir (référence au roman éponyme d’Edogawa Ranpo) spécialisée dans la bande-dessinée japonaise dite « décadente » (buraiha), le romantisme noir et l’Ero guro (érotique grotesque). Diversifiant sa ligne éditoriale, le catalogue compte désormais plus de soixante titres, mêlant les mangas horrifiques de Suehiro Maruo, Kazuo Umezu ou Makoto Aida, aux romans graphiques d’avant-garde (Yaro Abe, Minetaro Mochizuki, Akino Kondoh), en passant par les ouvrages pour enfants et les livres d’architectures et de photographies japonaises (Atsushi Sakai, Yasuji Watanabe).
Le Comptoir : Ces dernières années, les ouvrages de votre maison d’édition ont obtenus une certaine reconnaissance : Prix Asie de la Critique ACBD pour Chiisakobé de Minetarô Mochizuki en 2016 et pour La Cantine de Minuit de Yaro Abe en 2017 ; Prix du patrimoine au Festival d’Angoulême pour Je suis Shingo Tome 1 de Kazuo Umezu en 2018. Ces récompenses s’inscrivent-elles, selon vous, dans la légitimation grandissante du manga (notamment pour adulte) en France ?
 Stéphane Duval : Il y a effectivement eu une bascule auprès du grand public et des médias ces dernières années. Le manga était jusqu’à peu considéré comme un bien de consommation mainstream, plutôt pour un lectorat ado et était boudé par une partie du public. Mis à part peut-être Akira (1982) de Katsuhiro Ōtomo qui était un ovni dans le paysage graphique. Je pense que le décloisonnement est venu par la publication de mangas dit d’auteurs, Gekiga (« dessins dramatiques ») et labélisés « roman graphiques ». Il y a eu L’Homme sans talent (1991) publié par la maison d’édition Ego Comme X et les mangas de Shigeru Mizuki ou Yoshihiro Tatsumi édité par Cornélius qui ont reçu des distinctions à Angoulême.
Stéphane Duval : Il y a effectivement eu une bascule auprès du grand public et des médias ces dernières années. Le manga était jusqu’à peu considéré comme un bien de consommation mainstream, plutôt pour un lectorat ado et était boudé par une partie du public. Mis à part peut-être Akira (1982) de Katsuhiro Ōtomo qui était un ovni dans le paysage graphique. Je pense que le décloisonnement est venu par la publication de mangas dit d’auteurs, Gekiga (« dessins dramatiques ») et labélisés « roman graphiques ». Il y a eu L’Homme sans talent (1991) publié par la maison d’édition Ego Comme X et les mangas de Shigeru Mizuki ou Yoshihiro Tatsumi édité par Cornélius qui ont reçu des distinctions à Angoulême.
En parallèle des éditeurs comme IMHO ou Le Lézard Noir ont œuvré pour une meilleure reconnaissance de la BD alternative japonaise en construisant des catalogues exigeants, mêlant patrimoine et mangas plus expérimentaux. La mise en avant du manga par des belles expositions au Festival d’Angoulême a également contribué à une meilleure reconnaissance de la bande dessinée japonaise. Au Lézard Noir j’ai progressivement ouvert le catalogue vers des titres plus grand public et littéraires en recherchant des mangas contemporains plus en phase avec ce que je connaissais du Japon et de sa culture. Les séries Le Vagabond de Tokyo, Chiisakobé et La Cantine de Minuit avec leurs thématiques plus sociétales et contemporaines en sont les exemples les plus marquants.
14:03 Publié dans Littérature | Tags : stéphane duval, le lézard noir, bd alternative japonaise, manga, le comptoir, sylvain métafiot, kazuo umezu, sade, bataille, ero guro, le vagabond de tokyo, chiisakobé, la cantine de minuit, suehiro maruo | Lien permanent | Commentaires (1)
jeudi, 26 mars 2020
Dante et saint Augustin, millénarisme et théorie politique

Article initialement paru sur Philitt
Poète mais également homme politique et penseur chrétien, Dante Alighieri développe l’idée que la monarchie terrestre peut restaurer la pureté humaine d’avant la Chute. Il dégage le pouvoir de l’intellect humain, désormais libre, substituant en cela la notion d’humanité à celle de chrétienté. Une vision qui fait suite aux réflexions d’Augustin d’Hippone sur la dualité entre Empire et Royaume divin dans l’Empire romain chrétien, un millénaire plus tôt.
En 1295, en pleine opposition florentine entre guelfes (partisans du Pape) et gibelins (partisans de l’Empereur) Dante Alighieri fait son entrée dans la vie publique. Proche des guelfes blancs (famille Vieri de’Cerchi) il est exilé et condamné à mort par le clan des guelfes noirs (famille Donati) en 1302. Le 31 mars 1311 l’auteur de La Divine Comédie écrit une lettre (5e Épître) à tous les princes d’Italie pour annoncer le triomphe d’Henri VII venu, selon lui, libérer les Italiens de l’esclavage dans lequel ils se trouvent. Dans cette invective contre la résistance de la commune de Florence, Dante stigmatise la rébellion des partisans du pape contre l’empereur. Or, dans d’autres textes, le poète dénonce l’état de corruption dans lequel se trouvent certaines terres de l’Empire, dont l’Italie.
Dans le chant XVI du Purgatoire, Dante et Virgile cherchent leur chemin à travers l’épaisse fumée du cercle des ombres abandonnées à la colère. Ils rencontrent Marc Lombard qui, à travers ses paroles, leur sert de guide. Il leur parle des causes de la corruption contemporaine, expliquant l’origine de l’âme et exposant l’opposition entre le passé et la coexistence des deux soleils (l’empereur et le pape).
20:58 Publié dans Littérature | Tags : dante et saint augustin, millénarisme et théorie politique, la cité de dieu, bernard de clairvaux, philitt, sylvain métafiot, la monarchie universelle | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 16 mars 2020
Labyrinthe mental : Dédales de Charles Burns

Attablé dans une cuisine, à l’écart de la fête battant son plein, Brian, un jeune homme dessine une étrange créature (« alien compressé« , poulpe astral) sur un carnet en observant, hébété, son reflet déformé dans le grille-pain posé devant lui. « Ça m’a pris du temps avant de me rendre compte que j’étais en train de dessiner un autoportrait« , comprend-t-il après un temps de latence hypnotique avant que Laurie vienne le rejoindre et trouble son univers psychique.
Dédales est sans conteste l’œuvre la plus autobiographique de Charles Burns. L’histoire d’un jeune homme enfermé en lui-même, déphasé, ayant du mal à communiquer avec les autres et n’ayant que le désir d’être compris à travers ses dessins ou les images de films fantastiques. Brian crée ainsi des petits court-métrages d’horreur en Super 8 avec son ami Jimmy (« le film parle de tous les trucs tordus qui se passent dans ma tête« ). Dans son enfance, Burns n’était pas indifférent à ce genre de production vidéos mises en avant dans Monster Magazine. Ce n’est donc pas un hasard si Brian emmène Laurie voir L’Invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel au cinéma et si, profondément ému, il verse des larmes durant la projection. Car comment être normal dans une société dépourvue de sens ? Ne sommes-nous pas comme les extraterrestres du film, possédant une forme humaine mais « privés de sentiments et d’espoir » ?
Charles Burns est coutumier du fait de nous entraîner dans de sombres terriers débouchant sur des univers cauchemardesques mettant à nu le caractère faussement familier de l’Amérique des années 50 / 60. Que l’on songe à la trilogie Toxic (mélange improbable entre Tintin et David Lynch) où entraîné – par un chat noir faisant office de lapin blanc – derrière la cloison d’une chambre se trouve un monde abject et fantastique reflétant les tourments psychologiques de son héros. Ou Black Hole dans lequel une sorte de malédiction mi-biologique mi-surnaturelle infecte monstrueusement les adolescents après chaque rapport sexuel (un thème qui sera repris dans le terrifiant film It Follows de David Robert Mitchell). Poursuivant ainsi son exploration du mal-être adolescent et du sentiment de perte (des personnes que l’on aime, des objets d’enfance, des lieux et leur histoire) nul doute que la suite de Dédales nous emmènera encore plus loin dans les recoins ténébreux de la quête d’identité.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
15:07 Publié dans Littérature | Tags : labyrinthe mental, dédales, charles burns, sylvain métafiot, le comptoir, bd | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 02 mars 2020
Le plaisir dans le crime

« Le duc voulut soutenir au souper que si le bonheur consistait dans l'entière satisfaction de tous les plaisirs des sens, il était difficile d'être plus heureux qu'ils l'étaient.
- Ce propos-là n'est pas d'un libertin, dit Durcet. Et comment est-il que vous puissiez être heureux, dès que vous pouvez vous satisfaire à tout instant ? Ce n'est pas dans la jouissance que consiste le bonheur, c'est dans le désir, c'est à briser les freins qu'on oppose à ce désir. Or, tout cela se trouve-t-il ici, où je n'ai qu'à souhaiter pour avoir ? Je fais serment, dit-il, que, depuis que j'y suis, mon foutre n'a pas coulé une seule fois pour les objets qui y sont ; il ne s'est jamais répandu que pour ceux qui n'y sont pas. Et puis d'ailleurs, ajouta le financier, il manque selon moi une chose essentielle à notre bonheur : c'est le plaisir de la comparaison, plaisir qui ne peut naître que du spectacle des malheureux, et nous n'en voyons point ici. C'est de la vue de celui qui ne jouit pas de ce que j'ai et qui souffre, que naît le charme de pouvoir se dire : Je suis donc plus heureux que lui. Partout où les hommes seront égaux et où ces différences-là n'existeront pas, le bonheur n'existera jamais. C'est l'histoire d'un homme qui ne connaît bien le prix de sa santé que quand il a été malade.
- Dans ce cas-là, dit l’évêque, vous établiriez donc une jouissance réelle à aller contempler les larmes de ceux que la misère accable ?
- Très assurément, dit Durcet, il n'y a peut-être point au monde de volupté plus sensuelle que celle dont vous parlez là.
- Quoi, sans les soulager ? Dit l'évêque, qui était bien aise de faire étendre Durcet sur un chapitre si fort du goût de tous et qu'on le connaissait si capable de traiter à fond.
20:00 Publié dans Littérature | Tags : le plaisir dans le crime, sade, les 120 journées de sodome, curval, durcet, le duc, l'évêque, philosophes scélérats | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 24 février 2020
Métaphysique de la technique : L’Homme et la machine de Nicolas Berdiaeff
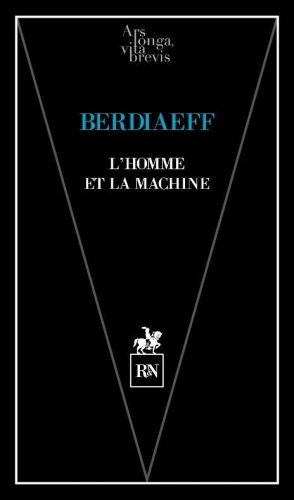 Trois ans après avoir fait (re)paraître L’Homme et la technique d’Oswald Spengler – décryptant ce qu’il appelle la « culture Faustienne » de l’Occident – les éditions R&N publient un nouveau petit essai critique sur la modernité de la première moitié du XXe siècle : L’Homme et la machine de Nicolas Berdiaeff (1874-1948). Philosophe existentialiste chrétien, Berdiaeff explore dans ce court essai paru en 1933 les conséquences de l’apparition de la machine, « la plus grande révolution voire la plus terrible de toute l’histoire humaine ».
Trois ans après avoir fait (re)paraître L’Homme et la technique d’Oswald Spengler – décryptant ce qu’il appelle la « culture Faustienne » de l’Occident – les éditions R&N publient un nouveau petit essai critique sur la modernité de la première moitié du XXe siècle : L’Homme et la machine de Nicolas Berdiaeff (1874-1948). Philosophe existentialiste chrétien, Berdiaeff explore dans ce court essai paru en 1933 les conséquences de l’apparition de la machine, « la plus grande révolution voire la plus terrible de toute l’histoire humaine ».
Analysant le concept de la technique sous un angle sociologique et métaphysique, Berdiaeff montre que ce fait « tragique » bouleverse notre culture tant matériellement qu’économiquement mais aussi spirituellement : « Deux éléments coexistent toujours dans la culture : l’élément technique et l’élément organique ; et c’est la victoire définitive du premier sur le second marque la dégénérescence de la culture en quelque chose qui ne l’est plus ». Comme le note justement Edouard Schaelchli dans sa préface : « loin de se laisser comprendre comme un simple phénomène matériel, [le phénomène technique] s’impose à l’esprit et détermine une attitude à son égard qui s’apparente plus qu’à une forme d’aliénation, à une véritable forme d’adoration, d’idolâtrie. » Difficile de lui donner tort quand on voit le culte que certains de nos contemporains vouent à leur smartphone au point de ressentir une angoisse panique en cas de perte (« j’ai toute ma vie dedans », suffoquent-ils).
Ayant fait sa révolution industrielle au XIXe siècle, la machine poursuivit ainsi son inexorable marche en avant au siècle suivant portée par les hourras des progressistes qui semblaient avoir oubliés cette mise en garde de Victor Hugo : « Sans cesse le progrès, roue au double engrenage, Fait marcher quelque chose en écrasant quelqu’un. » Plus proche de Nietzsche, Schelling ou Kierkegaard, Berdiaeff ne dit pas autre chose lorsqu’il décrit la révolte de la créature face à une force qui peut, par les armes, détruire toute l’humanité : « L’esprit prométhéen chez l’homme ne parvient pas à maîtriser la technique qu’il a lui-même engendrée, il ne peut venir à bout de ces énergies nouvelles qu’il a déchaînées. » Pour autant, le philosophe russe n’idéalise pas un retour au passé (« le passé tel qu’il nous séduit a été affranchi et purifié par notre imagination créatrice de tout ce qu’il comportait de laideur et d’injustices ») et s’il lui est inconcevable de tolérer l’autonomie de la machine, il ne rejette pas tous les torts sur elle : « la machine n’est qu’une projection » du processus global de déshumanisation et la libération de l’homme n’adviendra que par « une conscience qui placera celui-ci au-dessus de la nature et de la société, qui placera l’âme humaine au-dessus de toutes les forces sociales et cosmiques qui devront lui être assujetties ».
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
12:35 Publié dans Economie, Littérature | Tags : nicolas berdiaeff, le comptoir, sylvain métafiot, l’homme et la machine, éditions r&n | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 04 février 2020
Nietzsche contre la culture barbare
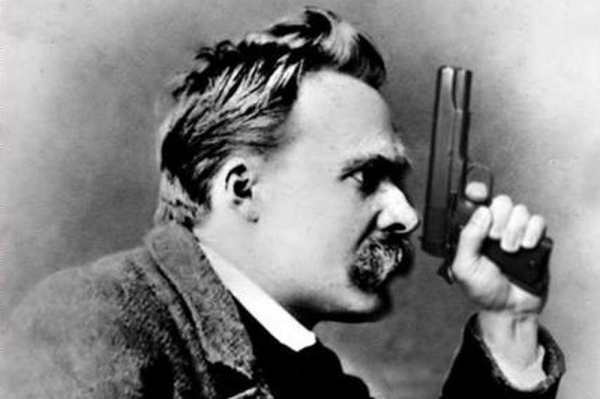
Article initialement paru sur Le Comptoir
Rédigée en 1873 à Bâle, et sous-titré « De l’utilité et de l’inconvénient des études historiques pour la vie », la « Seconde Considération Inactuelle » fait partie d’une série de quatre traités polémiques dans lesquels le philosophe Friedrich Nietzsche parcourt l’échelle de ses intimités. Il combat une conception purement contemplative du savoir historique conçue comme une fin en soi et découplée de la vie. Pour lui, la connaissance doit permettre de vivre et d’agir.
Ce que son époque considère comme une vertu Nietzsche le considère comme un vice : « nous souffrons tous d’une consomption historique ». Dénonciateur autant que guérisseur, il souhaite ainsi renverser le courant, « contre le temps, et par là même sur le temps en faveur d’un temps à venir ».
« Je déteste tout ce qui ne fait que m’instruire sans augmenter mon activité. » Goethe
Le poids du passé
Le premier paragraphe de la Seconde Considération Inactuelle porte sur l’ambivalence du passé. D’un coté, le passé pèse sur l’homme comme un fardeau invisible parce qu’il s’en souvient, c’est la mémoire qui signe sa prégnance à force de le ruminer. Cette charge nuit à l’homme et l’anéantit car le ressassement empêche l’action : plongés dans nos regrets nous délaissons l’avenir. D’un autre coté, l’oubli est une condition de l’action et du bonheur car agir suppose être dans le présent et orienté vers le futur. Dans ce cas, le passé peut peser comme un acquis.
21:37 Publié dans Littérature, Politique | Tags : nietzsche contre la culture barbare, le comptoir, sylvain métafiot, seconde considération inactuelle | Lien permanent | Commentaires (0)