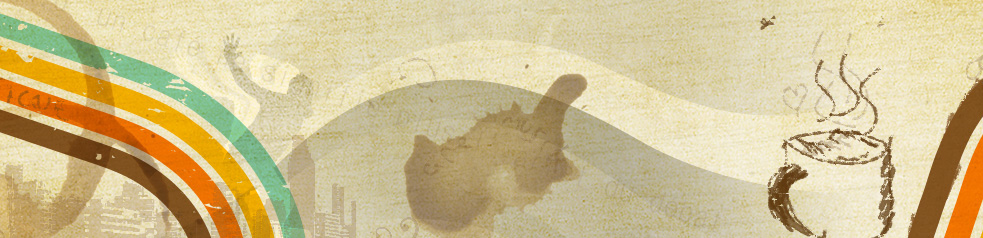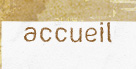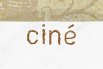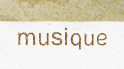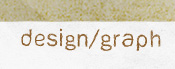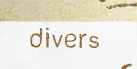mardi, 21 mai 2019
L’humanisme italien et la genèse du capitalisme

Article initialement publié sur Le Comptoir
Dans le domaine de la recherche historiographique du XXe siècle, les notions d’humanisme, de républicanisme et de renaissance ont toutes trois été liées à la thèse suivante : l’élaboration d’une pensée politique centrée sur l’homme, la liberté politique comme participation au bien commun. À travers les travaux d’historiens tels que Jacob Burckhardt, Max Weber, Werner Sombart, Hans Baron ou John Pocock, se déploie ainsi la question de l’apparition de la modernité européenne et des origines du capitalisme.
Le terme d’humaniste était employé couramment dès le XVIe siècle, tandis que l’humanisme apparaît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en Allemagne, et en France grâce à Jules Michelet. Cette notion correspondait à une période d’émancipation de la pensée qui contestait l’hégémonie de la religion.
La Renaissance et les idéaux culturels du XIXe siècle
Dans l’historiographie germanophone, l’œuvre de l’historien et philosophe Jacob Burckhardt a eu une influence énorme sur la manière de se représenter l’Italie, notamment à travers trois ouvrages importants : L’Époque de Constantin le grand (1853) ; Guide de l’art antique et de l’art moderne en Italie (1855) ; La Civilisation de la Renaissance en Italie (1860). Dans ce dernier, celui qui nous intéresse, il cherchait à définir l’attitude des hommes, à une certaine époque, devant le monde, souhaitant isoler un moment particulier de l’esprit humain. Il passe ainsi en revue des thématiques telles que : l’État considéré comme œuvre d’art, le développement de l’individu, la résurrection de l’Antiquité, la sociabilité et les fêtes, les mœurs et la religion.
16:08 Publié dans Politique | Tags : historiographie, le comptoir, sylvain métafiot, l’humanisme italien et la genèse du capitalisme, jacob burckhardt, max weber, werner sombart, hans baron, john pocock | Lien permanent | Commentaires (0)