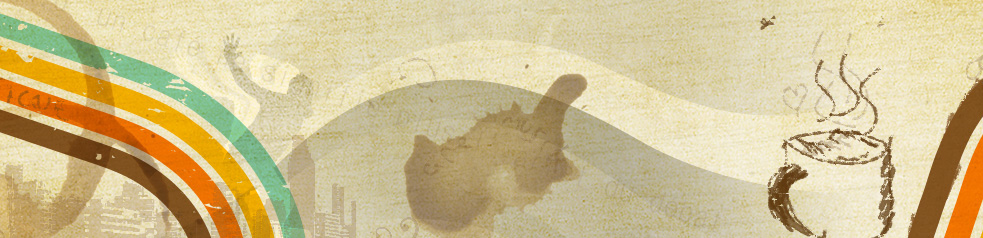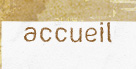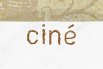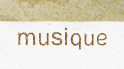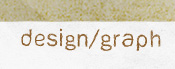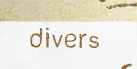vendredi, 30 juin 2017
Thomas Bourdier : « La vraie subversion des auteurs réside dans leurs paradoxes »
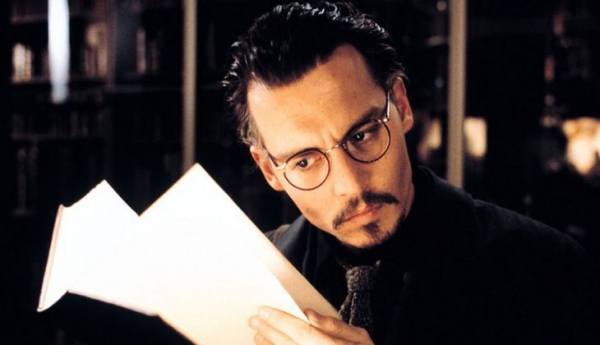
Article initialement publié sur Le Comptoir
En créant la maison d’édition RN, Thomas Bourdier souhaitait regrouper une pléiade d’écrivains, d’essayistes, de poètes et de philosophes hors normes trop vite enterrés par le conformisme littéraire. Un travail d’exhumation des grandes œuvres oubliées du XXe siècle, permettant de remettre en pleine lumière la puissance intemporelle d’écrits aussi remarquables que ceux de Simone Weil, Pierre Drieu la Rochelle, Bernard Charbonneau, Robert Musil, Oswald Spengler, Miguel Espinosa, Ludwig Klages ou Miguel de Unamuno.
Le Comptoir : Pourquoi monter une maison d’édition aujourd’hui alors que le secteur semble plutôt moribond ?
 Thomas Bourdier : Je tiens à préciser que le critère qui a présidé à la création de RN n’était heureusement pas économique. C’était plus simplement la volonté forte d’éditer, publier et promouvoir des textes que nous aimons et des auteurs que nous admirons, comme c’est le cas, j’espère, pour tout éditeur qui se respecte. Et puis faire quelque chose qui a du sens, qui s’inscrive dans une filiation, qui n’est pas voué à disparaître en même temps que l’époque qui l’a vu naître… Soren Kierkegaard a dit qu’« on ne se lasse que du nouveau » ; un sentiment que nous partagions, en ces temps de publications hâtives et de changement perpétuel.
Thomas Bourdier : Je tiens à préciser que le critère qui a présidé à la création de RN n’était heureusement pas économique. C’était plus simplement la volonté forte d’éditer, publier et promouvoir des textes que nous aimons et des auteurs que nous admirons, comme c’est le cas, j’espère, pour tout éditeur qui se respecte. Et puis faire quelque chose qui a du sens, qui s’inscrive dans une filiation, qui n’est pas voué à disparaître en même temps que l’époque qui l’a vu naître… Soren Kierkegaard a dit qu’« on ne se lasse que du nouveau » ; un sentiment que nous partagions, en ces temps de publications hâtives et de changement perpétuel.
Concernant la santé économique du secteur, je ne pense pas que votre constat soit si fondé que ça : si l’on regarde attentivement le marché dans lequel nous nous insérons, plutôt haut-de-gamme, cela reste encourageant. Disons que ça fonctionne, assez pour tenter des choses à la fois folles et sensées. Il y a et aura toujours ce noyau de grands lecteurs auxquels nous nous adressons et auxquels s’adressent des maisons qui nous inspirent telles que Le bruit du temps d’Antoine Jaccottet, les Éditions de l’éclat de Michel Valensi, les Éditions Pierre-Guillaume de Roux, la collection de Jean-Claude Zylberstein aux Belles Lettres ou encore Allia, dont nous apprécions l’esprit entrepreneurial. Anatolia aussi, de Samuel Brussell, même si la collection n’existe plus. Si l’on ne croit pas à l’existence de ce noyau, alors on peut tourner la page de l’édition traditionnelle tout de suite…
Je crois qu’il y a surtout un renouvellement du paysage éditorial français qui est en cours, et que c’est le moment de se lancer, si l’on sait où l’on veut aller. Après la mort de grands éditeurs (Dimitrijevic, Maspéro, Pauvert, Bourgois, etc.), on a en effet assisté à une fin de cycle. Certaines maisons ont, je crois, eu du mal à gérer cette fin de cycle, à renouveler ou à mettre en valeur l’entièreté de leurs catalogues, presque trop riches, ce qui renforce d’ailleurs ma conviction qu’une maison d’édition, c’est avant tout une personnalité, plus qu’une entreprise. C’est la ligne éditoriale, l’énergie et la vision qui priment sur tout le reste. Il y a beaucoup à reprendre dans ce vivier de titres épuisés et à intégrer une ligne nouvelle où l’on trouve aussi de nombreux inédits, afin que et les uns et les autres se soutiennent et créent des constellations éditoriales originales. C’est dans ce cadre que nous souhaitons nous insérer, avec mon ami et associé William Allais. Je précise que notre envie est pré-macronienne et que nous savons que nous avons tout de même peu de chances de devenir milliardaires à travers RN…
11:12 Publié dans Littérature | Tags : thomas bourdier, rn editions, sylvain métafiot, littérature, simone weil, pierre drieu la rochelle, bernard charbonneau, robert musil, oswald spengler, miguel espinosa, ludwig klages, miguel de unamuno, le comptoir, la vraie subversion des auteurs réside dans leurs paradoxes | Lien permanent | Commentaires (0)