« Guy Marignane : « Il y a une extraordinaire matière poétique chez Sade » | Page d'accueil | Timothée Gérardin : « Nolan fond ses concepts dans de pures expériences sensorielles » »
lundi, 17 août 2020
Cécile Villaumé : « Nous baignons dans une rhétorique médiatique confite de niaiserie »

Cécile Villaumé est écrivain. Son premier ouvrage, « Des écrivains imaginés » (Le Dilettante, 2019), peut être défini comme un recueil de biographies non-autorisées oscillant entre le pastiche et la chronique sociale. Naviguant entre les époques, elle détourne ainsi, d’une plume érudite et malicieuse, la vie intime d’auteurs célèbres ou les place en arrière-plan de l’Histoire tout en brocardant d’un humour parfois cruel certains traits de la bêtise actuelle, celle qui coche toutes les cases de la bien-pensance littéraire et du politiquement correct.
Le Comptoir : Dans votre livre vous vous plaisez à réinventer certains moments de la vie de divers écrivains, parfois à travers l’intermédiaire de personnages contemporains, comme l’universitaire Josyane Taupin-Miflu ou le fonctionnaire municipal Arthur Quenouille. Que représentent-ils à vos yeux ?
 Cécile Villaumé : Disons que ce sont des synthèses de personnages que j’ai pu observer dans la réalité. Je n’ai pas eu à aller bien loin. Pour Josyane Taupin-Miflu, j’ai utilisé des souvenirs d’université, et aussi les débats sur l’écriture dite « inclusive ». Comme tous les « débats » actuels ils sont construits sur le modèle de celui des Monty Python, c’est-à-dire « ce soir pour parler de la pornographie, nous inviterons l’archevêque de Cantorbéry et un homme nu ». Un des invités se devait donc d’incarner la Pensée Réactionnaire, (type Alain Finkelkraut, un Académicien, etc.) En face, il y avait un chercheur chargé de rééduquer le bon peuple en lui expliquant que la langue faisait preuve d’une violence intolérable depuis des siècles, et qu’il avait fait des recherches car au XVIe siècle on disait « autrice », que le masculin qui en grammaire l’emporte sur le féminin c’est la Culture du Viol, etc. Ces chercheurs étaient de toute évidence ravis de s’ébrouer au soleil médiatique après des années d’anonymat et souvent une carrière assez modeste. Ils trouvaient, à la lumière des plateaux un nouveau souffle, s’habituaient (ce n’était pas très difficile) à résumer leur pensée en une seule phrase ornée d’un ou deux slogans-choc.
Cécile Villaumé : Disons que ce sont des synthèses de personnages que j’ai pu observer dans la réalité. Je n’ai pas eu à aller bien loin. Pour Josyane Taupin-Miflu, j’ai utilisé des souvenirs d’université, et aussi les débats sur l’écriture dite « inclusive ». Comme tous les « débats » actuels ils sont construits sur le modèle de celui des Monty Python, c’est-à-dire « ce soir pour parler de la pornographie, nous inviterons l’archevêque de Cantorbéry et un homme nu ». Un des invités se devait donc d’incarner la Pensée Réactionnaire, (type Alain Finkelkraut, un Académicien, etc.) En face, il y avait un chercheur chargé de rééduquer le bon peuple en lui expliquant que la langue faisait preuve d’une violence intolérable depuis des siècles, et qu’il avait fait des recherches car au XVIe siècle on disait « autrice », que le masculin qui en grammaire l’emporte sur le féminin c’est la Culture du Viol, etc. Ces chercheurs étaient de toute évidence ravis de s’ébrouer au soleil médiatique après des années d’anonymat et souvent une carrière assez modeste. Ils trouvaient, à la lumière des plateaux un nouveau souffle, s’habituaient (ce n’était pas très difficile) à résumer leur pensée en une seule phrase ornée d’un ou deux slogans-choc.
Il y a un côté un peu émouvant et très humain (ils ne veulent pas mourir), mais très inquiétant en ce qui concerne l’état de la recherche en France dans le domaine littéraire et historique. Plutôt que de leur donner un espace de parole où déployer une vraie pensée, le passage par la moulinette des medias les pousse à renoncer à la rigueur intellectuelle que devrait garantir leur fonction.
Quant à Arthur Quenouille, qui toilette un écrivain dont il n’a jamais lu une ligne pour des raisons touristiques, je n’ai pas eu à chercher loin non plus. Dans un pays comme le nôtre qui s’est engagé sur la voie du tourisme à outrance, il devient presque miraculeux de trouver un bourg qui n’est pas hanté par un festival quelconque, une maison natale, un musée, etc. Ces personnalités (plus ou moins) locales, il faut naturellement les rendre présentables aux yeux du visiteur d’aujourd’hui : c’est-à-dire qu’ils doivent être ouverts aux autres, contre les inégalités, irréprochables sur le plan sexuel… quand bien même ces concepts n’avaient pas de sens à leur époque. Le mieux c’est quand ils ont été méconnus : et souvent en visitant ce genre d’endroit j’imaginais les commissaires d’expositions, les gars qui avaient rédigé les panonceaux.
De Kleist à Marguerite Duras, en passant par Proust et Dostoïevski, la liste est pour le moins éclectique. Sont-ce les écrivains qui, pour la plupart, ont marqué votre vie de lectrice ? Ou bien est-ce leurs destins respectifs qui se prêtent particulièrement au genre de la parodie ?
D’abord, j’ai été parfaitement opportuniste : j’ai pris ceux qui avaient été mêlés à des faits divers (Duras, Colette, Nerval, Doyle – c’est sans doute une légende urbaine, mais ça faisait une bonne chute ! –). Ensuite il y a ceux dont la vie a des aspects d’humour noir : Charles d’Orléans, qui est passé complètement à côté de Jeanne d’Arc, et se croyait un homme indispensable alors que plus personne ne l’attendait ; Mallarmé, dont les poèmes contrastent tellement avec le prosaïsme de ses rapports d’inspection ; Proust, que la comtesse Greffuhle, ivre d’elle-même, tolérait avec un peu d’agacement, Dostoïevski en Suisse, l’oxymore absolu.
J’ai découvert Marguerite Duras assez tard, pendant mes études, et j’ai lu ses romans avec une stupeur tempérée par une prodigieuse envie de dormir. Quand j’ai eu vent du rôle qu’elle avait joué dans l’affaire Grégory, sa grille de lecture délirante, son crime qui a existé, Médée dans les Vosges, je me suis dit qu’il y avait vraiment un boulevard (que je me suis empressée de prendre).
« Ce que j’aime chez Léon Bloy c’est sa capacité à identifier les vaches sacrées d’une époque et à taper dessus. »
Je ne connaissais pas Antoinette Deshoulières avant de lire dans Télérama, un article où une chercheuse expliquait qu’elle avait été négligée car elle était une femme. Je suis allée voir son œuvre et au vu de ce que j’ai lu, j’ai trouvé déjà beau que son nom ait figuré dans le Larousse jusque dans les années 30. Notez que je suis peut-être insensible au genre de l’églogue…
Sinon il y a Pergaud, dont je trouve qu’il n’a pas la reconnaissance qu’il mériterait : les adaptations de La Guerre des boutons sont douloureuses, et ne rendent pas justice au livre.

Il est dit que vous aimez Léon Bloy. La verve enragée et le génie comique du mendiant ingrat vous ont-ils spécialement inspirée pour la rédaction de cet ouvrage ?
Bloy atteint des sommets dans l’injure que je serais bien en peine d’égaler ! Ce que j’aime chez lui, aussi, c’est sa capacité à identifier les vaches sacrées d’une époque et à taper dessus. Il était en-dehors : il détestait absolument tout le monde et attendait l’Apocalypse pour voir flamber Huysmans et Bourget par l’opération du Saint-Esprit. Ce qui est fort, c’est qu’il a identifié certaines de nos plaies actuelles cent ans avant tout le monde (il préconisait notamment d’arroser les touristes en voiture avec des pompes à purin ! Si on l’avait écouté !).
Nous baignons dans une rhétorique médiatique confite de niaiserie. Elle est le pendant de tout un tas de lâchetés que nous tolérons tant que notre confort n’est pas menacé ; dans ces conditions, la lecture de Bloy est roborative.
Chez certains journalistes on entend souvent, à propos de telle ou telle œuvre, qu’elle serait d’une « brûlante actualité ». A contrario, nombre de romans, poèmes ou films font l’objet de censures ou de boycott sous prétexte de véhiculer des « valeurs d’un autre âge ». Pensez-vous que l’on a franchi un nouveau cap dans l’art dit « engagé » ?
Certains journalistes ont la « brûlante actualité » facile, d’autant que ce sont eux qui la font, l’actualité. Avec quelques années de recul on découvre parfois que des œuvres importantes sont passées complètement sous les radars, écrasées sous l’actualité justement : des « phénomènes » (comme Le Nouveau Roman, par exemple) ou des « événements littéraires » qui bénéficient d’un succès de scandale. Bon, c’est dû aussi à l’énorme production, je ne vois pas comment un critique littéraire pourrait tout lire, à moins d’être trappiste (et dispensé de messes). Comme l’œuvre d’art aujourd’hui contient souvent, par principe, un côté qui cherche le scandale, je vais vous répondre sur l’histoire des « valeurs d’un autre âge ». Concernant les œuvres du passé, on voit fleurir des scandales, des indignations, et il ne faut pas être naïf à mon avis : sans doute, il y a des œuvres qui ne sont plus perçues de la même manière qu’autrefois. Mais ces « polémiques » sont aussi liées à une certaine perte du sens du symbolique. Quand vous racontez le mythe de Zeus à des sixièmes, ils sont horrifiés car Chronos mange ses enfants. Les troisièmes, normalement, ont compris le truc. J’ai des fois l’impression que beaucoup de gens sont restés ou font mine de rester au stade des sixièmes.
Car il est évident que ces indignations, souvent surjouées, sont une façon pour certains groupes, association d’exister, comme Josyane Taupin-Miflu avec son églogue. Le champ littéraire, artistique étant très restreint, quand on n’a pas beaucoup de talent, ou bien qu’on veut aller vite, il est plus facile de mettre un coup de projecteur sur un scandale ou supposé tel.
De la même manière, ces indignations sont mises en épingle par certains journalistes, parce que ça demande peu de travail (il suffit d’organiser plusieurs débats à la Monty Python), et je présume que c’est toujours plus facile de se demander si Rubens n’était pas sexiste, que d’aller lire des livres sur la période et fournir un vrai travail .Dans une période d’immédiateté comme la nôtre où il y a un refus du temps long, les questions doivent être courtes, et simples. Voilà pourquoi on se retrouve à devoir dire « oui ou non » à des questions mal posées.
Grosso modo, ce qui ressort de ces « polémiques » c’est la vision du Passé. C’est celle d’Arthur Quenouille : une atroce période indéterminée dans laquelle tout le monde était raciste et ultraviolent, balayée par l’âge d’or radieux que nous avons fait advenir.

J’ai un jour vu un livre qui s’appelait, je le jure, Le Monde avant me too : y étaient pareillement cloués au pilori La Belle au bois dormant et des publicités où la femme s’extasiait devant une machine à laver. Est-il possible d’amalgamer une œuvre littéraire à une publicité ? Les gens qui écrivent ce genre de livres croient-ils réellement que toutes les femmes du monde ont vécu un âge de ténèbres depuis la préhistoire jusqu’au moment où Caroline de Haas est allée déposer les statuts de sa petite entreprise ?
Si vous exprimez la moindre nuance, M. Homais sort de la boîte : « Comment, vous osez ? Et les antibiotiques ? Les Droits de l’Enfant ? Ma grand-mère a accouché dans un champ de pommes de terre, etc. ». Incarnation de ce phénomène, le Michel Serres dernière période. Il avait tout vu à Hiroshima. Ce n’était pas mieux avant disait-il, car j’ai connu avant ! Il y avait Hitler et Mussolini ! D’ailleurs sa tante (ou sa cousine) était morte d’une angine. Alors vous voyez bien ! Tout le monde applaudissait sur le plateau. Il avait même écrit un livre, C’était mieux avant !, je crois, où il disait que ce n’était pas mieux, avant. La richesse d’un tel raisonnement ne laisse pas d’interroger. Je n’ai jamais vu personne demander à M. Serres si ce n’était pas mieux avant pour les petits paysans qui n’avaient pas encore été expropriés de leurs terres pour aller grossir des bidonvilles à cause de la sécheresse ou des multinationales.
Je crois qu’une œuvre d’art ancienne doit être expliquée et qu’il y a suffisamment aujourd’hui de matière à débats véritables pour qu’on n’aille pas soumettre les œuvres du passé à nos principes moraux. Il est vrai qu’il est plus confortable de boycotter Gauguin qu’Amazon.
Partagez-vous l’opinion de Pasolini qui, dans ses Lettres Luthériennes (1975), déplorait le remplacement de l’art (la culture humaniste) par une nouvelle culture hédoniste de consommation du fait de l’avènement d’une société de pouvoir consumériste et de divertissement télévisuel ?
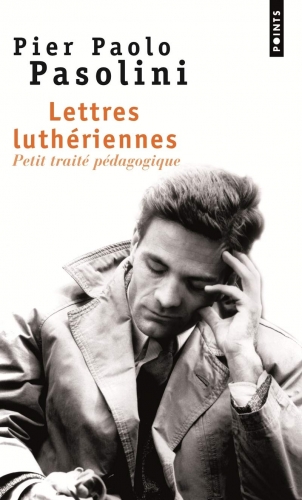 Comment ne pas être d’accord avec Pasolini ? Il avait raison avant tout le monde (et sans vouloir voir les gens brûlés par l’Esprit Saint, lui !) : il est évident que nous vivons dans une forme de système totalitaire : aucun aspect de la vie ne lui échappe, de la sexualité (sur le mode de l’injonction cool) au langage, qui est travaillé de l’intérieur et vidé de son sens, à force de répétition, de simplification, d’appauvrissement. Ne parlons pas non plus de cette pauvre farce qu’est devenue la culture populaire, produite en masse par des majors, de la laideur infinie de toutes ces créations.
Comment ne pas être d’accord avec Pasolini ? Il avait raison avant tout le monde (et sans vouloir voir les gens brûlés par l’Esprit Saint, lui !) : il est évident que nous vivons dans une forme de système totalitaire : aucun aspect de la vie ne lui échappe, de la sexualité (sur le mode de l’injonction cool) au langage, qui est travaillé de l’intérieur et vidé de son sens, à force de répétition, de simplification, d’appauvrissement. Ne parlons pas non plus de cette pauvre farce qu’est devenue la culture populaire, produite en masse par des majors, de la laideur infinie de toutes ces créations.
« Je pense qu’aujourd’hui, dans ce pays de sucre candi frelaté, la tâche du romancier est de dévoiler des faux-semblants. »
Tout cela n’est pas sans incidence sur l’être humain : le néo-homme vers qui tend tout cet effort sans liens, sans affects profonds et durables, doté d’un langage simpliste et qui communique uniquement par images. C’est à mon avis le problème de l’écrivain d’aujourd’hui, de décrire cette humanité-là. C’est d’autant plus difficile que l’on en fait partie !
Philippe Muray affirmait que « si les livres, et de manière plus particulière les romans, servent à quelque chose, c’est à rendre la possibilité du Mal envisageable ». Quels sont pour vous les romanciers qui arrivent à atteindre un tel but ?
J’ai un peu de mal avec les définitions des genres littéraires : il y a tellement de grands romans qui ne correspondent pas à cette définition Le Roman de Miraut de Pergaud (1913) par exemple, et des romans littéralement enchanteurs, les Fantômas, Gustave Lerouge, Ponson du Terrail, Eugène Sue…
Mais c’est vrai que je pense que certains vrais romanciers arrivent à rendre la possibilité du mal pour le lecteur au sens où le Mal n’est pas quelque chose d’extérieur au héros, mais une possibilité pour le héros, et donc pour le lecteur. C’est ce que font Balzac ou Dostoïevski : on suit un personnage dont on ne sait pas s’il est bon ou mauvais finalement, qui est peut-être une crapule, va en devenir une.
Plus généralement, je pense qu’aujourd’hui, dans ce pays de sucre candi frelaté, la tâche du romancier est de dévoiler des faux-semblants. Pas à la manière des ligues de tempérance, au nom d’une supposée pureté, vertu, etc., mais en montrant les dieux de l’époque. Mais dans le résultat final les obsessions du romancier comptent autant que le programme qu’il s’est fixé : pour Flaubert, le Mal, c’est un pharmacien dissertant derrière son comptoir. Pour Stendhal, un ecclésiastique haineux. Pour Muray une crèche, ou un jardin d’enfants. À chacun sa chimère, non ?
Sylvain Métafiot
Nos Desserts :
- Se procurer l’ouvrage de Cécile Villaumé chez votre libraire
- La philosophe Carole Talon-Hugon assure qu’« Une œuvre peut être admirable en dépit d’un défaut éthique »
- Lire notre article « Pasolini, pourfendeur du fascisme de consommation »
- L’éditeur Thomas Bourdier affirme que « La vraie subversion des auteurs réside dans leurs paradoxes »
- Article sur le blog d’Agnès Giard « Pourquoi il faut se méfier de MeToo »
- Dans La Revue du Comptoir #2 nous avons interrogé François Angelier, auteur d’une biographie de Léon Bloy
- Lire aussi sur Zone Critique « Léon Bloy ou la fureur de Dieu »
Article initialement publié sur Le Comptoir
12:12 Publié dans Littérature | Tags : bêtise, bien-pensance littéraire, politiquement correct, cécile villaumé, le comptoir, sylvain métafiot, léon bloy, nous baignons dans une rhétorique médiatique confite de niaiseri, metoo, culture du viol, féminisme, pasolini, antoinette deshoulières, philippe muray | Lien permanent | Commentaires (0)










Écrire un commentaire