« 2021-06 | Page d'accueil
| 2021-08 »
lundi, 12 juillet 2021
Quentin Dallorme : « Ramer est un fantastique moyen de trancher l’eau comme l’angoisse. »

« Le cœur sur l’eau », premier roman de Quentin Dallorme, c’est celui du jeune Hugo, à un âge où les aspirations individuelles se bousculent à des désirs inconnus, où le besoin de reconnaissance et de chaleur se heurte aux affres de la solitude, des amitiés courbes et des incompréhensions familiales. Tiraillé entre la terre et le ciel, l’auteur ancre la vie de son personnage dans son propre lieu de vie, Nantua, petite ville de l’Ain au pied du plateau de Chamoise et bordée par un lac couleur émeraude. Un environnement naturel propice à la contemplation spirituelle, à l’élan poétique, comme à l’intensité sportive la plus vivifiante.
Le Comptoir : À quand remonte le désir (ou la volonté) d’écrire cette histoire ?
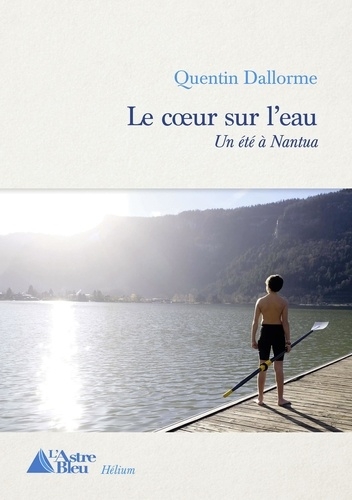 Quentin Dallorme : Aux premières foulées en forêt lors de ma préadolescence. J’ai toujours ressenti un intense sentiment de liberté relié aux odeurs, aux couleurs et à l’ambiance des sous-bois. À cette époque j’étais mû par une houle de sensations.
Quentin Dallorme : Aux premières foulées en forêt lors de ma préadolescence. J’ai toujours ressenti un intense sentiment de liberté relié aux odeurs, aux couleurs et à l’ambiance des sous-bois. À cette époque j’étais mû par une houle de sensations.
Peu à peu, l’âge venant, les perceptions se sont étirées, sont devenues questionnement. Cette histoire résulte d’un regard sur l’enfance et le groupe, regard ouvrant par la même occasion un sentier mémoriel au travers d’expériences sensitives vécues.
Le désir d’écrire était sous-cutané, il m’a toujours poursuivi. Auparavant, chanter ou simplement vivre ces moments relevait du même besoin. La volonté de raconter précisément une histoire est venue quant à elle de la pratique de l’écriture et de l’évaluation : tout ce que j’observe en moi et alentour.
mercredi, 07 juillet 2021
Les coulisses du rêve : Un beau désordre de Marco Caramelli

Comment faire pour s’exprimer alors qu’on pense n’avoir plus rien à dire ? Tandis qu’il s’active dans les préparations de son nouveau film, le cinéaste Massimo Barbiani, s’évanouit d’angoisse dans son appartement romain. Se réveillant à l’hôpital sans trop savoir comment il est arrivé là, on lui prescrit une cure thermale à Chianciano, « à la frontière du Latium et de la Toscane ». Là-bas, il est assailli par les médecins, ses producteurs, les femmes de sa vie, doutant de tout, de son film, de lui et de la réalité même. Si le tableau semble familier aux cinéphiles c’est normal : il s’agit de l’adaptation en roman du célèbre Huit et demi de Fédérico Fellini. Et des images du film, difficile de s’en défaire à la lecture de cette aventure absurde et onirique. Se mettant dans la peau du maestro, Marco Caramelli insère également quelques passages de La Dolce Vita (Claudia Cardinale remplace Anita Ekberg dans la fontaine de Trévi le temps d’un souvenir langoureux) et d’autres éléments biographiques afin de perdre davantage le lecteur dans les méandres de la psyché du réalisateur tourmenté.
Dans la farandole de personnages qui défilent dans la station thermale où il est censé se reposer, Barbiani voit notamment apparaître son actrice principale qui ne sait rien du rôle, sa maitresse, l’exubérante et dodue Carla, sa femme Louise, tendre, fragile mais pas dupe, des journalistes étrangers, des assistants et des collaborateurs qui le pressent de toute part, le psychanalyste Bernhard et ses théories junguiennes, Lily la cartomancienne et véritable âme sœur, des vieux amis et des jeunes nymphettes… En somme, « tous les fantômes de mon existence s’étaient donné le mot pour venir perturber ma quiétude ». Sans oublier ses chers producteurs, auprès de qui il se rend compte que leur médiocrité lui permet paradoxalement de garder les pieds sur terre en canalisant son goût de la démesure : « Se confronter à une autorité despotique, quitte à s’en jouer ensuite dans l’exercice de son art, est un contre-point nécessaire à l’immaturité psychologique de l’artiste. La révolte est toujours féconde, elle porte en elle la nécessité organique de l’expression, là où l’approbation conduit à la banalité et à l’ennui. »
Une révolte qui prend corps lorsqu’un représentant du ministère lui annonce que certaines scènes de son film sont considérées par les garants de l’ordre moral comme misogynes et racistes. De bonne foi, Barbiani explique qu’il s’agit d’une séquence onirique, traduisant le fantasme outrageux de son personnage et ne relevant en aucun cas d’un plaidoyer sexiste : « Nul n’ignore la nature surréaliste de tout rêve, façonné par l’inconscient de manière abstraite, symbolique, souvent absurde… peuplé des pulsions les plus morbides, des désirs refoulés les plus inavouables. » Mais qu’elle soit de droite (le fascisme, l’intégrisme catholique) ou de gauche (la cancel culture) la censure « se fiche bien des subtilités, du second degré. Le pouvoir opère de façon dogmatique et brutale. […] La réalité n’a aucune importance ; c’est d’ailleurs à cela que l’on reconnaît l’obscurantisme… » lui avoue Rinaldi. Ce que Lalaunay décrira plus loin (en s’inspirant visiblement des récentes polémiques ayant ébranlées le monde de la culture) comme l’émergence d’un nouveau fascisme, très différent de l’ancien, puisqu’il « se targuera de progressisme afin de demeurer inattaquable, prétendra œuvrer en faveur du bien, de la liberté et de la démocratie, tout en servant en réalité les intérêts d’une minorité de nantis au détriment de l’ensemble de la population… » On aurait tort de croire qu’il ne s’agit ici que de fiction…
Finalement, ce beau désordre prend une forme plus rangée et sage que l’œuvre dont il s’inspire, ce qui n’amoindrit en rien l’élégance de son trait, pas plus que la chaude déclaration d’amour à un cinéma s’affranchissant de toutes les processions idéologiques et moralisatrices : « Oui, j’aime les comédiens, j’aime les décors, j’aime tout ce peuple qui s’affaire avec passion pour fabriquer quelques instants de rêve… Tout ceci est mon monde, c’est ici que je me sens le mieux, que j’ai pleinement la sensation de vivre. » La meilleure cure au monde.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
10:06 Publié dans Cinéma, Littérature | Tags : cancel culture, massimo barbiani, huit et demi, fédérico fellini, le comptoir, sylvain métafiot, les coulisses du rêve, un beau désordre, marco caramelli | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 01 juillet 2021
Le fou caressant : Arthur Cravan, la terreur des fauves de Rémy Ricordeau

C’est un drôle de bonhomme qui déambule dans le quartier Latin en cette année 1912. Un géant d’1m95, cheveux courts et verbe haut, harangue les passants à propos d’une tout jeune revue antilittéraire, Maintenant, dont il est l’unique rédacteur. Arthur Cravan, puisqu’il s’agit de lui, ne passe pas inaperçu. Se présentant comme poète, boxeur, neveu d’Oscar Wilde mais aussi barman, cueilleur d’orange et charmeur de serpents déguisé en Indien, les journalistes se régalent de ses frasques lors de soirée où les démonstrations pugilistiques succèdent aux déchainements poétiques. Des coups de poings qui au propre comme au figuré, lui vaudront huit jours de prison avec sursis pour avoir eu le mauvais goût de déplaire au couple de peintres orphistes Robert et Sonia Delaunay. Refusant de marcher au pas lors de la déclaration de guerre, ce dadaïste avant l’heure s’embarque ensuite pour New-York précédé d’une réputation sulfureuse et retrouve ses amis Marcel Duchamp et Francis Picabia afin de continuer à « mener une vie pleine, sous le signe de la passion, de toutes les passions », comme le note le documentariste Rémy Ricordeau à qui l’on doit l’établissement de ce bel ouvrage rouge de plaisir réunissant certains documents inédits.
On y trouve ainsi une revue de presse française et américaine assez désopilante, relatant sa vie aussi extravagante que subversive (« Cravan tel qu’en lui-même») ; le célèbre « prosopoème » Notes rédigé quelques mois avant sa disparition (et qui avait été publié par André Breton en 1942 dans un magazine new-yorkais lors de son exil aux Etats-Unis) ; enfin, le cœur du livre, sa correspondance amoureuse avec les trois femmes de sa vie : Renée Bouchet tout d’abord, rencontrée en 1909, compagne de soif dans les cabarets de Montmartre et soutien indéfectible de ses années parisiennes ; Sophia Treadwell et Mina Loy ensuite, aventurières modernes fréquentant l’avant-garde new-yorkaise, journaliste féministe pour l’une, poète et peintre audacieuse pour l’autre. Loin d’être une brute que certains aimaient à caricaturer, Cravan est surtout une âme d’une extrême sensibilité, avide du désir amoureux. Cet amour fou dont il n’est jamais rassasié lui revigore le sang jusqu’à l’extrémité des doigts, lui inspirant ces nombreuses « lettres de passion et de désertion ».
La correspondance qu’il entretien avec ces trois « amours-passions » durant une année et demie donne à voir l’évolution de ses sentiments, tour à tour enjoué et bravache lorsqu’il clame sa flamme (« J’ai ta photographie toute mouillée devant moi et je t’adore comme je crois aucun homme n’a jamais adoré une femme. Je suis absolument assommé d’avoir trop pensé à toi et je n’arrive pas à terminer ma lettre » lettre à Mina Loy, 20 décembre 1917), nostalgique des étreintes charnelles (« Je n’oublierai jamais le dernier soir où, étendus sur le lit, nous nous plûmes à nous charger d’amour » lettre à Sophie Treadwell, 28 mai 1917), puis inquiet et désespéré quand les réponses tardent un peu trop et lorsque les conditions matérielles deviennent éprouvantes (« Si tu continues à te montrer aussi froide dans tes lettres tu me feras complètement perdre la tête, car c’est dans la logique de l’amour » lettre à Sophie Treadwell, 28 mai 1917 ; « Mourir de l’âme c’est dix mille fois pire que le cancer. Et je suis bien perdu. […] La vie est atroce » dernière lettre à Mina Loy, 31 décembre 1917). Lors de son exil au Mexique, pour fuir la guerre, sa frénésie épistolaire atteint parfois les trois lettres par jour. Mina parviendra à le rejoindre en janvier 1918, ils se marieront en mars de la même année, mais leur situation frôle la misère la plus extrême. Résolus à quitter Mexico séparément, Mina embarque sur un navire à destination de Buenos Aires tandis que Cravan disparaît dans le golfe de Tehuantepec à bord d’un voilier. Son corps n’a jamais été retrouvé.
On regrette, par ailleurs, de ne pouvoir lire les réparties des demoiselles en question, bien que cela nécessiterait sans doute un volume à lui seul. Malheureusement, les lettres de Sophie n’ont pas été retrouvées et celles envoyées à Renée après leur séparation ont été perdues, ce qui rend cette correspondance d’autant plus légendaire, comme en témoigne Blaise Cendrars dans Le Lotissement du ciel (1949) : « Il semble bien que son séjour au Mexique, le voyage dans le sud du pays, la prospection des mines d’argent, eût été pour lui un chemin de Damas s’il n’avait pas fait demi-tour dans la solitude. Il a adressé alors à son épouse parisienne des lettres extraordinaires d’émotion et de poésie intense et contenue, des hymnes à la nuit aussi profonds et suaves que ceux de Novalis et des illuminations aussi prophétiques et rebelles et désespérées et amères que celles de Rimbaud. » Un propos qui rejoint celui d’Annie Le Brun qui, en postface de l’ouvrage, fait l’éloge de ce « sauvage amour courtois » et de « l’irrésistible force poétique » de Cravan « qui est de prendre à revers le monde des mots et des idées, pour atteindre chacun au plus profond de sa nuit ». Précipité de détresse et de tendresse, Cravan amalgame la désertion de tous les nationalismes et des gesticulations sociales avec le pari insensé de « réinventer l’amour » pour accéder à la « vraie vie ». C’est grâce à cette fureur amoureuse que Cravan combat le monde tel qu’il va et la banalité affligeante de la réalité qui l’accompagne. Soit « l’affirmation brute et sans apprêt d’une vie en insurrection en quête d’un sens et d’une intensité toujours renouvelée ».
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
10:55 Publié dans Littérature | Tags : annie le brun, blaise cendrars, andré breton, renée bouchet, sophia treadwell, mina loy, le comptoir, sylvain métafiot, le fou caressant, arthur cravan, la terreur des fauves de rémy ricordeau | Lien permanent | Commentaires (0)









